

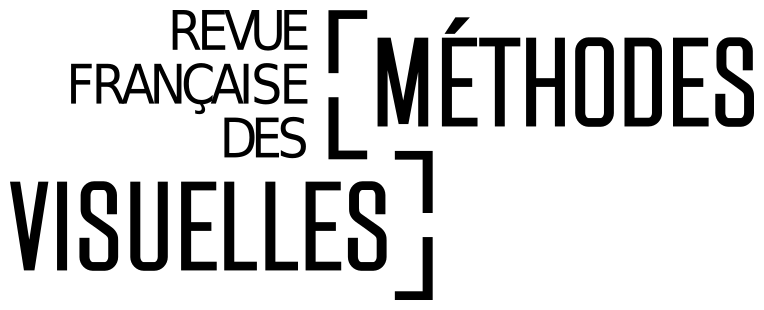
Jeanne Drouet, Anthropologue et ingénieure CNRS, Centre Max Weber, UMR 5283
Cet article propose d’observer et d’analyser, à l’échelle d’un laboratoire de sociologie, comment les images sont partie prenante de l’activité de recherche. L’histoire d’une enquête menée au Centre Max Weber est d’abord retracée dans un double objectif : expliciter les principaux enjeux d’une telle entreprise et entamer la description des pratiques de sociologies visuelles qui se déploient en son sein. S’ensuit la présentation des résultats de l’enquête par questionnaire et de la cartographie de pratiques qui en est issue. Il est enfin question des apports de cette étude à une réflexion plus générale sur les méthodes visuelles, à savoir la mise en visibilité de pratiques plus souterraines (peu visibles dans les espaces « vitrines » de la recherche).
Mots-clés : Sociologies visuelles, Méthodologie, Enquête, Images, Savoir-faire, Laboratoire, Film, Bande dessinée, Photographie, Web
This article aims to observe and analyze, through the case study of a French sociology research laboratory, how visual images constitute an integral part of sociologists’ regular research activity. Introducing a questionnaire survey conducted at the Centre Max Weber (in Lyon), the article first highlights the main questions raised by this topic, and describes the various practices in visual sociology reported by researchers within the unit. The article then moves on to present the detailed findings of the survey, resulting in a typology of image-based research practices. Finally, it explores how the survey’s outcomes can contribute to a broader reflection on the use of visual methods in social sciences. In particular, the survey sheds light on certain visual research practices that remain hidden or invisibilized by the way sociological research is usually showcased.
Keywords : Visual sociology, Methodology, Fieldwork, Pictures, Know-how, Laboratory, Movie, Comic, Photography, Web
Depuis les années soixante avec l’impulsion de Pierre Naville (1966) et sans discontinuer, nombre de praticienn.es des sociologies visuelles1 françaises se sont donné pour objectif de faire reconnaître les divers intérêts scientifiques des recours aux images et aux sons, en faisant preuve de réflexivité à l’égard de leurs propres expériences. On peut regretter que ces efforts n’aient pas trouvé suffisamment de traductions institutionnelles. Encore peu de lieux, d’espaces ou cadres académiques sont aujourd’hui dédiés à ces pratiques. Sur le plan de l’organisation collective, c’est la constance qui fait défaut, puisque l’histoire du domaine est marquée par « des temps forts suivis de périodes d’atomisation ou de latence » (Mignot-Lefebvre, 1992). Néanmoins, cela n’a pas empêché l’émergence de divers argumentaires scientifiques solides et bien étayés, en particulier autour des pratiques « canoniques » en France : le film de recherche2 ou les approches photographiques3.
Cela dit, dès 2016, mon expérience quotidienne d’ingénieure en méthodes visuelles m’invite à m’interroger sur l’existence de « points aveugles », de zones d’ombre ou de tropismes dans la littérature dédiée à ces méthodes. En effet, si l’on se met à observer de près l’activité de recherche d’un laboratoire en sociologie telle qu’elle se fait et non telle qu’elle s’énonce dans les espaces « vitrines » (publications scientifiques, colloques, sites web institutionnels…), il apparaît que le paysage des pratiques en sociologies visuelles est très vaste et varié, tant du point de vue des types d’images employées (photos, dessins, vidéos, schémas…) que des supports (web, ouvrages, BD, films…) ou des techniques (photo elicitation, vidéo ethnographique, analyse d’images, cartes mentales, photographie documentaire…). La littérature du domaine fait bien sûr écho à cette variété, mais un écho qui semble mal ajusté ou mal proportionné aux pratiques de terrain. Citons notamment ces emplois « parcellaires, silencieux, plus ou moins rationalisés et contrôlés » des images dont un premier examen détaillé a été proposé par Flora Bajard (2017) mais qui n’avaient jusqu’alors – du moins à ma connaissance – pas fait l’objet d’un retour d’expérience à part entière.
C’est dans une perspective résolument empirique que se situe le présent article. Je propose ici d’observer et analyser, à l’échelle d’un laboratoire, comment les images sont partie prenante de l’activité de recherche. Il s’agit donc moins de soumettre un nouveau panorama du recours aux méthodes visuelles à l’échelle nationale ou internationale – d’autres publications récentes remplissant tout à fait cet objectif (Chauvin et Reix, 2015 ; Vander Gucht, 2017 ; Zuev et Krase, 2017 ; Bouldoires et al., 2018) – que de décaler le regard pour observer la situation d’une autre manière, en basant la réflexion sur une échelle plus restreinte (l’unité mixte de recherche en question rassemblant 282 membres, lyonnais et stéphanois4) mais dont il est plus aisé de dresser un portrait fin et complet, sorte de monographie. Les grandes questions soulevées concernant le Centre Max Weber seront les suivantes : jusqu’où s’étend le périmètre des méthodes visuelles en son sein ? Comment se déploient-elles ? Comment se définissent et se structurent les différents usages de l’image ? Des éléments inédits (c’est-à-dire peu discutés dans la littérature dédiée) apparaissent-ils ? L’idée étant de tirer les enseignements de cet examen au regard du domaine méthodologique.
Le plan de l’article suivra le cheminement de l’étude, avec d’abord un retour sur la mise en œuvre d’une enquête, ensuite une présentation de la cartographie des pratiques et des éléments qui en résultent, et enfin une mise en exergue de ce que cette étude peut apporter à une réflexion plus générale sur ces méthodes.
Bien avant la création du Centre Max Weber5, au début des années quatre-vingt, des recherches sont d’ores et déjà menées en images au laboratoire GLYSI-SAFA à Lyon. Elles sont portées et réalisées par Bernard Ganne et Jean Paul Pénard, auteurs de nombreux films autour du monde de l’entreprise et du travail6. Sur le versant institutionnel, ils œuvrent également à donner une place aux images puisqu’ils travailleront en partenariat avec l’Institut des sciences de l’Homme à Lyon, en particulier avec l’ingénieur Christian Dury, au développement d’un pôle Image animée. Quand le GLYSI-SAFA devient MODYS en 2007, d’autres personnes intéressées par l’emploi des images les rejoignent, en particulier Béatrice Maurines. Cette dernière emploie l’image depuis ses travaux de thèse (soutenue en 1994), puis intensifie sa pratique en réalisant des films de recherche avec Christian Dury (Ce saumon qui dérange en 2009 ; Ce saumon nommé désir en 20107).
Quand l’unité mixte de recherche8 intitulée Centre Max Weber naît en 2011, ils poursuivent leurs travaux respectifs et, quelques années plus tard, Béatrice Maurines active une dynamique collective au sein de l’unité en proposant la création de l’atelier « Image animée » (bientôt transformé en séminaire) regroupant environ six personnes. En parallèle, un autre élan est en cours, porté par Michel Rautenberg en articulation avec la plateforme International Rhône-Alpes Média. L’idée, ici, est d’expérimenter et innover en empruntant, pour la recherche, diverses pratiques numériques9. En satellite, trois autres membres du laboratoire montrent leur intérêt pour les méthodes visuelles et, parfois, dans leurs croisements avec des formes numériques. En 2015, la création d’un profil de poste d’ingénieur CNRS émane de ces dynamiques, conjuguées pour la cause. C’est ainsi qu’en janvier 2016, je rejoins la structure.
Au total, sur les 207 membres titulaires et non permanents que compte alors l’unité10, une petite dizaine affiche clairement son appétence pour ces approches. Le nombre de membres actifs en la matière semble donc suffisant pour activer une dynamique, mais il semblerait encore présomptueux d’affirmer que cela peut constituer l’un des axes scientifiques du Centre Max Weber.
Sept projets de recherche du laboratoire ont été recensés avant mon arrivée comme ressortant de mon périmètre d’action. Ce premier portefeuille de projets offre déjà un aperçu de la pluralité d’entrées et d’acceptions des méthodes visuelles. S’y côtoient deux projets d’ethnographie filmique, des projets de réalisation de supports visuels interactifs et multimédias, un projet d’analyse de discours médiatiques, l’accompagnement de la diffusion d’une plateforme web-documentaire et une enquête d’usage sur un outil d’annotation vidéo. En quelques mois, je ferai face à bien d’autres demandes de la part des membres du laboratoire, et verrai ce panel de pratiques et d’approches s’étendre encore, bien au-delà de ce que j’aurais imaginé.
Un de mes premiers constats vient corroborer les observations de Flora Bajard (2017) : il semble que de nombreux et nombreuses sociologues prennent des photographies sur leur terrain sans pour autant considérer que cela ressort d’une méthode d’enquête à part entière. De fait, ces images ne figurent généralement pas dans leurs publications, tel Pierre Bourdieu qui dissimulera pendant de longues années ses photographies d’Algérie (2003). La plupart du temps, cette mise sous silence est liée au fait qu’ils ou elles se considèrent comme de piètres photographes.
Outre ces pratiques photographiques invisibilisées, il existe d’autres activités de recherche qui ressortent sans nul doute des sociologies visuelles, sans pour autant que leurs praticien.nes ne s’en réclament. J’en dénombrerai rapidement plusieurs, notamment en matière de visionnage de films en tous genres. Emmanuelle Santelli, sociologue du laboratoire, sera par exemple frappée par la façon dont une série télévisée déploie, par des procédés cinématographiques, l’un des concepts qu’elle a forgés au cours de sa carrière, la « temporalité intergénérationnelle » (Santelli, 2019). Je serai donc sollicitée pour l’aider à analyser ladite série afin de cerner la façon dont le matériau filmique opère sur le concept concerné. D’autres encore, tels que Dominique Belkis et Michel Peroni, recourent à la matière filmique (films documentaires mais aussi de fiction) d’une façon qui semble peu courante dans la discipline. Il s’agit d’un recours à l’image dans le cadre d’une démarche d’enquête mais par le biais d’une sorte de visionnage exploratoire.
Nous entendons considérer ce film non pas tant comme un document à analyser, mais en tant qu’il est partie prenante d’une enquête qui est à reconnaître comme telle et à poursuivre. Une enquête sous format esthétique. Une enquête dont nous intéresse la portée heuristique : le film étant à voir en quelque sorte comme un dispositif de recherche venant renouveler notre conception du mode d’existence de la mémoire.
(Belkis et Peroni, 2015, p. 1)
Ainsi, je m’aperçois que visionner des films pour alimenter la recherche sociologique est une pratique plutôt courante dans le laboratoire11. Son intérêt a pu être pointé récemment par le géographe Benoît Raoulx (2018), qui évoque la figure du « spectateur-chercheur » et sa « façon d’entrer en résonance avec un récit filmique ». Avant lui, d’autres, tel que Fabien Truong (2015), en avaient déjà montré les vertus. Pour autant, ce n’est pas la pratique sur laquelle les chercheur.es sont les plus loquaces dans la littérature dédiée.
Rapidement après mon arrivée, je serai également surprise de l’emploi de différents médias : si le film et la photographie sont très présents, l’image de synthèse, les pages web, le dessin, le design ne sont pas en reste dans les pratiques de mes collègues : coexistent divers projets de bande dessinée, un projet d’exposition d’une recherche ou encore la création de cartes mentales au cours de l’enquête…
Voyant que les images viennent titiller les sociologues plus souvent qu’on ne le croirait au premier abord, je m’interroge sur les contours du champ : à partir de quand et jusqu’où peut-on parler des « questions visuelles » au Centre Max Weber ? Cela m’amène à examiner la façon dont est définie l’étendue du domaine dans la littérature. Dans la présente revue, française et pluridisciplinaire, il est large mais avec une focale sur les pratiques pour lesquelles les images sont considérées comme un instrument d’investigation :
Le projet scientifique de la revue vise à faire discuter les aspects théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou éthiques liés aux pratiques de l’image dans les processus de recherche. Sa ligne éditoriale met l’accent sur les questions liées à la production d’images perçues comme outils d’enquête au même titre que d’autres techniques d’investigation. L’image est alors envisagée non comme seul objet d’analyse mais comme moyen à part entière d’observation et de questionnement12.
Chez sa consœur anglo-saxonne, la revue Visual Studies proposée par l’International Visual Sociology Association, la perspective est plus extensive :
La revue publie des articles orientés vers des questions visuelles et issues de plusieurs disciplines. Elle s’engage de longue date dans les recherches visuelles de terrain, les études de la culture visuelle et matérielle, le développement des méthodes visuelles et l’exploration des moyens de communication visuels des mondes culturels et sociaux13.
La perspective des visual studies ne correspond pas vraiment aux façons de penser et de faire la recherche dans le laboratoire dans lequel j’évolue. Il existe, au Centre Max Weber, de nombreux travaux mobilisant des images comme supports ou instruments de recherche, mais cela reste la plupart du temps une entrée méthodologique. Peu de sociologues du laboratoire feraient, tel André Gunthert14, des images leur « spécialité ». Si elles peuvent temporairement devenir leur objet d’étude, ce n’est pas leur objet de prédilection. Pour cette raison, le spectre des méthodes visuelles « à la française » m’apparaît plus adéquat. Mais alors, pourquoi certaines pratiques du laboratoire semblent-elles atypiques ou sortir du cadre ? C’est en m’interrogeant de la sorte que je ferai l’hypothèse qu’il existe des pratiques (ou certaines de leurs facettes) peu commentées qui restent tapies dans les coulisses des laboratoires.
En sociologie comme dans la plupart des autres disciplines de sciences humaines et sociales, les méthodes visuelles demeurent en marge. Un faisceau de circonstances explique probablement cette situation, parmi lesquelles un déficit de compétences techniques des chercheur.es en sciences sociales dans les différents domaines visuels (on ne s’improvise pas vidéaste, photographe ou informaticien.ne) et une logique de recension des activités de recherche qui ne prend toujours pas véritablement en compte les productions audiovisuelles et multimédias. Sans aller plus loin dans l’analyse des causes possibles d’une telle marginalisation – perspective passionnante mais qui n’est pas l’objet du présent examen – il est tout de même possible d’en renouveler, aujourd’hui encore, le triste constat.
Du fait du maintien des sociologies visuelles françaises dans ces marges, beaucoup de praticien.nes poursuivent une volonté de légitimation scientifique du champ, et cela a cours sans interruption depuis l’apparition de ces méthodes en sociologie. Son corollaire, au niveau des publications, est une tendance à vouloir démontrer les multiples intérêts scientifiques de ces recours à l’image15. Ce faisant, en toute logique, les écrits se concentrent sur les pratiques les plus valorisables et valorisantes : celles où les images sont centrales, motrices pour la recherche.
Les fonctions illustratives, « aide-mémoire », didactiques sont de fait moins commentées. En témoignent parfois les phrases qui balisent les intentions des articles : « L’image, si elle est “pensée”, n’est pas et ne peut être ravalée à la seule fonction de l’illustration. C’est dire que la position que je voudrais soutenir pose l’image comme instrument d’investigation, et donc comme outil de production d’une connaissance de la réalité. » (Péquignot, 2006, p. 48)
Quant aux images mobilisées pour activer des débats publics, ou aux opérations permettant de montrer les images produites (exposition, projection-débat…), elles souffrent souvent du même silence, mais cette fois parce qu’elles n’entrent plus tout à fait dans le cadre des activités reconnues essentielles pour la recherche. Avec la systématisation de l’évaluation de la recherche par le prisme des publications écrites, ces activités sont considérées comme annexes, « bonus » relégables dans la sphère assez floue de la médiation scientifique.
J’aurai bientôt l’occasion de pousser l’investigation puisqu’en juillet 2018, la préparation d’un atelier autour des sociologies visuelles dans le cadre d’un séminaire transversal au laboratoire m’incite à opérer une mise à plat des différentes pratiques existantes au sein de l’UMR. La création d’un poste autour des méthodes visuelles au Centre Max Weber semble avoir provoqué, en deux années, un effet de mise en visibilité et de multiplication des projets mobilisant les images. Pour notre atelier, je parviens à recenser 44 projets de recherche (terminés ou en cours et d’ampleur variable) dont j’ai eu connaissance de diverses manières, soit pour y avoir été impliquée, soit pour en avoir reçu divers échos.
En compagnie de Marie-Thérèse Têtu, nous tentons de classer ces projets de façon empirique. L’idée est moins de réaliser une étude rigoureuse et systématique que de se donner de la matière pour penser et échanger avec nos collègues. Pour permettre ce classement, une solution serait de reprendre la triade déjà très discutée : sociologie avec les images, sociologie sur les images, sociologie en images (Harper, 2002 ; La Rocca, 2007 ; Maresca et Meyer, 2013). Cette catégorisation semble tout à fait fertile pour penser les approches en méthodes visuelles et nous pourrions donc voir comment nos projets se répartissent dans les trois classes. Rapidement, nous nous apercevons que cette façon de procéder n’est pas la plus adaptée pour notre visée. Nous souhaitons ici faire émerger la diversité des pratiques, tenter de voir la variété des enjeux soulevés, le tout, en veillant à bien faire mention des approches au sein desquelles les images n’ont pas une place centrale pour la recherche concernée. Pour ce faire, il paraît plus logique de partir des caractéristiques propres des projets plutôt que de vouloir les « ranger » dans des catégories préexistantes. Autrement dit, nous devons rebattre les cartes, démarrer le classement en mettant tout « à plat » : classer sur la base d’une description empirique.
Nous veillons également à ne pas figer ou rigidifier en classant. Il ne s’agit pas de « mettre en boîte » les projets, mais de les regrouper selon des physionomies proches pour donner forme à une sorte de constellation d’approches en sociologies visuelles. Dans cet esprit, nous parvenons à dégager huit approches différentes (voir les annexes), bien utiles pour lancer la discussion. Néanmoins, en dehors de ce temps d’atelier collectif, ce découpage semble peu lisible et ne nous satisfait pas. L’exercice nous permet surtout de nous apercevoir qu’il n’est pas aisé de trouver les principes d’organisation permettant d’appréhender, décrire et caractériser des pratiques méthodologiques visuelles ; difficulté qui serait probablement semblable pour les pratiques relevant de la raison graphique (Goody, 1979).
C’est le travail en compagnie d’un ingénieur en méthodes quantitatives, Julien Barnier, qui ouvrira une perspective plus satisfaisante. L’idée qui émerge alors consiste à faire passer un questionnaire aux membres du laboratoire pour qu’ils recensent et caractérisent eux-mêmes les différents projets concernés. Cela permettra une meilleure finesse et une plus grande précision dans leur caractérisation. Leurs réponses pourront faire l’objet d’abord d’une approche descriptive, puis d’une méthode de classification permettant d’esquisser une cartographie. La perspective reste donc identique, nous restons dans une approche résolument empirique, qui cherche à classer les pratiques en les mettant « à plat » au préalable. L’outillage pour y parvenir est cependant différent puisque la mise à plat consiste ici à décrire ces pratiques par une série d’indicateurs communs.
Cela exige de reprendre l’investigation depuis son démarrage. Forts de l’arrivée de nouvelles « recrues » en sociologies visuelles et de la mise en visibilité des pratiques déjà là, nous nous trouvons désormais dans la dynamique de création d’un axe transversal autour des sociologies visuelles au sein de l’UMR16. L’envoi d’un questionnaire tombe donc à point nommé, puisque les résultats de l’enquête pourront servir de base au lancement de ce nouveau collectif de travail.
Les réflexions menées au préalable, mais aussi mon expérience quotidienne de travail, me servent à dégager les hypothèses qui sous-tendent la création du questionnaire. Pour caractériser et décrire les pratiques, je liste différents indicateurs semblant essentiels, tels que les formats, médias, supports (et leurs articulations mutuelles). J’ajoute des questions complémentaires à cette description : au sujet d’éventuelles productions théoriques écrites associées au projet, sur la mise en place de collaborations arts/sciences, sur l’intérêt porté aux images produites par les personnes rencontrées sur le terrain ou encore des questions ayant trait au caractère expérimental et innovant des pratiques et techniques employées17.
Un indicateur qui m’apparaît très vite important tient au moment où l’image intervient dans le processus de recherche. Tout comme Monique Haicault, je n’ai de cesse, dans ma pratique, de vérifier que « la première question qui se pose est celle de la place de l’image dans le processus de recherche, place qui peut varier selon la fonction que l’on veut attribuer aux images » (2000, p. 9). Car s’il est possible que les images soient mobilisées à toutes les étapes – de l’enquête jusqu’à la diffusion des résultats de recherche, en passant par l’analyse – d’autres projets se cantonneront plutôt à un usage spécifique qui intervient à une ou deux étapes de la recherche. Il est par exemple envisageable d’écrire en images sans avoir enquêté au préalable avec des images (un projet de bande dessinée comme ceux de la collection Sociorama chez Casterman, par exemple), de mettre en débat la recherche avec des images sans avoir pris la peine de penser une écriture visuelle auparavant (lorsque l’on mobilise des films faits par d’autres pour animer un échange scientifique), ou encore de mobiliser ou créer des images lors de l’enquête de terrain sans les exploiter ensuite pour l’analyse et/ou la publication (la photo elicitation interview ou l’ethnographie visuelle ne sont pas nécessairement suivies d’une quelconque entreprise d’écriture visuelle).
En complément, il peut être intéressant de se poser la question des apports scientifiques de ces usages de l’image. En 2015, Pierre-Marie Chauvin et Fabien Reix proposaient une piste intéressante en organisant et décrivant les pratiques de sociologies visuelles à partir de leurs apports respectifs. Adjoindre cette perspective à celle d’un découpage par étapes du processus de recherche semble judicieux. L’image sera parfois cruciale pour débloquer une étape de la recherche, tandis que d’autres fois ou à d’autres moments, ses apports seront plus modérés. Les qualités heuristiques des images prennent des formes multiples : elles peuvent par exemple rendre visibles des gestes ou détails, débloquer des paroles, rendre communicable un résultat de recherche peu dicible à l’écrit… Au contraire, l’image interviendra peut-être de façon plus anecdotique à un autre moment de la recherche, adoptant par exemple une fonction illustrative. Certaines questions (non citées en annexes) auront donc pour but de bien définir la façon dont l’image intervient dans le processus de recherche et les moments où son apport semble vraiment porter ses fruits sur le plan scientifique.
L’envoi du questionnaire est doublé d’une vidéo d’appel (image 1) permettant d’élargir au maximum le spectre des répondant.es. L’objectif est de parvenir à obtenir des réponses de la part de personnes ne se sentant pas concernées par le label « sociologie visuelle » mais qui sont pourtant praticiennes.
Nous savons d’ores et déjà que cette investigation ne nous permettra pas de recenser certains emplois de l’image, notamment ceux qui sont les moins formalisés sur le plan méthodologique, parce qu’ils ne peuvent être déclarés comme des projets en tant que tels. Certaines pratiques ne semblent accessibles et apparentes que dans le cadre d’une observation quotidienne. Mais nous gageons que le questionnaire permettra quand même de déceler des pratiques de l’image moins visibles et moins commentées, et peut-être de laisser apparaître ces éventuelles zones d’ombre ou points aveugles du domaine. Le questionnaire est envoyé à l’ensemble de l’unité en septembre 2019.
Au terme de trois semaines, nous obtenons 39 réponses au questionnaire18. Considérant que nous avons proposé de déclarer uniquement les projets récents, c’est-à-dire ceux qui ont été entamés dans les cinq dernières années ou qui sont encore en cours de réalisation, ce chiffre nous paraît plutôt élevé. Il dénote en tout cas un certain dynamisme des sociologies visuelles dans le laboratoire. Sur cette base, nous commençons par opérer un premier tri à plat et quelques tris croisés.
Ces premiers tris permettent de faire ressortir qu’au Centre Max Weber, la forme canonique d’un projet en sociologies visuelles semble être aussi celle qui est la plus commentée dans la littérature française du domaine : à savoir un projet supposant un usage instrumental de l’image, impliquant le média filmique et ce, au moment de l’enquête de terrain. Sur les 39 projets déclarés, 19 répondent à ces critères. À côté de ces éléments « attendus », en figurent d’autres, plus surprenants.
Trois chiffres semblent particulièrement élevés. Il y a d’abord les 20 projets ayant suscité la mise en place d’un évènement de type projection-débat. Parmi ceux-ci, on compte 11 projets de réalisation filmique ou vidéographique pour lesquels on comprend aisément que soit organisé un temps dédié à la diffusion du film produit. Mais cela signifie qu’il reste 9 projets qui n’ont pas fait l’objet d’une production d’images animées mais qui se manifestent quand même sous une forme évènementielle. Au regard de ce chiffre, on peut se demander pourquoi si peu d’écrits scientifiques ont été produits autour de cette dimension-là : pourquoi si peu de commentaires sur l’intérêt de la projection-débat ? Nous y reviendrons.
Bien que totalement convaincue de l’intérêt (voire, parfois, de la nécessité) de tisser des partenariats avec les artistes ou professionnel.les de l’image, du web et du son pour mener à bien les travaux de sociologies visuelles (Drouet, 2014 et 2015), je m’étonne ensuite du grand nombre de collaborations mises en place : 26 projets sont concernés, sur les 39 déclarés. Il est délicat d’avancer qu’il s’agit d’un domaine plus collaboratif qu’un autre dans le laboratoire, mais on peut en tout cas affirmer que les réflexions autour des collaborations arts/sciences trouveraient ici un bon écho.
Le troisième chiffre étonnamment élevé est relatif à la démarche expérimentale. Une telle démarche serait mise en œuvre dans 23 projets, parmi lesquels 13 proposeraient, en sus, la mise en place d’une nouvelle technique ou nouvelle méthode. Le terme expérimental n’étant pas défini dans le questionnaire, on peut supposer qu’il recouvre des approches bien différentes les unes des autres. Nous nous apercevrons par la suite que cette variable n’est pas très opérante pour discriminer les projets entre eux ou pour caractériser une forme singulière de projets. Quoi qu’il en soit, le mot semble emporter l’adhésion des répondant.es, ce qui indique au moins que les chercheur.es ont le sentiment de bricoler, découvrir ou de chercher d’une façon différente. Je ferai donc l’hypothèse que le terme désigne plutôt une attitude ou un sentiment éprouvé lors de la mise en place des méthodes visuelles plutôt qu’un type de pratique en tant que tel.
Après ces premiers éléments, nous poursuivons l’analyse des réponses en essayant d’établir une cartographie des projets à l’aide d’une méthode statistique de classification19. L’objectif est de faire apparaître des regroupements de projets ayant eu des réponses semblables, et au contraire de distinguer ceux ayant des profils différents. Le travail se fait de manière itérative, d’abord en sélectionnant les variables les plus pertinentes. Sont ainsi écartées les questions et modalités redondantes, trop rares ou mal renseignées : sur les 18 questions initiales, il en reste 12 (voir les annexes). Puis vient l’analyse des regroupements générés selon différents nombres de classes afin de faire apparaître la classification qui nous semble la plus pertinente. Comme bien souvent dans ce type d’utilisation des méthodes quantitatives, il ne s’agit pas de l’application mécanique d’un algorithme nous imposant ses résultats, mais d’une démarche presque artisanale : se met en place un dialogue où éléments statistiques et connaissance empirique des données viennent enrichir et « cristalliser » progressivement un résultat pertinent.
Tandis que ces ajustements s’opèrent nous nous apercevons de l’hétérogénéité des projets déclarés, ce qui confirme le sentiment éprouvé avant de démarrer l’enquête. Ici, leur disparité est telle qu’il serait possible de définir jusqu’à douze classes différentes. Pour des soucis de lisibilité et de pertinence, nous préférerons nous arrêter à une classification en sept groupes.
Le graphique suivant (image 2) montre une « cartographie » des classes retenues permettant de visualiser les projets et leur groupe d’appartenance. Il faut interpréter ici la position des points non pas en termes de distance mais en termes de proximité : les projets d’un même groupe sont proches les uns des autres, et les groupes eux-mêmes sont proches des groupes qui leur « ressemblent » le plus. Enfin, si certaines classes peuvent se distinguer des autres par une caractéristique spécifique (l’utilisation de la bande dessinée par exemple) d’autres peuvent se différencier de manière plus globale (comme les projets visuels totaux). C’est l’intérêt de la méthode de prendre en compte simultanément l’ensemble des caractéristiques des projets, et non certains traits pris isolément.
Image 1 - Cartographie des groupes20
© Julien Barnier, 2020
Bien sûr, il est important de préciser à nouveau que cette cartographie n’est pas généralisable au-delà du périmètre de notre laboratoire. Et même au sein de ce laboratoire, elle ne peut prétendre ni à l’exhaustivité, ni à une parfaite exactitude. C’est un outil, un tremplin pour faire émerger des réflexions sur les méthodes visuelles à partir d’une enquête réalisée à petite échelle.
Le groupe Explorer, enquêter, analyser par l’image est le plus conséquent puisqu’il rassemble douze projets (dont cinq projets de thèses) dans le cadre desquels l’image photographique (et parfois filmique) devient un instrument d’exploration, d’enquête, voire d’analyse. Dans plus de la moitié de ces projets, les images produites par les personnes rencontrées sur le terrain (photos de famille, profils sur des sites web…) intéressent celle ou celui qui mène la recherche. Et quand c’est la chercheu.re qui produit des images, il s’en sert aussi, en retour, pour restituer la recherche aux enquêté.es. Ces méthodes d’enquête et d’exploration visuelle font assez fréquemment (dans la moitié des cas) l’objet d’une publication théorique : la réflexivité sur la pratique méthodologique mise en œuvre semble donc importante aux yeux de celles et ceux qui portent ces projets.
Gabriel Uribelarrea (2016) rend compte d’une expérience de terrain menée dans le cadre de sa thèse au sein d’un centre de santé auprès de personnes sans-abri. Embarquant avec lui un petit lot d’appareils photographiques jetables, il propose à ses interlocuteurs ou interlocutrices de terrain de photographier ce qu’ils affectionnent, s’engageant par-là dans ce qu’il appelle, en référence à Isaac Joseph, une « ethnographie coopérative ». Par la suite, le jeune chercheur organise une exposition de ces photographies au sein du centre de soin. Ce projet met bien l’accent sur une dimension importante de ce groupe : l’exploration d’un terrain par l’image.
Le groupe suivant s’intitule Détour par l’image. Dans cette classe réunissant huit projets, pas de création d’image pour mener la recherche, plutôt l’utilisation d’images préexistantes, principalement des films. Il s’agit ici d’emprunter des supports visuels pour appuyer ou transmettre une réflexion, faire saisir un concept ou encore pouvoir discuter en dehors du laboratoire des questionnements qui se déploient en son sein. Ce groupe est intéressant car les projets qu’il réunit semblent appartenir aux coulisses (les aspects invisibilisés) des travaux en sociologies visuelles : où l’on tente de faire comprendre une notion à l’aide d’une série télévisée, où le ou la sociologue programme une projection-débat dans des lieux culturels…
Depuis 2017, le laboratoire s’associe au festival poitevin Filmer le travail en proposant chaque année une séance hors les murs de ce festival au cinéma le Zola (Villeurbanne). L’esprit du festival de Poitiers, qui croise les regards sur le travail dans le champ du cinéma et des sciences humaines et sociales, rencontre l’intérêt des sociologues du Centre Max Weber, en particulier dans l’équipe Travail, institutions, professions, organisations. La projection d’un film et de courts métrages (sélectionnés au préalable par des membres du laboratoire et des étudiant.es) est l’occasion de mettre en débat, avec un public large, des réflexions sociologiques autour du travail.
La classe intitulée Projets visuels totaux, réunit sept projets dits « totaux » car les images, ici, sont requises sur la totalité ou du moins une bonne partie des différentes étapes du processus de recherche (elles permettent d’explorer, d’analyser, de restituer, de publier, d’enseigner, de publiciser...). Les supports et formats mobilisés sont nombreux et variés (web, vidéo, article, événement, photo…), mais on peut noter une forte représentation des projets ayant donné lieu à la création d’un site web. Ce groupe se détache de l’ensemble des autres groupes dont les enjeux en termes de sociologies visuelles sont plus spécifiés. C’est le groupe de projets pour lesquels les porteuses ou porteurs ont répondu « oui » à presque toutes les questions de l’enquête parce que les images interviennent à plusieurs étapes, présentent de nombreux apports au projet scientifique, et permettent d’expérimenter, renouveler, tester en sociologie. D’une certaine façon, ce sont des projets qui mettent les méthodes visuelles en laboratoire, autrement dit qui ne cessent d’interroger et réinventer les façons dont les images peuvent servir une recherche.
À partir de 2014, deux sociologues du Centre Max Weber – Alain Battegay et Marie-Thérèse Têtu – mènent l’enquête auprès d’acteurs et de visiteurs de la prison Montluc. Entre 2008 et 2010, cette prison a été transformée en mémorial dédié à la seconde guerre mondiale. Ils décident de s’associer à des professionnel.les de l’image, notamment le réalisateur Éric Chevillard, et à des spécialistes en informatique – Pierre-Antoine Champin et Christine Michel – pour filmer l’enquête, mais aussi réaliser une plateforme web-documentaire interactive21. et un docu-fiction. Cela permet d’interroger les mémoires multiples du lieu et leurs représentations en compagnie de divers publics, et de faire apparaître que la prison a connu d’autres usages qui touchent aussi à la mémoire nationale, notamment la « période algérienne » entre 1958 et 1962. Cette représentation numérique de l’enquête permet aussi de produire des traces absentes du lieu topographique, traces sur lesquelles les publics dessineront leur propre chemin de navigation.
Les groupes intitulés BD sociologiques (deux projets), Collaborations photographiques (trois projets) et Collaborations filmiques (cinq projets), sont tous assez proches en termes d’enjeu, de format, et surtout sur le principe, central et moteur dans les trois cas, de la collaboration entre le ou la sociologue et un ou une professionnelle de l’image. Il s’agit ici de s’associer à des personnes compétentes pour rendre publics une recherche ou des questionnements issus de la recherche. L’enjeu est donc situé du côté de la publicisation de la recherche, de la communication ou de l’enseignement (et un peu du côté de l’enquête pour les Collaborations filmiques). La différence entre les groupes tient principalement au média employé : BD pour le premier, photographie pour le second, et plutôt vidéo ou film pour le dernier. Incarnons un peu ces groupes en présentant pour chacun l’un des projets classés.
La bande dessinée Patience, prudence et petits pas est présentée comme suit par ses auteurs et autrices22 : « Cet ouvrage est le fruit d’une recherche-action partie du constat qu’il est nécessaire de rénover les modes d’action des travailleurs/euses sociaux/ales. L’initiative, commencée en septembre 2016, a fait dialoguer pendant deux ans des sociologues du Centre Max Weber, un illustrateur de bande dessinée et une trentaine de praticien.nes du travail social et médico-social, tou.tes rassemblé.es au sein du collectif Métis23 ». À travers ces quelques lignes, on entrevoit la dimension collective et interdisciplinaire de l’expérience, tout comme l’enjeu politique, puisque l’ouvrage contribue à un travail préparatoire de réflexion pour la métropole de Lyon dans l’optique de financer des projets dans le secteur du travail social et médico-social.
Le projet Cravat est porté par des sociologues du travail du Centre Max Weber24, des juristes du CERCRID et le photographe David Desaleux. Sur la base d’une série d’enquêtes de terrain et de photographies, il s’agit de s’interroger sur le vêtement au travail. Le projet, encore en cours, veut aboutir à une exposition accessible à un large public (bien au-delà de la communauté universitaire) et à la production d’un catalogue associé. Si ce projet adopte une autre forme que la bande dessinée décrite précédemment et poursuit un enjeu sensiblement différent, il repose toutefois sur les mêmes grands piliers : à savoir l’aspect collectif et interdisciplinaire, mais aussi l’idée de donner aux travaux sociologiques une place dans la Cité.
Reposant toujours sur ces mêmes piliers, le groupe des Collaborations filmiques peut être incarné par le film Ciao Bashiru25 pour lequel la sociologue Francesca Quercia a collaboré avec le réalisateur Théo Charamond. Pendant plusieurs années, en Italie, le binôme suit un collectif de migrants et rencontre Bashiru, qui contribuera à l’élaboration du film. Le documentaire, qui voyage désormais dans des festivals, retrace un bout de son parcours.
La classe intitulée Analyse sociologique de l’image, comprend deux projets aux caractéristiques très spécifiques. Ici, les sociologues procèdent à une analyse d’images en mobilisant leur « grille de lecture » disciplinaire. L’exercice est effectué dans le cadre de leurs recherches mais aussi dans le cadre d’enseignements.
Le projet autour du logiciel Advene26, porté par Marie-Thérèse Têtu en collaboration avec le chercheur en informatique Pierre-Antoine Champin, le vidéaste Gaëtan Bailly et moi-même est l’un des deux projets concernés. Il consiste à inventer et tester un usage spécifique de ce logiciel dédié à l’annotation vidéo dans le cadre d’un cours en master de sociologie27. Le corpus de films annoté est issu des fonds de la cinémathèque de Saint-Étienne et permet l’étude des représentations du colonialisme et de l’immigration au fil du temps, exercice qui s’inscrit dans le cadre d’une sociologie de la mémoire. Plus largement, cet exercice initie les étudiant.es à l’usage de l’image (les leurs et celles produites par d’autres).
Quels enseignements tirer de cet examen ? Il s’est agi de décrire des pratiques selon les principales caractéristiques déclarées par leurs auteurs et autrices, et de les regrouper ensuite à partir de leurs ressemblances. La classification ainsi obtenue n’est pas généralisable, mais il y a, au travers de celle-ci, un paysage qui s’est redessiné. Ce dernier fait émerger des tropismes ou traits saillants quelque peu différents de ceux qui se seraient formés si l’on avait procédé en cherchant à « ranger » ces pratiques dans des catégories prédéfinies. C’est la « géologie » nouvelle des pratiques – géologie qui met en lumière quelques endroits ou dimensions habituellement ombragés – dont il est possible d’extraire des pistes de réflexion plus large au sujet des sociologies visuelles.
Trois aspects apparaissent comme des dimensions saillantes des pratiques dans les résultats de notre enquête alors qu’elles sont rarement présentées comme telles dans la littérature du domaine.
Le premier aspect a trait à la réflexivité méthodologique dont font preuve les sociologues empruntant les méthodes visuelles. Dans notre laboratoire, il a d’abord été possible d’observer que même lorsqu’elles se cantonnent à un usage « exploratoire » de l’image, les personnes qui emploient les méthodes visuelles font preuve d’une grande réflexivité à l’égard de leur propre pratique. La description du premier groupe en témoigne, mais aussi le fait que la majorité de celles et ceux ayant réalisé un film ou une vidéo pour leur projet publie également un article sur la question28. Il semblerait que les sociologues du domaine doivent produire un métadiscours important pour que leurs travaux aient le « droit de cité ». Mais au fil du temps, cette attitude réflexive n’est-elle pas devenue une dimension à part entière de ces méthodes, une sorte d’attendu du milieu ? Le fait de commenter et mettre en perspective ses propres pratiques ne pourrait-il pas déclencher ce sentiment partagé d’expérimenter, d’être créatif et inventif dans le domaine ? Voilà en tout cas quelques pistes, encore floues en l’état, que notre enquête inviterait à creuser.
Le second aspect mis en relief est relatif aux collaborations pluridisciplinaires (notamment les rencontres entre pratiques artistiques et scientifiques). Si cette dimension n’est pas tue dans la littérature du domaine, elle n’est pas non plus présentée comme une de ses principales caractéristiques. Pourtant, à l’échelle du laboratoire, elle semble concerner de très nombreux travaux : cela représente 26 projets sur les 39 déclarés. En outre, trois groupes de notre cartographie se caractérisent par des formes collaboratives de ce type. Au regard de ma propre pratique et à en croire ces résultats, ce chantier n’a rien de secondaire en termes de méthodes visuelles. Un certain « savoir-faire collaboratif » constitue même, je crois, l’une des principales compétences à acquérir pour leur mise en œuvre. De quelle façon dialoguer avec la personne chargée de monter des images tournées pour une recherche ? Comment opérer un véritable croisement des regards entre un.e photographe et un.e chercheur.e ? Comment les préoccupations d’un.e ingénieur.e du son peuvent-elles rencontrer celles du ou de la chercheur.e en sciences sociales ? Les réponses adviennent chemin faisant, mais devraient s’enrichir de réflexions élaborées collectivement. Les débats sur les croisements art-science émergent récemment dans le secteur des sociologies visuelles (ils adviennent un peu plus tôt en anthropologie29). Au moment d’écrire ces lignes, je dénombre trois appels à communication lancés sur le sujet, émanant des Interrogations, Ethnographiques.org et de l’antiAtlas Journal, et la naissance d’un groupe de travail sur le sujet au sein de l’Association internationale des sociologues de langue française.
Une troisième dimension peu discutée des pratiques en sociologies visuelles apparaît dans les résultats de notre enquête, notamment avec le groupe intitulé Détour par l’image : la forme évènementielle. Vingt projections-débat et deux expositions ont été déclarées dans notre questionnaire. Il y a donc eu, au total, vingt-deux évènements associés à des projets de recherche. Ce nombre est considérable, d’autant qu’il n’intègre pas les évènements ayant lieu dans le cadre de séminaires ou d’ateliers du laboratoire. Il y a dix ans, la sociologue Anne Jarrigeon s’étonnait déjà du manque de commentaires sur ces temps forts des projets visuels : « L’image photographique […] n’a pas vraiment conduit à une réflexion portant sur les conditions de sa monstration. Cet article vise l’analyse des implications théoriques et des conséquences pratiques de cette étonnante mise sous silence. » (2013, p. 158)
Cinq ans plus tôt, Monique Haicault signalait la même impasse du côté des formes filmiques : « Le documentaire ou l’article vidéo donne l’occasion à un public relativement large de débattre en commun à partir de l’expérience des personnes. […] Cette technique est loin d’être admise comme valable dans le milieu de la recherche. » (2007, p. 19)
Tout se passe comme si cette dimension ne faisait pas partie de la pratique de recherche, comme si elle ressortait d’une sphère distincte, moins légitime aux yeux des chercheur.es. Pourtant, réfléchir à cette étape et à son déroulement peut être un exercice fertile. Quand elle advient sur le terrain, sa mise en place peut provoquer de situations de retours très utiles, car potentiellement productrices d’un effet rebond bénéfique (Deshayes, 2013 ; Drouet, 2014). La multiplication des approches de socio-anthropologie partagée (encore appelées démarches collaboratives ou participatives) et le souci de plus en plus marqué d’inscrire l’activité de recherche dans la sphère publique sont autant de lentes transformations de nos disciplines qui favoriseront peut-être un regain d’intérêt pour examiner et mieux cerner les potentialités de ces moments où l’on prend le temps et le soin de montrer.
Le résultat peut-être le plus marquant de cette enquête réalisée au Centre Max Weber est de rendre apparent le fait que les recours aux méthodes visuelles peuvent ne pas être revendiqués tout en étant foisonnants et variés dans les pratiques de recherches. L’enquête menée dans le laboratoire aura contribué à montrer l’ampleur de ces pratiques souterraines (le nombre de projets déclarés – 39 – dans le questionnaire adressé à notre laboratoire suffisant déjà à en témoigner) et à commencer à les décrire. Après leur « mise à plat », la description des pratiques met en évidence des éléments de relief : la réflexivité, les collaborations art/science et la forme évènementielle deviennent saillantes.
En outre, cette autre géologie du paysage des méthodes visuelles incite à tracer avec plus d’insistance des sillons entre les pratiques, en les reliant entre elles et en veillant à bien les arrimer au processus de recherche et à ses divers enjeux. Le fait, par exemple, que la classification obtenue ne réponde pas à un découpage par média met en évidence l’existence de pratiques méthodologiques communes d’un médium à l’autre et invite à des rapprochements entre des pratiques parfois conçues et discutées séparément.
Les propositions énoncées ici vont dans le sens de la redynamisation et du décloisonnement plus général du domaine des méthodes visuelles en sciences humaines et sociales qui s’opère actuellement. Cela se lit notamment avec le lancement de travaux ambitieux, tel que le programme FRESH (Raoulx, 2018) et le colloque éponyme, une littérature sur ces méthodes qui recommence à se structurer et se décloisonner dans le domaine français (Bouldoires et Reix, 2017), la réactivation du débat autour de la recherche-création et le développement des perspectives autour des « sensorialités » (Pardoen, 2017 ; Montero, 2020) ou des « nouvelles écritures » (notamment proposées par le Centre Norbert Élias) qui invitent à appréhender la question de ces méthodes d’une autre façon. On note également la multiplication d’initiatives telles que celle de l’association Le Tamis à Marseille.
Peut-être traversons-nous un nouveau temps fort collectif, tel que celui décrit par Monique Haicault (2010) autour du « Réseau pratiques audiovisuelles en sociologie » mis en place courant 1986 ? Si tel est le cas, gageons que cette belle dynamique se poursuivra, s’intensifiera, se sédimentera sans se figer et saisissons la balle au bond pour reposer la délicate question de la transmission et de la cumulativité de ces précieux savoir-faire.
Je remercie Marie-Thérèse Têtu pour nos nombreux échanges qui m’ont donné l’impulsion (et de l’inspiration) pour la rédaction de cet article. Je remercie également Julien Barnier pour la réalisation de la classification, mais aussi pour son aide dans la rédaction et mise en place du questionnaire, puis de son analyse. Cette enquête, tout comme cet article, n’aurait pas pu voir le jour sans sa contribution. Je remercie enfin Emmanuelle Santelli pour sa précieuse relecture.
1 Je préfèrerais ici l’usage de la locution « sociologies visuelles » au pluriel, considérant, dans le sillage de Pierre-Marie Chauvin et Fabien Reix (2015), qu’elle permet d’embrasser les pratiques dans leur diversité.
2 Avec par exemple les travaux issus du « Réseau pratiques audiovisuelles en sociologie » mis en place en 1986 et dont Monique Haicault est une des principales instigatrices. Plus récemment, et parmi d’autres, on peut citer les travaux de Joyce Sebag et Jean-Pierre Durand à Évry (2020).
3 Approches qui, entre autres publications notables, ont fait l’objet d’un manuel proposé par Sylvain Maresca et Michaël Meyer (2013).
4 Titulaires et associés, tous statuts, en janvier 2019.
5 Le Centre Max Weber est issu du regroupement, au 1er janvier 2011, du GRS à Lyon et du MODYS, lui-même produit du regroupement en 2007 du CRESAL à Saint-Étienne et du GLYSI-SAFA à Lyon.
6 Pour découvrir ces travaux et avoir un bon aperçu de leur teneur, on pourra se référer à l’article de synthèse publié par Bernard Ganne en 2013.
7 Autour des travaux en images animées, voir notamment Maurines 2012.
8 Le laboratoire est rattaché institutionnellement au CNRS, à l’ENS de Lyon, à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et à l’Université Lyon 2.
9 Ce projet de lien entre le laboratoire et l’IRAM sera avorté peu de temps après mon arrivée, je ne peux donc donner plus de précisions sur sa teneur.
10 Le chiffre est ramené à 122 si l’on compte uniquement les titulaires (tous statuts).
11 Convaincue personnellement des vertus d’une pratique spectatorielle pour la recherche sociologique, je monterai un atelier de visionnage en décembre 2018, les « Rendez-vous doc’ » du Centre Max Weber.
12 Ce paragraphe est extrait de la présentation du projet scientifique de la Revue française des méthodes visuelles : http://rfmv.fr/projet-scientifique/.
13 Ma traduction de la présentation sur le site de la revue : http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rvst20.
14 André Gunthert est l’un des principaux acteurs du développement des études visuelles francophones, il occupe actuellement la chaire d’histoire visuelle de l’EHESS.
15 Monique Haicault, retraçant l’histoire d’apparition de ces méthodes en France, note déjà que « dans un article pionnier, [paru en 1970] “L’expérimentation audiovisuelle comme moyen de collecte de données”, Marie-Thérèse Duflos présente les nombreux avantages de l’image pour la recherche » (Haicault, 2010, p. 3).
16 Description de l’axe en question sur le site du laboratoire : http://www.centre-max-weber.fr/Axe-Sociologies-visuelles-Recherche-images-ecritures.
17 Pour découvrir ces questions, je renvoie à la liste proposée en annexes (à noter que n’y figure que 12 questions sur les 18 posées).
18 Il n’est malheureusement pas possible de ramener ce chiffre à un nombre total de projets sur la période car nous ne disposons pas d’un moyen fiable pour l’évaluer.
19 Cette analyse s’est faite via une analyse des correspondances multiples (ACM) appliquée aux réponses au questionnaire, suivie d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) calculée à partir des quatre premiers axes de l’ACM.
20 Pour faciliter la visualisation de la classification, on a représenté les groupes et leurs positions relatives en utilisant un autre algorithme de réduction de dimensionnalité (UMAP), toujours appliqué aux quatre premiers axes de l’ACM.
21 Voir la plateforme Montluc, Mémoires multiples : http://www.patrimonum.fr/montluc/.
22 Je reprends ici le texte de présentation de l’ouvrage publié sur le site du laboratoire : https://www.centre-max-weber.fr/Patience-prudence-et-petits-pas-A-la-recherche-du-sens-du-travail-social-et.
23 Au Centre Max Weber, on compte quatre membres de ce collectif : Lucie Lechevalier-Hurard, Bertrand Ravon, Bénédicte Rivet, Pierre Vidal-Naquet.
23 Au Centre Max Weber, on compte quatre membres de ce collectif : Lucie Lechevalier-Hurard, Bertrand Ravon, Bénédicte Rivet, Pierre Vidal-Naquet.
24 Le projet est porté par Estelle Bonnet et douze autres membres du laboratoire y participent.
25 Théo Charamond et Francesca Quercia, 2018, Ciao Bashiru, documentaire, 74 min.
26 Le logiciel est présenté sur le site : https://www.advene.org/.
27 Il s’agit du master « Formes et outils de l’enquête en sciences sociales » de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne.
28 Plus précisément, on dénombre neuf publications liées à un film ou vidéo et trois productions filmiques ou vidéographiques sans article associé.
29 En anthropologie, cette réflexion prend racine plus tôt car les expérimentations en la matière sont plus anciennes, notamment du fait des nombreux liens de la discipline avec les institutions muséales mais aussi de son « penchant visuel » plus précoce (Piault, 2000).
BAJARD Flora (2017), « Les usages “sauvages” de l’image. Retours sur une expérience profane de la sociologie visuelle », Images du travail, travail des images, 3, [en ligne] https://journals.openedition.org/itti/1065.
BELKIS Dominique, PERONI Michel (2015), « La mémoire désidentifiante. », EspacesTemps.net, [en ligne] https://www.espacestemps.net/articles/la-memoire-desidentifiante/.
BOURDIEU Pierre (2003), Images d’Algérie. Une affinité élective, Arles, Actes Sud, coll. « Archives privées ».
BOULDOIRES Alain, REIX Fabien (2017), « Édito-manifeste », Revue française des méthodes visuelles, 1, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/1/manifeste/.
BOULDOIRES Alain, MEYER Michaël, REIX Fabien (2018), « Introduction. Méthodes visuelles : définition et enjeux », Revue française des méthodes visuelles, 2, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/2/introduction/.
CHAUVIN Pierre-Marie, REIX Fabien (2015), « Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche », L’Année sociologique, 65, p. 15-41.
COLLECTIF METIS (2019), Patience, prudence et petits pas. À la recherche du sens du travail social et médico-social, Saint-Fons, Métropole du Grand Lyon.
DESHAYES Patrick (2013), « Trois expériences filmiques pour interroger l’anthropologie visuelle », Mondes contemporains, 3, p. 41-64.
DROUET Jeanne (2014), La “performance contée” à l’épreuve des technologies audiovisuelles. Des passerelles culturelles et sociales en images et en sons, thèse de doctorat, Université Lyon 2.
DROUET Jeanne (2015), « Pour une anthropologie partagée avec les artistes du numérique », in MAZZOCCHETTI Jacinthe, SERVAIS Olivier, BOELLSTORFF Tom, MAURER Bill (dir.), Humanités réticulaires. Nouvelles technologies, altérités et pratiques ethnographiques en contextes globalisés, Louvain-la-Neuve, Academia (L’Harmattan), coll. « Investigations d’antropologie prospective ».
GANNE Bernard (2013), « La sociologie au risque du film : une autre façon de chercher, une autre façon de documenter », ethnographiques.org, 25 [en ligne] https://www.ethnographiques.org/2012/Ganne.
GOODY Jack (1979), La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit (1re éd. 1977).
HAICAULT Monique (2000), « Compter, écouter, observer, montrer », in HAICAULT Monique (dir.) L’expérience sociale du quotidien. Corps, espace, temps, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Théorie sociale », p. 161-198.
HAICAULT Monique (2007), « Les femmes, le droit à l’espace et à la politique urbaine : une approche par l’image de trois villes : Rennes, Marseille, Liège », in TAHON Marie-Blanche et WIDMER Cécile (dir.) Les femmes entre la ville et la cité, Montréal, Les éditions du remue-ménage, tome 3, p. 17-27.
HAICAULT Monique (2010), « La méthodologie de l’image peut-elle être utile à la recherche en Sciences Sociales ? » [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00498016 (1re éd. 2002, Sociedade e Estado, 17 (2), p. 529-539)
HARPER Douglas (2002), « Talking about Pictures: A Case for Photo Elicitation », Visual Studies, 17 (1), p. 13-26.
JARRIGEON Anne (2013), « Projeter, exposer, publier… Comment montrer ses photographies en sciences sociales ? », La sociologie par l’image, p. 157-169.
LA ROCCA Fabio (2007), « Introduction à la sociologie visuelle », Sociétés, 95 (1), p. 33-40.
MARESCA Sylvain, MEYER Michaël (2013), Précis de photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Didact sociologie ».
MAURINES Béatrice (2012), « Le film de recherche comme processus d’action. Contextes de production incertains et construction des publics », Journal des Anthropologues, 130-131, p. 235-259.
MIGNOT-LEFEBVRE Yvonne (1992), « Le cinéma sociologique existe-t-il ? », Journal des anthropologues, 47-48, p. 87-100.
MONTERO Hugo (2020), « Troubler l’expérience sensorielle. De l’utilisation de la réalité virtuelle en anthropologie », Parcours anthropologiques, 15, p. 106-126.
NAVILLE Pierre (1966), « Instrumentation audio-visuelle et recherche en sociologie », Revue française de sociologie, 7 (2), p. 158-168, [en ligne] https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1966_num_7_2_1113.
PARDOEN Mylène (2017), « Archéologie du paysage sonore. Reconstruire le son du passé », Revue de la BNF, 55 (2), p. 30-39.
PÉQUIGNOT Bruno (2006), « De l’usage des images en sciences sociales », Communications, 80, p. 41-51.
PIAULT Marc Henri (2008), Anthropologie et cinéma. Passage à l’image, passage par l’image, Paris, Téraèdre (1re éd. 2000).
RAOULX Benoît (2018), « L’interdisciplinarité par la création en cinéma documentaire. Retour sur l’expérience du programme FRESH », Revue française des méthodes visuelles, 2, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/2/articles/02-creation-en-cinema-documentaire-et-recherche-en-shs.
SANTELLI Emmanuelle (2019), « L’analyse des parcours. Saisir la multidimensionnalité du social pour penser l’action sociale », Sociologie, 10 (2), p. 153-171.
SEBAG Joyce, DURAND Jean-Pierre (2020), La sociologie filmique. Théories et pratiques, Paris, CNRS Éditions.
TRUONG Fabien (2015), « Le Goût des autres : sociologie des intentions et intentions sociologiques », L’Année sociologique, 65, p. 125-147.
URIBELARREA Gabriel (2016), « Ethnographie coopérative et photographique : retour sur une enquête avec des personnes sans-abri », résumé d’intervention, Rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS, [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01404055/document.
VANDER GUCHT Daniel (2017), Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les impressions nouvelles.
ZUEV Dennis, KRASE Jerome (2017), « Visual sociology », Sociopedia.isa, [en ligne] https://www.isaportal.org/resources/resource/visual-sociology
Dans ce projet, vous travaillez…
Dans ce projet, vous intéressez-vous aux images produites par les acteurs de terrain (images issues du web, archives personnelles…) ?
Quel(s) média(s) est (sont) concerné(s) ou mobilisés ?
Quel(s) outil(s) logiciel(s) avez-vous employé(s) ?
Quel(s) support(s) a (ont) été créé(s) dans le cadre de ce projet ?
Quel(s) format (s) ont été mis en place dans le cadre de ce projet ?
Quel(s) moment(s) du processus de recherche est (sont) principalement concerné(s) ?
Avez-vous initié de nouvelles pratiques, techniques ou méthodes dans le cadre de ce projet ?
Toujours sur le plan méthodologique, considérez-vous que votre démarche est expérimentale ?
Ce projet a-t-il donné lieu à la production d’une réflexion théorique concernant l’image, les méthodes visuelles, ou les « nouvelles » écritures de la recherche ?
Ce projet a-t-il sollicité des compétences spécifiques en termes de lecture et d’analyse d’images (sémiologie, analyse filmique…) ?
Ce projet a-t-il entraîné une ou des collaboration(s) avec un professionnel de l’image ou du son, un professionnel du web, un informaticien ou avec un artiste ?
Jeanne Drouet, « Les images au labo. Les méthodes visuelles à l'échelle d'un laboratoire de sociologie », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 5 | 2021, mis en ligne le 9 juin 2021, consulté le . URL : https://rfmv.fr