

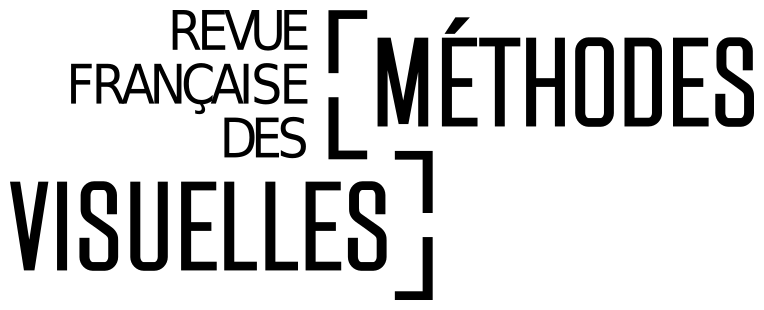
Jordan Fraser Emery, Doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université Savoie Mont-Blanc, LLSETI
En partant d’un travail de recherche mené dans un cabaret burlesque et queer, nous proposons la mise en lumière d’une démarche méthodologique hybride. Celle-ci mobilise une observation participante couplée à un dispositif de captations audiovisuelles engageant une caméra classique et deux caméras 360°. Aussi bien par son intention que par sa forme, la méthodologie discutée nous intègre en tant que chercheur dans le cercle dans lequel évoluent les participants de notre terrain de recherche, avec le souci d’une réflexivité. Une participation active sous forme de collaboration permet d’évoluer avec la troupe dans les coulisses du cabaret ainsi que sur scène avec la participation, en corps à corps, à une part de la performance de l’artiste suivi. Cette hybridation de méthodes visuelles trouve son acmé dans la production d’une expérience en réalité virtuelle. Production immersive qui restitue et fait vivre à l’observateur, autant par le visuel que par le gameplay, l’intersubjectivité de la recherche – une manière d’être-à-la-recherche.
Mots-clés : Observation participante, Caméra 360, Queer, Réalité virtuelle, Genre
Based on a research work carried out in a burlesque and queer cabaret, we aim to highlight a hybrid methodological approach. This one mobilizes a participant observation coupled with an audiovisual capture device involving a classic camera and two 360° cameras. As much by its intention as by its form, the discussed methodology integrates us as a researcher in the circle in which the participants of our research field evolve, with the concern of reflexivity. Active participation in the form of collaboration allows us to evolve with the troupe behind the scenes of the cabaret as well as on stage with the participation, in body-to-body, in a part of the performance of the artist being followed. This hybridization of visual methods finds its apex in the production of a virtual reality experience. An immersive production that restitutes and engages the observer, both visually and through gameplay, in the intersubjectivity of research – a state of being in relation to the research.
Keywords : 360 camera, Participatory observation, Queer, Virtual reality, Gender
Début 2018, alors que le(s) corps et le(s) genre(s) sont toujours des enjeux politiques, nous nous intéressons aux corps et aux espaces contemporains qui ébauchent de nouvelles possibilités d’êtres ; des (contre)espaces dans lesquels les corps peuvent expérimenter et anticiper leurs possibles et leur devenir. L’artiste-performeur VRSUS DAS QUEER CAILLERA1, nommé par confort Vrsus, accepte en mars 2018 d’être suivi au sein de sa troupe de cabaret à Bruxelles, la BÉNÉDICTION – Rituels exceptionnels2.
L’une des premières propositions d’importance à avoir affleuré quant au concept de genre (gender) est celle de l’anthropologue étasunienne Margaret Mead, à la fin des années 1920. Avec ses travaux, elle propose de distinguer le sexe biologique du rôle social qui lui est attribué. Dans la continuité, les nommées vagues féministes occidentales, et notamment celle de la seconde vague à partir des années 1970, insistent sur la construction sociale du genre et sa réalité, avec comme enjeux la fin de l’oppression des femmes par les hommes ; les études de(s) genre(s) (gender studies) émergent. C’est au départ des années 1990 que les théoriciens et théoriciennes, ainsi que les militants et militantes revendiqués queer3 mettent en jeu de nouvelles manières d’aborder le(s) genre(s), le(s) sexe(s) et les identités. Les théories queer ont eu un important écho universitaire et médiatique, notamment celle programmatique de la performance/performativité (Butler, 2005, p. 248-276). Cette dernière est issue d’une certaine forme de performance, à savoir le drag. Le drag (e.g., drag queen, drag king et drag queer) détourne et performe hyperboliquement les caractéristiques que nos sociétés considèrent comme féminines ou masculines. Ce phénomène majoritairement occidental est étroitement lié à l’homosexualité et à la transidentité, et notamment à leur marginalité. Le genre comme performance et performativité irrigue depuis de nombreuses œuvres et recherches.
Pour la philosophe Judith Butler le genre est performatif (Butler, 2005, p. 250) en tant qu’il réalise ce qu’il énonce (i.e., « Un garçon ne pleure pas ! », « Attention ! Les filles sont fragiles »). Il est également une performance (p. 265) en tant que résultat d’un ensemble d’actes, de gestes (p. 259) et d’attitudes qui font référence à ce qui est sans cesse défini comme étant masculin et féminin. Ces définitions n’ont, dit-elle, aucun fondement naturel puisqu’elles ne sont que l’interprétation de dispositions biologiques dans un cadre social et culturel. Ainsi, l’identité tant sexuelle que de genre sont pour cette dernière des productions de réalité qui mimeraient et répéteraient des normes légitimées. Cette théorie se trouve être l’embrayeur théorique (Buob, 2017, p. 188) de notre recherche puisqu’elle est aisément mobilisable dans un contexte artistique ou militant, et les dernières années nous ont montré combien le genre comme performance avait égayé de nombreuses sphères avec toutefois, en parallèle, un détournement mercantile sans peine. Le cadre analytique que nous utilisons ici combine ainsi le travail théorique des études queer (queer studies) et des études de(s) genre(s), tant anglo-saxonnes que francophones et hispanophones, avec la littérature scientifique issue des sciences humaines et plus précisément desdites méthodes visuelles. Accompagné de ces autorités théoriques et sur le modèle de trois œuvres cinématographiques, nous discutons une observation participante filmée où l’image est pleinement investie dans le processus de recherche. L’objectif de cet article est de revenir sur un état d’être-à-la-recherche en appuyant une méthodologie expérimentale que nous qualifions d’hybride, cela en continuant à considérer l’objet initial de la recherche ainsi que ses résultats : l’observation d’un devenir-queer mis en scène. À partir de là, nous étudions les spécificités de la captation à 360° en entretenant un positionnement singulier vis-à-vis de la relation classique du filmant/filmé et de l’observateur/observé, ainsi que des duos champ/hors-champ et cadre/hors-cadre. Un retour sur notre observation participante active, ayant permis d’évoluer avec la troupe du cabaret, entamera l’exposé de la restitution de la recherche sous la forme d’une expérience expérimentale en réalité virtuelle. Une discussion sur notre statut de chercheur conclura ces développements.
Dans ce cabaret, nous développons au fil de l’eau une méthodologie de recherche que nous qualifions d’hybride. D’abord, par un dispositif de captations audiovisuelles engageant une caméra classique et deux caméras 360°, fixes et portables. Ensuite, par une intégration corporelle à notre terrain de recherche qui se formalise par une initiation sommaire à des pratiques propres au cabaret.
Placée dans la filiation d’une ethnographie sur, pour et avec les participants et participantes (Greco, 2018 p. 83), la méthodologie proposée et mobilisée se constitue et s’affirme par la volonté d’une proximité de recherche avec l’objet d’étude. Une proximité qu’on retrouve dans les trois œuvres artistiques et cinématographiques suivantes, et qui revêtent ici une importance particulière par leur avance, leur pertinence et leur audace. Commençons par considérer Paris is Burning (1990), documentaire de Jennie Livingston qui pénètre avec sa caméra – accompagnée d’une petite équipe de tournage – dans un bal drag (drag ball). S’inspirant des maisons de couture, la scène ball est l’un des milieux des communautés noires et latinos pauvres, gays, bis, lesbiennes, trans et travailleurs et travailleuses du sexe – mises à l’écart de l’opulence du New York des années 1980. Un endroit dans lequel ces derniers fantasment une vie autre, dans laquelle ils et elles auraient une meilleure position sociale. Véritable show de vraisemblance et de réalité (realness), l’objectif est de gagner le maximum de trophées en imitant une culture considérée comme blanche et bourgeoise. Apprécions ensuite le non-édité Will You Dance With Me? (1984) de Derek Jarman qui de manière expérimentale et particulièrement immersive plonge seul, caméra au poing, dans la nuit noire colorée du Benjy’s, club gay du Londres des années 1980. Chargé par son ami cinéaste Ron Peck de produire des images de recherche pour un de ses projets, Jarman file sur la piste de danse avec les clubbers et les clubbeuses, et apprivoise l’observation participante. Comme s’il n’y en avait pas, sa caméra se fait prothèse et nous plonge dans l’instant. Coextensive au corps, elle transmet les mouvements du réalisateur-danseur qui s’est mis à suivre les chorégraphies corporelles des bringueurs et des bringueuses. Cette réalisation participante butine, ici et là, des bribes de discussions et enregistre les corps des fêtards qui se cherchent sur la piste de danse. On la trouve également chez Nelson Sullivan, cinéaste officieux de la vie nocturne et diurne underground de la communauté LGBT de Manhattan à New York. De 1982 à 1989, bien avant l’essor des appareils médiatiques de poche et de la mise en exposition contemporaine de soi, Sullivan filme sa quotidienneté marginale sur plus de 1 900 heures4. Tournée vers lui, sa caméra est une orthèse avec laquelle il co-produit de nouvelles formes d’« apparaître ». La lentille grand angle de son caméscope tenu à bout de bras, agrippée par ses doigts dans la paume de sa main, distingue sa réalité marginale par un effet fisheye (œil de poisson) qui amplifie la présence de celles et ceux qui se trouvent alors enveloppés, et même envoutés, par sa caméra et son corps tout terrain. Au contraire de la caméra-prothèse avec laquelle Jarman fait corps, Sullivan affiche l’appareille qui l’accompagne. Sa caméra-orthèse l’assiste comme un témoin et l’aide à le re/placer5 lui et ses amis dans un paysage urbain rectiligne devenu terrain d’inventions et d’expérimentations onduleuses.
Caméra à la main ou à l’épaule, seul ou en équipe, les deux compositeurs et la compositrice d’images cités nous immergent dans d’autres multitudes, parfois le leur (e.g., Nelson Sullivan), avec leurs codes et fonctionnements propres. En captant, en accompagnant et en dévoilant des identités dissidentes en création, ces deux auteurs et cette autrice produisent une fluidité cinématique qui fait transpirer des images des points de vue sur le monde.
Une méthodologie a été sommairement fixée dans un temps de pré-recherche durant le mois de février 2018. Cette dernière a pris sa véritable consistance une fois sur le terrain, le jour et la nuit de la captation, entre le 11 et le 12 mars 2018. Sans avoir été déployée à l’aveugle, cette méthodologie élaborée dans et pour un espace non institutionnel, repose sensiblement sur notre intuition de chercheur débutant. En ce sens, et en paraphrasant Jean Rouch, nous nous sommes faits sur le terrain les praticiens d’une méthodologie que nous pensons aujourd’hui, par quelques aspects, innovante, sans en avoir été in situ consécutivement les théoriciens (Rouch, 1979a, p. 7). Ainsi, nous nous plaçons dans la lignée de chercheuses et universitaires telle que Benedikte Zitouni, qui à la suite de Donna Haraway, écrit que nous sommes invités « à construire une perspective à partir de points de vue qu’[on] ne connai[t] pas (encore), avec les résultats qu’[on] ne maîtris[e] pas (encore), dans un échange avec des inconnues qui [nous] aideron[s] à créer petit à petit un savoir digne d’être construit et revendiqué » (Zitouni, 2017, p. 4).
La conception de notre dispositif de captation s’est faite à l’époque dans une considération un peu éloignée de la réflexion entreprise pour cet article. En effet, avant de nous rendre sur le terrain de recherche, nous avions assez candidement la volonté de retranscrire de la manière la plus objective qu’il soit ce que nous allions étudier et capter sur place. Une volonté qui provenait d’abord des critiques à l’objectivité toujours portées à l’encontre des méthodes visuelles et également de débats relevés autour du documentaire discuté peu avant, Paris is Burning (1990) :
Jennie Livingston aborde son sujet avec un regard extérieur. Sachant que sa présence en tant que femme réalisatrice blanche/lesbienne est « absente » de Paris is Burning, il est facile pour les spectateurs d’imaginer qu’ils regardent un film ethnographique documentant la vie des « natifs » noirs gays et de ne pas reconnaître qu’ils sont en train de regarder une œuvre façonnée et formée par une perspective et un point de vue propres à Livingston. En masquant cinématiquement cette réalité (on l’entend poser des questions mais on ne la voit jamais), Livingstone ne s’oppose pas à la façon dont la blanchité6 hégémonique « représente » les expériences noires, mais assume plutôt une position de surveillance impersonnelle qui n’est en aucun cas progressiste ou contre-hégémonique. En tournant le film selon l’approche conventionnelle du documentaire et en ne précisant pas comment son positionnement rompt avec cette tradition, Livingston assume un rôle privilégié d’« innocence7 »
(Hooks, 1992, p. 151)
Si l’on suit le raisonnement de Bell Hooks il y aurait un souci d’explicitation de la position de la réalisatrice dans son propre documentaire. Celle-ci, en s’abstenant d’apparaître dans ses images, maintiendrait un supposé point de vue neutre et universel alors qu’il est celle d’une femme blanche filmant des personnes noires marginalisées qui imitent pour la plupart de riches femmes blanches. Cette critique rejoint le rappel fait par Lorenzo Ferrarini sur l’accent mis par la culture occidentale sur la vision qui, écrit-il, reste une modalité de savoir et de pouvoir (Ferrarini, 2017). Afin de minimiser autant que possible un tel écueil, convoquer notre corps dans nos propres captations nous paraissait alors capital. D’abord, pour expliciter au mieux notre positionnement (d’apprenti-chercheur) dans une possible visualisation de nos captations par un futur public, et également pour enrichir notre réflexivité. Enfin, la considération nous ayant amené à ce dispositif hybride a également été appuyée à l’époque par l’incertitude de l’espace dans lequel nous allions nous en servir. Serait-ce un espace connu ? Combien de temps aurions-nous sur place ? Pourrions-nous y retourner si nécessaire ? Autant d’indéterminations qui par un souci d’économie de temps et de moyen nous avait amené à penser avec la 360°. Seul, sans équipe de tournage et en totale autodidaxie avec du matériel de location, nous souhaitions pouvoir capter aisément le maximum d’images en un temps restreint.
À partir des captations faites au sein du cabaret durant son installation et pendant la répétition de la performance de Vrsus, nous allons considérer le déploiement de notre dispositif de captations audiovisuelles dans les espaces du bar qui l’accueille. Sont ainsi disposées trois caméras :
L’asthénie du traditionnel champ/hors-champs dans la caméra type 360° nous permet de ne pas échapper à la re/présentation de notre corps-filmant. Particularité de la démarche donc, notre corps de chercheur est filmé entrain de filmer. Cela on le conçoit aisément lorsque nous avons une caméra à la main (vidéos 1-2) : nous sommes filmés, en train de filmer caméra à la main la répétition de l’artiste, par notre caméra 360° qui filme également et en simultané ladite répétition et son environnement. Le plus désorientant est peut-être lorsque nous nous servons seulement de la caméra 360°, sans filmer avec un autre appareil, car nous énonçons ici pouvoir nous considérer également et conjointement comme chercheur-filmant et chercheur-filmé, cela par le simple fait de poser la caméra 360° à un endroit choisi. Cette inclusion du chercheur-réalisateur dans la représentation filmique est très justement discutée par Albà Marin Carrillo :
[...] une participation de la représentation dans laquelle le documentaliste s’inclut. C’est le documentariste qui décide d’abandonner l’observation lointaine pour interagir avec ce qui est représenté et montrer sa relation, sa façon d’agir et même sa propre image. Dans cette « participation », le pouvoir ne change pas de mains et n’est pas partagé ; c’est toujours le documentariste qui a le pouvoir de représentation et qui décide quoi et comment filmer8
(Marin Carrillo, 2019, p. 333)
Dans une captation faite à 360° nous, chercheur-réalisateur, continuons effectivement de détenir ce pouvoir de représentation (p. 333) qui fonctionne comme ce que nous nommons être une discrimination perceptive. Avec une caméra classique cette discrimination est opérée par le cadrage (i.e., ce qui se trouve en dehors du cadre n’est pas filmé) qui définit la portion d’espace-réel (le cadre), d’espace-représenté (le champ) et d’espace-suggéré (le hors-champ, là où se dissimule simultanément le dispositif technique qui échafaude l’image – le hors-cadre). Avec une caméra 360° qui capte la totalité de l’espace-réel qui l’entoure, avec plus ou moins de profondeur de champ (image 2), le déploiement technique n’est plus invisible et la discrimination perceptive opère par le choix même du positionnement de la caméra. Le cadrage ne disparaît pas avec la 360° mais est négocié à un autre niveau, celui du point depuis lequel la caméra filme. L’espace suggéré est alors déplacé à l’orée de la profondeur de champ. Ainsi, la 360° nous permet et même nous encourage à tenir compte de ce qui s’entrelace, et non plus à séquencer et à imaginer ce qui finalement se produit simultanément. Pour notre recherche cela correspond à un atout, car c’est une formidable opportunité de capter au maximum ce qui s’exprime et se manifeste hors de tout logos – par le truchement des corps et des images. Comme souligné avec Sullivan et son objectif grand angle, le cadre enveloppant de la 360° permet de saisir l’information qui habituellement reste hors-cadre (vidéos 1-2 et 4) et qui répond ici au hors-cadre d’une situation entendu comme un « flux de signes exclu en tant que tel du contenu de l’activité mais servant à la régler, à la contenir, à l’articuler et à en qualifier les diverses composantes et phases » (Heinich, 2020, p. 33).
Si l’illusion d’un regard libéré peut naître avec la 360°, titillant le désir d’une position quasi omnisciente et omnipotente, en mesure de tout capturer, et pourrait-on même dire de tout surveiller (i.e., tel un panoptique ou du fait de la forme des optiques de ces caméras, d’un « œil de Sauron9 »), il n’en est pourtant rien ! Une souplesse dans la visualisation 360° est effectivement octroyée par la capacité à s’orienter dans l’image autour d’un point pivot, ce qui fait s’actualiser le cadre du regard sans interruption de l’image (vidéos 1-2 et 4). Ce point pivot est un point de vue, celui depuis lequel nous avons positionné la caméra ; il est donc le lieu d’une énonciation. Ainsi pouvons-nous écrire que nos optiques 360° répondent à une politique de positionnement (Haraway, 2007, p. 122) qui vient simultanément troubler les relations classiques du filmant/filmé et de l’observateur/observé.
Soumis à la problématique habituelle du positionnement au sein du terrain de recherche, il nous faut nous faire re/connaître et également admettre au sein de ce cabaret. Notre méthodologie se développant avec une certaine volonté de proximité10 avec les corps présents, c’est de notre corps même, tel un passeport (Andrieu, 2011, p. 70) dont nous nous servons. Alors familiarisés le temps d’une courte après-midi avec l’équipe du cabaret, nous participons aux tâches restantes de l’installation et nous voyons proposer de disposer avec le reste de l’équipe de l’espace en mezzanine (les loges). Ainsi, immergé dans le groupe, nous développons petit à petit « une politique du terrain » (Olivier de Sardan, 1995, p. 17). C’est ainsi que vient se concrétiser ce qui n’avait été les jours précédents qu’une hésitante proposition de Vrsus dans une conversation en ligne préparant notre arrivée. S’apprêtant à répéter son numéro il nous fait part de la vision qu’il a de sa performance publique et de l’implication qu’il voudrait que nous ayons dans celle-ci. C’est en effet son envie d’étendre sa performance à un hors-scène, en la terminant parmi le public. Saisissant l’opportunité de nous impliquer en nous faisait encore davantage oublier en tant que chercheur, nous acceptons de participer à la fin de la performance de l’artiste et ainsi l’élever sur nos épaules afin de le faire évoluer – en corps à corps – au sein de la foule promise (image 4 et vidéo 1).
[...] la ciné-transe apparaît comme une notion complexe, instable, qui réunit plusieurs préoccupations : le cinéaste, en se métamorphosant, participe de la situation qu’il filme à condition d’engager son corps dans l’action avec la volonté de se libérer des théories anthropologiques et cinématographiques, et d’être intégré dans les représentations locales des personnes filmées
(Buob, 2017, p. 192)
Nous référer et nous placer dans la lignée de la ciné-transe est possible puisque cette dernière est une « pratique par laquelle le cinéaste a la possibilité d’épouser les rythmes de l’action et des corps » (Buob, 2017, p. 191). Ce rythme conjoint s’ébauche ici sans caméra à la main lors de la répétition et correspond très précisément à ce moment filmé de corps à corps avec l’artiste sur nos épaules – que nous renouvellerons lors de la performance publique. Le fait de ne pas avoir de caméra en main n’est pas un problème. Pour Ferrarini, la distanciation ponctuelle avec les instruments de prise de vue est même une condition préalable à un style d’enregistrement phénoménologique : le chercheur est plongé dans la complexité sensorielle de son terrain, au lieu de chercher l’isolement dans son dispositif (Ferrarini, 2017). Contrairement à Rouch – rapporté par Buob – qui affirmait être empêché de passer du côté de la transe notamment par le fait d’un rappel matériel constant (i.e., garder un œil sur son matériel et sa technique vidéographique telle que la mise au point, l’ouverture du diaphragme, etc ; Buob, 2017, p. 191), notre utilisation de caméras 360° allège cette exigence, assez pour nous permettre d’accompagner physiquement l’artiste dans son instant. Nous décidons alors qu’au moment de sa performance, nous prendrons en main la seconde caméra 360° afin de capturer ce passage avec lui dans la foule11 (image 5). Suivant ainsi les pas de Jean Rouch qui expliquait être un « ciné-Rouch » qui « ciné-marche » afin de mieux « ciné-matographier » (p. 200), nous sommes – en poussant l’analogie – un chercheur hybridé de ses caméras au schéma corporel augmenté et complété de l’artiste : un « ciné-chercheur-performeur ». Dans cette courte coalescence avec l’artiste que nous suivons s’esquisse une alliance entre sa pratique artistique et notre manière d’être à la recherche. Notre présence se transforme en « un fait culturel », objet de réflexion partagée (Lallier, 2018). En ce sens, Cecilia Sayad parle du rôle du réalisateur-chercheur comme d’un catalyseur d’événements et de comportements vis-à-vis des individus filmés (Sayad, 2013, p. 72). Elle énonce qu’il y a une évidente négociation entre la subjectivité du réalisateur et le monde prétendument objectif qu’il dépeint (p. 72). Cette alliance se poursuit dans les loges où nous continuons de nous initier aux activités de l’artiste et de sa troupe.
Dû à l’affairement général, au caractère éphémère de ce cabaret, à notre présence brève et précaire ainsi qu’à la perspective d’une utilisation dans des travaux à venir, c’est la captation d’images documentaires qui est privilégiée, au détriment d’entretiens étoffés menés sur place. Le corpus audiovisuel réalisé se compose d’un peu moins de deux heures de rushes – captés sur le vif. Il se compose de trois moments distincts de notre intégration dans la troupe : une courte après-midi d’installation et de répétition, un début de soirée en loge et le spectacle du cabaret. Un entretien téléphonique d’une trentaine de minutes animé le 3 février 2019 avec l’artiste – à la reprise de la recherche – vient épaissir ces moutures vidéographiques. À partir d’analyses produites depuis cet entretien et de nos observations de type ethnographique, nous proposons ici une interprétation resserrée des captations dans les loges puis sur scène lors de la performance de Vrsus. Ces analyses ont notamment considéré la maîtrise (ou non) par l’artiste d’un univers symbolique : les codes culturels et corporels12, tels que les actes et les vêtements – également la survivance des gestes et des images13.
Une pièce de quelques mètres carrés de long, annexe de la mezzanine, sert de loge secondaire ; nous y suivons l’artiste. Face au longiligne miroir qui habille cet atelier nous nous préparons à ses côtés. Nous installons la caméra 360° II sur la table face au miroir afin de profiter de sa réverbération (images 6-7 et vidéo 4). L’artiste se maquille. Non pour se déguiser, ni même pour se dissimuler, mais pour opérer excessivement par le maquillage un genre – des genres. Si nous suivons Butler, le genre n’a aucun original (Butler, 2005, p. 262) ; la philosophe nous invite à ne pas concevoir le genre comme une identité stable, mais comme « une identité tissée avec le temps par des fils ténus, posée dans un espace extérieur par une répétition stylisées d’actes » (p. 265). Petit à petit donc le performeur s’accapare ce qui nous semble correspondre à des signes archétypaux de la féminité occidentale contemporaine : une paire de talons, une culotte, un soutien-gorge et une jupe irisées ainsi que de longs cheveux blonds. Butler nous aide à préciser que ce qui s’initie ici – comme dans le drag de manière générale – n’est pas une parodie de la féminité, mais une parodie de l’idée d’original (p. 261) ; à comprendre comme ce qui se fait passer pour naturel : cette féminité que l’artiste commence à copier.
Cette pratique drag que nous approchons révèle, d’après l’autrice, que les identités (féminines/masculines) à partir desquelles le genre se construit sont des « imitations sans original » (Butler, 2005, p. 261), sans cesse imitées et inlassablement répétées dans le quotidien, et qui ici commencent à vaciller : « un ensemble de pratiques imitatives qui renvoient indirectement à d’autres imitations [...] un ensemble d’imitations qui habituellement construit l’illusion d’un soi genré originel et intérieur » (p. 262). Lorsque nous observons l’artiste, nous savons qu’il n’est pas une femme, mais parce qu’il stylise son corps, d’une manière très spécifique et bien apprise, nous ne pouvons nous empêcher d’en apercevoir par quelques bribes ce qui s’en rapproche, et surtout ce que nous en re/connaissons. Dès lors, ce qui se déroule lorsque nous nous apprêtons et nous maquillons ainsi avec lui dans cette loge transformée en un atelier de copie, relève d’une expérimentation partagée autour d’un « ensemble de méthodes et de pratiques artistiques queer, et en même temps, un mode de négociation et de passage à la sphère publique » (Lorenz, 2018, p. 40).
Dans ces conditions, il est intéressant de noter la relative contiguïté de la relation entre notre méthodologie bricolée intuitivement sur place et la pratique artistique drag de Vrsus. À l’instar du fisheye de Sullivan, nos captations 360° produisent un trouble dans les re/présentations (i.e., cavités noires et distorsion circulaire ; image 8) qui met en évidence une performance, ici technologique, de la réalité. Par notre méthodologie de recherche, c’est donc une flexion de la mise en re/présentation de la réalité que nous produisons. Une flexion indexée à l’altération des images par les objectifs de nos caméras 360°, mais également à notre implication corporelle dans les situations observées et filmées. Cette flexion de la réalité par notre méthodologie côtoie l’explicite flexion du genre produite par l’artiste lors de sa préparation dans les loges et plus tard lors de sa performance.
Ferrarini considère dans un élan phénoménologique l’acte filmique comme un « acte créateur », comme l’est la perception, dit-il, pour Merleau-Ponty (Ferrarini, 2017). Il ancre son raisonnement sur le travail ethnographique de Jean Rouch qui, explique-t-il, mobilise sa caméra « comme un système intégré [au corps] se rapprochant des personnes filmées14 » (Ferrarini, 2017). Il associe cette réalité particulière au ciné-œil de Dziga Vertov et qualifie ainsi la caméra d’organe technologique. Dès lors, notre distanciation physique dans la majeure partie de cette recherche avec l’appareillage 360° pourrait nous faire hésiter à tenter également un tel rapprochement organique. Néanmoins, nous suggérons et avançons que dotés de notre pouvoir de représentation, nos caméras 360° sont à appréhender comme des corps auxiliaires au nôtre. Nous envisageons nos captations sphériques comme des mondes affectés d’un sens calqué sur celui qu’il représente, tout en en déviant. Une réalité césurée mais étendue, c’est-à-dire toujours liée à l’expérience qui l’a vu naître. Cette puissance scopique qui fait que la vision n’a plus d’auteur directement identifiable permet une visibilité générale (vidéos 1-2 et 4). Par leur forme et leur esthétique nos captations 360° se font comme des nombrils, traces et centres d’une réalité. C’est donc, à travers l’épaisseur de ces images sphériques, et non pas malgré elles, mais avec elles qu’une certaine réalité de ce cabaret se crée de concert avec notre démarche de recherche. Par notre méthodologie même nous co-construisons à notre échelle une réalité qu’il faut assumer et considérer comme telle. Nos captations sont parties intégrantes d’un système à l’articulation réticulaire, où le chercheur se sent (et est) également regardé.
[L]e documentaire d’observation, et l’anthropologie filmée en particulier, s’attache à rendre compte de ce qui se joue dans une situation sociale (avec des acteurs sociaux) et non à faire jouer une situation théâtrale (par des acteurs) comme s’il produisait une mise en scène : sinon, on se situe dans un autre champ d’observation qui est celui de la performance théâtrale… ou de la télé-réalité !
(Lallier, 2018)
La distinction faite ici dans les champs d’observation par Christian Lallier est précieuse. Si, par notre observation participante filmée, il s’agit effectivement bien de rendre compte, comme il l’écrit, de ce qui se joue dans la situation sociale du cabaret pour notre artiste (e.g., dans les loges, etc.), il est judicieux de se questionner sur le champ d’observation dont il est cependant question lorsque Vrsus est sur scène. En effet, dans les loges il se prépare pour une performance que lui-même a composée et répétée. Cependant, comme en témoigne l’artiste, Vrsus n’est pas un rôle à incarner comme un acteur incarne un rôle. Sur scène il est Vrsus, prolongement scénique d’un soi qu’il compose :
Vrsus : [en parlant de sa pratique] c’est mon moyen de m’exprimer, avec un personnage fantasmagorique, de revenir sur des idées hyper sociales de base : égalitaire et féministe, et cetera. [...] Eliott est un homme. Eliott il est queer parce qu’il est Vrsus, mais euh dans la vie de tous les jours je suis un petit « pd » quoi ! VRSUS c’est plus qu’un homme et plus qu’une femme. En fait ça dépend des moments. Pour le moment je suis comme ça mais, il y a peut-être un moment où je serais un grand barbu *rire*.
(extrait d’entretien, 3 février 2019)
La performance de Vrsus ne rentre ici pas stricto sensu dans le champ de la performance théâtrale, puisque Vrsus et la personne qu’il est au quotidien semblent, d’après ses dires, répondre à un entrelacement, une écriture en acte, autrement dit un devenir (Deleuze et Guattari, 1991). En paraphrasant Lallier, il s’agit alors, dans la suite de notre recherche, de rendre compte de la mise en re/présentation de l’engagement de l’artiste dans un devenir, un devenir-queer écrivons-nous, médiatisé pour un temps sur une scène.
On le constate sur scène, il suffit que le performeur appose sur son corps masculin quelques pièces considérées comme féminines par notre regard socialisé pour que ce dernier esquisse d’autres significations (image 10). Ainsi, dans une considération phénoménologique nous pouvons avancer que les vêtements du performeur coexistent avec son corps. En habillant, et donc en prolongeant et en accompagnant son corps de vêtements, ce dernier obtient et intègre une sur-signification – une charge symbolique à laquelle concours la société. Suivant ce que l’artiste porte il est plus ou moins identifié comme étant masculin ou féminin. D’ailleurs, il suffit de constater que sa répétition et sa performance ne transmettent pas, à notre regard, le même résultat. Pour sa performance, il se réfère à des styles vestimentaires associés dans notre société occidentale aux femmes. Toutefois, il ne crée pas et ne vit pas le fait social quotidien d’être une femme. Comme le souligne Silvia Federici, une véritable réappropriation des identités de genre passe par un changement des conditions économiques qui les déterminent (Federici, 2020, p. 12) : « […] les identités sociales ne sont pas seulement des prisons où nous enferme un système hégémonique, ni des vêtements qu’il suffirait de déchirer, de retourner ou d’abandonner » (p. 73). L’artiste répond majoritairement ici à « une politique de la surface du corps » (Butler, 2005, p. 259).
En milieu de performance un tableau prend forme. Deux performeuses viennent apposer sur l’artiste un voilage (image 9). Ce tableau vient convoquer dans notre imaginaire la peinture de Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus (1484), et même The Rebirth of Venus (2009), photographie de David Lachapelle. Convocation assurément soutenue par la chanson Venus (Lady Gaga, 2013) sur laquelle l’artiste évolue en lip-sync15. Figure des plus appréciée dans l’histoire de l’art, la déesse Vénus a permis aux artistes hommes de fa/briquer et de re/présenter les canons de la beauté depuis leur regard16. Par une stratégie de l’apparence l’artiste fait ainsi excéder et couler sur son corps ces signes pour les détourner. Il puise, consciemment ou non, dans l’histoire et donc dans l’archive pour en ébaucher avec son corps une nouvelle narration. Le voilage petit budget avec lequel il vibrionne résulte d’un braconnage culturel (Certeau, 1990) opéré dans la mythologie grecque et romaine. Ce dernier symbolise une écume de mer contemporaine qui représente, dans les interprétations les plus courantes du mythe, ce par quoi naît ladite déesse17. Elle est ici l’allégorie de l’autoproduction en cours de l’artiste, celle de son devenir-queer. Nous écrivons que l’artiste détourne les signes, car nous envisageons le corps – d’une manière générale – comme évoluant dans des relations de domination et donc comme ayant la possibilité et l’incroyable agilité de pouvoir conduire des tactiques de braconnage, pour reprendre ce terme à Michel de Certeau. Ne pas tomber dans le piège de la résistance direct nous permet de mettre les logiques braconneuses, en usage dans la performance, en perspective de la pensée « radicante » de Nicolas Bourriaud, et dont la caractéristique est « l’habitation de structures existantes : accepter de devenir le locataire des formes présentes, quitte à les modifier plus ou moins fortement » (Bourriaud, 2009, p. 64). Une caractéristique qui se retrouve dans ce récit partiel établi par Vrsus avec le mythe de Vénus :
[...] l’artiste contemporain procède par sélection, ajouts, puis multiplications : il ne recherche pas un état idéal du Moi, de l’art ou de la société, mais organise les signes afin de multiplier une identité par une autre. [...] une sorte de métempsychose volontaire, préférant à toute incarnation le jeu des panoplies successives et des abris précaires
(Bourriaud, 2009, P. 59)
Pendant la majeure partie de la performance l’espace scénique et l’espace du public fonctionnent comme deux territoires séparés. La scène est cadrée par les deux colonnes qui la bordent et qui font office de bornes perceptives. Ce cadrage se retrouve dans les captations de notre caméra 360° I, placée à l’orée de l’espace scénique et de l’espace du public. Nous supposons dès lors une organisation tant implicite qu’explicite, que nous appuyons par une mise en abyme de notre caméra-cadre dans le cadre scénique (image 3). Comme discuté plus avant, placer à un endroit – plutôt qu’à un autre – c’est déjà informer, analyser et faire des hypothèses ; ici sur le rôle de l’artiste et sur celui du public, et donc sur ce qui cadre les expériences et également sur ceux et celles qui sont cadrés par celles-ci.
Le public, qui est le pendant de l’artiste et sa performance, ne participe jusqu’à lors qu’indirectement à l’action qui se déroule sur scène. Ce n’est que lorsque Vrsus quitte la scène pour nos épaules, lorsqu’il se décadre pour traverser la foule compacte du bar, qu’il débute une nouvelle forme de mise en relation avec l’Autre (vidéo 3). Alors qu’il effectuait sur scène une re/présentation, il brise l’équivalent du quatrième mur18 pour offrir la sincérité de son corps – il se donne à la touche du public. Ce faisant il se trouve réciproquement être un toucheur : un corps qui « presse l’autre de s’accorder à sa touche, de s’émouvoir à son contact et de ce contact même » (Nancy, 2006, p. 498). En se portant à la touche de son public Vrsus s’approche comme jamais il n’avait approché et été approché jusqu’à lors dans sa performance ; cela dans la plus grande des proximités, la peau : « [...] le corps touchant ébranle l’autre [...] Le corps touche, il émeut l’autre corps » (p. 498). Ce rapport touchant – touché et touché – touchant nous invite à faire référence à la notion de « contagion » telle que développée par l’artiste Renate Lorenz. La contagion, dit-elle, prend la place de la « reconnaissance », qui est un facteur essentiel de la normalisation : « […] contrairement à la représentation et à la réception, le mode de la contagion cherche à impliquer le.la spectateur.rice pour le faire participer à des pratiques dénormalisantes » (Lorenz, 2018, p. 33). La fin de la performance contamine ainsi les affects du corps des spectateurs et des spectatrices – l’exaltation est palpable. La distance entre le public et le performeur qui était maintenue par la scène et ses colonnes est rompue ! Notons ainsi que les colonnes qui en/cadrent la scène matérialisent le cadre im/matériel (i.e., les cadres sociaux) qui accorde du sens à la situation de la performance. Ce jeu de cadre, dirons-nous avec les mots de Nathalie Heinich, est en première instance une tentative de mise en cadre d’un devenir-queer qui est décadré (par rapport à la norme), mais également décadrant car prompt à mettre en crise les cadres familiers majoritaires et leurs évidences (Heinich, 2020, p. 108). Nous saisissons donc simultanément la performance de Vrsus comme un décadrage de la réalité binaire du genre et comme le cadrage d’un nouveau récit édifiant, braconné dans l’histoire de l’art et bricolé sur de la musique pop.
Vrsus : « [Je suis] dans le processus de Vrsus [...] mais l’idée ce n’est pas de faire croire que Vrsus c’est totalement moi. Il y a un « show off » et un « show on ». Et après c’est aux gens de trouver la barrière *Silence* et aussi ce qu’il y a côté c’est quand même le côté hyper inclusif, c’est-à-dire que Vrsus c’est quand même une grosse biatch, mais l’idée c’est pas que ça soit biatch contre toi, mais une biatch inclusive, on est biatch ensemble contre le monde. C’est juste ça. Parce qu’on est quand même dans une société patriarcale, gouvernée par des connards. Le personnage est totalement dans la société actuelle, et dans l’idée « caillera guérilla » !
(extrait d’entretien, 3 février 2019)
Nous suggérons que ce qui se joue dans ce hors-cadre est une analogie de ce qui se déroule dans le cadre du bar. Le cabaret fonctionnerait comme une zone de contact (contact zone ; Muñoz, 1999, p. 91), un espace d’hybridité qui favoriserait de nouvelles formations sociales. Ce peau à peau répond alors peut-être à la question de savoir comment le performeur peut-il habiter la réalité de celles et ceux qui l’ont touché, mais qui ne le regardaient au départ qu’à travers cette fenêtre – tel un écran. Ici ne prévaut ni le genre de naissance de l’artiste ni l’identité de son quotidien, mais l’identité revendiquée, bricolée et braconnée pour la performance, celle qui est célébrée par l’espace et le public qui s’y trouve. On assiste ainsi à une spectacularisation du devenir-queer qui, à la différence d’une spectacularisation seule et totale du corps de l’artiste, investit également et collectivement celui des spectateurs et spectatrices (images 1 et 11). Cette très courte expérience esquisse ainsi possiblement un commun puisque « [l]’importance de tels actes publics et semi-publics du moi hybride ne peut être sous-estimée par rapport à la formation de contre-publics qui contestent la primauté hégémonique de la sphère publique majoritaire19 » (p. 1). Un commun à co-construire puisqu’en se référant à José Esteban Muñoz, pour qui le queer est un idéal et une utopie (Muñoz, 2019, p. 26), le cabaret burlesque-queer dans lequel nous évoluons correspondrait à une spatio-temporalité capable d’envisager et de poser les fondements d’un futur queer, ou comme traduit assez joyeusement par les Canadiens une futurité queer. C’est-à-dire une spatio-temporalité qui offrirait la possibilité pour les minorités, et les corps vivants d’une manière générale, d’imaginer des formes de vies nouvelles ; d’autres manières d’être-au-monde.
Notre méthodologie de recherche nous place ainsi dans la foule avec l’artiste, également dans les loges face au miroir, comme partie intégrante des scènes d’observation. Scènes qui par notre présence même s’en trouvent modifiées. Si une telle alliance peut s’esquisser avec l’artiste, c’est que notre approche relève d’une « approche compréhensive » (Lallier, 2018). Lallier précise que cette approche phénoménologique implique de percevoir ce qui est vécu et également de percevoir notre rapport au monde. Notre état d’être-à-la-recherche trouve ainsi un écho dans la phénoménologie queer (queer phenomenology) de Sara Ahmed ; une phénoménologie qui implique, dit-elle, « une orientation vers le queer, une façon d’habiter le monde en donnant un “soutien” à ceux dont la vie et les amours les font apparaître dérangés, bizarres et pas comme il faut20 » (Ahmed, 2006, p. 179). En reprenant les mots de Zitouni nous pouvons également avancer qu’en ce qui concerne notre recherche et son terrain, il ne s’agit pas de nous positionner, ni même de nous situer, mais d’expliciter le monde queer qui nous appelle ici (Zitouni, 2017, p. 4-5) ; celui auquel nous répondons en nous y intégrant, en nous initiant à certaines de ses pratiques. Il s’agit également d’expliciter les mondes que nous suscitons, narrons et décrivons, en fabulant, dit-elle, car nous en dramatisons les dimensions intrigantes (p. 4-5), comme c’est le cas avec nos captations.
Dans cet environnement la pratique drag de Vrsus partage ainsi certains éléments de notre méthodologie. Les épisodes de l’entretien avec l’artiste discutés plus avant laissent effectivement penser qu’une auto-observation et une certaine réflexivité sur sa propre pratique l’amènent à des comparaisons et à des généralisations sur ce que représente le(s) genre(s) et la binarité de la société dans laquelle il évolue. Il n’hésite pas à évoquer sa pratique artistique par quelques aspects politiques, dans la mesure où celle-ci lui donne l’occasion de formuler et d’exprimer un point de vue sur le monde. Loin d’être dans une contestation et un étendard de revendications, la performance de l’artiste se veut être un « espace de productivité » (Muñoz, 1999, p. 79) d’une multiplicité de(s) genre(s), au sein d’un espace lui-même productif : le cabaret. Cet espace éphémère offre à l’artiste un espace pour « se situer dans l’histoire et en saisir l’agencement social » (p. 1). Toutefois, ce faire et ce défaire du genre, qui correspond à un dé/faire des liens qui déterminent la relation à l’ordre binaire, s’exprime dans un enchaînement qui apparaît très ordonné et confiné. D’abord, en loge, puis sur scène, le temps d’un cabaret qui ne semble pas mettre en tension la société en dehors de ses murs. Cette mise à l’écart ordonnée se trouve fixée dans nos captations (image 12) ; ces dernières produisent une re/présentation des conditions mêmes de la représentation21 de cette pratique drag. Par cette mise en re/présentation du réel que nous filmons, il s’agit maintenant d’expliciter le monde que nous cherchons ici « à comprendre et à construire en y prenant part et en l’écrivant » (Zitouni, 2017, p. 5).
Dans le cadre d’un master Création numérique22, une restitution de recherche, par un dispositif en réalité virtuelle (désormais abrégé VR), a été pensée et développée post-recherche. C’est une expérimentation toujours en développement, dont une première version a été testée sur quatre journées en septembre 2019 au World XR Forum. Nous souhaitons avec ce dispositif nommé RADICANT restituer et faire vivre à l’observateur, autant par le visuel que par le gameplay23, les résultats de recherche attenant aux chorégraphies corporelles spécifiques de l’artiste suivi et de sa troupe, et également de la place prise par notre corps de chercheur sur ce terrain. Cela avant tout pour nous permettre de prolonger le processus de restitution de la recherche au-delà du seul cercle universitaire, avec une production qui attire l’attention d’un public plus large, et ainsi participer à déconfiner les pratiques observés dans l’enceinte de ce cabaret bruxellois. Ce dispositif répond ainsi à l’appel de Zitouni qui écrit qu’après avoir mené une enquête « [...] il nous faut susciter à partir de cet appel et de cette connexion, des versions décalées et des mondes moins ordonnées par les axes de la domination » (Zitouni, 2017, p. 4).
C’est la captation de notre préparation avec Vrsus en loge (vidéo 4) qui esquisse la narration VR à l’utilisateur. Prenant virtuellement la place de la caméra 360° alors posée sur la table, ce dernier jouit d’une situation singulière. Impliqué dans un jeu de miroir dont il est le témoin favorisé, l’observateur se trouve mêlé au jeu de confusion des re/présentations qui a cours dans l’atelier. D’un côté, il fait face à la pratique drag de l’artiste que nous expérimentons à ses côtés. De l’autre, à 180°, il est engagé dans les réverbérations d’un miroir alors teinté des artefacts que s’apposent les corps d’en face. Séduisante mise en abyme, ce film dans le film laisse remarquer une couture dans la réalité : l’observateur se fait doubler par la caméra dont il a pourtant la place – anomiquement flotte la réalité (Heinich, 2020, p. 37). Avec cette sensation de pénétrer un espace improbable où s’opère devant lui un changement d’état, l’observateur est attrapé là où il pensait peut-être ne pas aller ; il se trouve socialement et culturellement engagé dans une situation re/créée.
L’intervention sur les rushes est réduite à de la correction colorimétrique et à un découpage en scénettes signifiantes : échanges entre artistes dans les loges, Vrsus sur nos épaules, etc. La navigation visuelle au travers du casque VR se fait physiquement par des mouvements de la tête et une rotation du corps. Toutefois, cela ne signifie pas, comme on peut le lire parfois, que l’observateur décide totalement et librement de ce qu’il regarde. Nous l’avons précédemment écrit, l’observateur se voit bien offrir une souplesse dans son observation, mais en ayant placé spécifiquement nos caméras 360° à un endroit, puis en ayant sélectionné certaines vidéos plutôt que d’autres, nous dirigeons celle-ci. L’orientation du regard autour d’un « point pivot24 » signifie, par contre, que certains événements secondaires à notre recherche peuvent devenir l’intérêt particulier de l’observateur, et à l’inverse les événements jugés capitaux dans nos analyses peuvent être négligés.
La disposition de nos caméras 360° participe ainsi à l’organisation de la signification et donc à l’implication de l’observateur ; une implication amplifiée par le format enveloppant de ces captations. D’après notre propre considération, à la manière des vidéos fisheye de Sullivan, l’observateur a l’impression d’une inclusion par procuration dans les scènes, d’y prendre part en tant que témoin et a le sentiment donc d’être présent. Un sentiment de présence accentué par l’absence d’un champ/hors-champ traditionnel qui permet à l’observateur de découvrir le flux de signes qui cadre l’action principale qui se déroule : des éléments et des actions qui auraient avec une caméra classique manqués à son regard. Une inclusion toutefois ambivalente puisque si l’observateur placé au centre des bulles 360° est virtuellement au centre de l’environnement, ce dernier ne lui permet pas d’interagir avec, ce qui précipite la sensation d’être un témoin extérieur à l’action. De plus, la présence dans les bulles ne se fait pas à l’échelle 1:1 ce qui procure la sensation d’un grandissement atmosphérique. L’observateur se trouve ainsi être un voyeur rétréci à la taille des objets (image 7 et vidéo 4), comme excusé de sa présence et pratiquement incorporé au tissu de ces images enveloppantes. Paradoxalement donc, les éléments qui communiquent l’immédiateté et l’immersion mettent également en lumière un décalage spatio-temporel intriguant. Enfin, la 360° qui pourrait par ses capacités avoir la prétention de fournir l’aperçu d’une expérience objective, se trouve ici immédiatement mise en trouble par l’esthétique de nos captations : la réalité de la présence même de l’observateur dans ces scènes est ambivalente. Cette ambiguïté de la réalité se trouve évidemment amplifiée par le déroulé des scènes et des jeux de confusions corporelles qui y opèrent. Ces vidéos dans lesquelles l’observateur est immergé ne sont pour lui jamais une expérience directe25 avec les objets et les corps, ce qui lui laisse l’opportunité de se constituer une idée de ce qui a été vécu au moment de la capture. Ces distorsions alimentent singulièrement un potentiel diégétique qui enrichit les expériences immersives dont nous allons désormais nous saisir.
Nos captations 360°, nommées ici « enveloppes », sont agencées dans une narration linéaire (image 14). L’observateur débute dans un premier espace cubique et fermé, au sein duquel se trouve en son centre une capsule et en un de ses recoins une fibre flottante. En approchant ce corps nébuleux il déplie et entre dans la première enveloppe. L’observateur défile ainsi d’enveloppe en enveloppe par l’intermédiaire de cet espace cubique sans cesse retrouvé. Cette capsule en son cœur, référence aux œuvres de l’artiste Absalon, tel que Cell N°1 (1992), se veut être une analogie de la traversée corporelle de l’observateur, partagée avec l’artiste filmé et son cabaret, et notre corps de chercheur. Incorporé et engagé dans ces enveloppes ce dernier peut considérer un vécu produit et expérimenté sur place, influencé par notre présence même. Au gré des immersions la capsule mute et se fait scène d’exposition (vidéo 5).
Si nous nous référons à Absalon c’est que ses œuvres cellulaires représentent des espaces habitables nomades, fabriqués en fonction des proportions de son corps, censés offrir des modèles d’existences urbaines alternatives. L’intérêt que nous trouvons dans ses cellules est qu’elles sont les conséquences d’un faire et d’un défaire. Pour les habiter il faut se déprendre de ses chorégraphies corporelles habituelles, et cela se produit par le fait même de les occuper. Ce dé/faire est similaire au processus que nous avons considéré dans la pratique drag de Vrsus, notamment désigné comme devenir-queer. Ce que nous tentons alors dans cette restitution, c’est de faire manifester par le gameplay, c’est-à-dire par l’action et les interactions, le parcours partagé dans le cabaret par l’alliance artiste/chercheur. Ce parcours s’apparente à la qualification faite par Bourriaud d’un certain sujet contemporain comme d’un objet de négociations et qu’il nomme « radicant » (Bourriaud, 2009, p. 50-68). L’auteur qui structure ainsi une analogie avec ces plantes dites radicantes, qui font pousser leurs racines au fur et à mesure de leur avancée, explique :
Le radicant diffère ainsi du rhizome par l’accent qu’il met sur l’itinéraire, le parcours, comme récit dialogué, ou intersubjectif, entre le sujet et les surfaces qu’il traverse [...] Le sujet radicant se présente ainsi comme une construction, un montage : autrement dit une œuvre, née d’une infinie négociation
(Bourriaud, 2009, P. 63)
Cette radicantité nous la suivons donc par le gameplay, mais également plastiquement par cette capsule évolutive et l’entité qui l’accompagne. Cette entité, que nous nommons entité radicante, cueille dans les enveloppes traversées par l’observateur des fragments d’images qu’elle déploie entre ses nœuds (image 15 et vidéo 5). Ce qui se joue alors ici est une subjectivité partagée et exposée telle une œuvre virtuelle – résultat du parcours de l’observateur dans les espaces du dispositif. Parcours lui-même indexé à ce que nomme l’artiste et chercheuse Carole Brandon un « entre [corps/machine] » (Brandon, 2016), à comprendre ici comme une complicité, un « rythme entre corps et machine » (p. 421), qui correspond à la relation de notre dispositif de captations audiovisuelles avec notre corps de chercheur et le corps de l’artiste – et de manière globale avec les corps qui composent le cabaret et son public. Pour finir, l’observateur se trouve happé dans une relation élastique (p. 370) où cadre et hors-cadre s’enlacent : la virtualité de la simulation informatique et la virtualité – au sens des possibilités – des chorégraphies corporelles présentées dans le casque, valsent avec l’actualité du corps tangible de l’observateur – lui ouvrant ainsi de nouveaux horizons.
Une rupture de cadre opère également à chaque allée et venues entre l’espace de transition cubique et les enveloppes. Une rupture linéaire et binaire malavisée d’après les premiers expérimentateurs du dispositif. Ces deux mondes renverraient trop distinctement et aisément, pour l’un à la règle et à la norme, pour l’autre à la liberté et à la déviance. Ces retours nécessaires nous amènent actuellement à re/penser l’espace cubique modélisé en 3D, abusivement fermé, inflexible et même aseptisé. Avec le recul, cette transition effectivement binaire entre les deux environnements s’accorde mal avec l’ambivalence des jeux de confusion corporelle de l’artiste et son cabaret. Tel ce jeu avec les modèles dans Paris is Burning (1990), ce sont les nombreuses transformations et métamorphoses, les revendications d’identités fantasmées, bricolées et dé/faites sur place que nous allons désormais tenter d’élever au sein du gameplay. Nous cherchons ainsi, dans une nouvelle version, à entrelacer les environnements et à rendre le rapport aux espaces lui-même confus.
En braconnant des signes archétypaux la pratique drag de Vrsus est venue troubler les distinctions entre réalité et fiction. Son devenir-queer mis en scène a participé à rendre plus explicite la fabrique et la performance ordinaire du genre ainsi que les « échanges culturels complexes dans lesquels sont pris les corps » (Butler, 2005, p. 246). Son esquisse d’une production de genre tous azimuts, qui s’est étendue à une proximité physique avec les corps présents, nous laisse ainsi penser qu’elle a permis au public d’envisager des versions alternatives d’être-au-monde. Toutefois, Federici précise que les normes – notamment de(s) genre(s) – ne sont pas seulement de « pure construction culturelle manœuvrable à loisir » (Federici, 2020, p. 74). En jouer n’assure pas leurs subversions. Ainsi nous sommes-nous détachés au fil du développement d’une seule « politique de la surface du corps »(Butler, 2005, p. 259) pour nous intéresser au discours de l’artiste, à ses techniques de corps ainsi qu’à cette relation avec le public à la fin de sa performance. Et si donc notre manière d’être-à-la-recherche a été une façon d’habiter ce cabaret en s’initiant à ses pratiques, afin de mieux l’explorer, notre compréhension générale du genre comme performance dans une si brève et circonscrite anthropologie visuelle n’a pu saisir l’ensemble d’une dé/construction rythmée in/consciemment, sans cesse fragmentée, mais toujours renouvelée, et qui semble queeriser un corps.
À partir de ce terrain, nous avons étudié les spécificités de la captation à 360° et avons pu considérer qu’elles venaient troubler les relations classiques du cadre/hors-cadre et du champ/hors-champ, précipitant ainsi un positionnement singulier et concomitant de chercheur-filmant et chercheur-filmé. En s’intéressant à certains des phénomènes se déroulant au sein du cabaret, notre exploration a produit du sens et une connaissance à « l’intersection de [nos] expériences et celles d’autrui, par l’engrenage des unes sur les autres [;] [elle] est donc inséparable de la subjectivité et de l’intersubjectivité » (Merleau-Ponty, 1945, p. XV). C’est donc en tant que subjectivité-cherchante que nous avons mené cette observation participante qui s’est avéré être une rencontre entre étants au monde, caractéristique de ce que nous avons nommé être une alliance de recherche. C’est-à-dire que nous avons partagé la création de sens avec l’artiste, et notre dispositif de captations audiovisuelles s’est présenté – opportunément – comme point de médiatisation de l’intersection des subjectivités et corporéités qui composaient la chair de ce terrain. Ainsi pouvons-nous écrire que nous n’avons pas cherché à nous re/connaître dans la performance de l’artiste, mais à comprendre ce qui était également visible de notre existence en elle, participant alors à donner du sens et une orientation à notre recherche. C’est d’ailleurs bien l’intersubjectivité et la mise en re/présentation de la réalité, initiées par notre méthodologie, qui se sont trouvées au cœur de la restitution virtuelle de la recherche. À nos yeux un chercheur ne peut effectivement considérer son terrain comme se déroulant d’une manière parfaitement autonome devant lui. Le corps du chercheur est, pour nous, enchevêtré à son terrain de recherche : en participant à la vie de ce cabaret, nous avons influencé et initié des situations. En prenant part à ces évènements nos caméras 360° ont matérialisé cette perméabilité en distribuant à chacun un supplément de rôles : observé/filmé et/ou observant/filmant. En soulignant visuellement les conditions de son énonciation notre état d’être-à-la-recherche a tenté de modérer toute position surplombante qui aurait, ensuite, échappé à sa propre re/présentation (directe).
Nous remercions chaleureusement Vrsus, la BÉNÉDICTION – Rituels exceptionnels et le Benelux. Également Jacques Ibanez-Bueno ainsi que l’ensemble des relecteurs/trices et correcteurs/trices de l’article, nos collègues du département Communication Hypermédia et Éloïse Emery.
1 Fin 2019, l’artiste a adopté le nom de scène Eliott de la Prigari.
2 Nous remercions chaleureusement Vrsus, la BÉNÉDICTION - Rituels Exceptionnels et le Benelux. Également Jacques Ibanez-Bueno ainsi que l’ensemble des relecteurs/trices et correcteurs/trices de l’article. À nos collègues du département Communication Hypermédia ainsi qu’à Éloïse Emery.
3 Queer est au départ un terme injurieux (approximativement traduit par « bizarre », « tapette »…) qui a été réapproprié pour en faire un étendard. Une réappropriation amorcée par des mouvements de minorités sexuelles marginalisées qui se mobilisèrent dans l’espace public urbain américain, tels les activistes de la ville de New York en 1990 : la Queer Nation. Aujourd’hui, c’est un terme plutôt générique qui permet à des personnes n’étant pas hétérosexuelles ou cisgenres (cisgenre signifie être en accord avec le genre attribué à sa naissance) de s’écarter de l’hétérosexualité et de son binarisme caractéristique qu’est la différence sexuelle et la différence de genre homme/femme.
4 Nelson Sullivan est mort en 1989. Ses centaines d’heures de vidéos ont été sécurisées et stockées à sa mort par son ami d’enfance Dick Richards. Depuis 2008, ce dernier monte et publie régulièrement des extraits sur la chaîne YouTube 5ninthavenueproject (nommée d’après adresse de résidence de Sullivan), créée pour l’occasion.
5 Cette couture dans les mots est inspirée de l’usage adroit et inventif qu’en fait l’artiste-chercheur Marc Veyrat. Elle permet notamment de retranscrire l’ambiguïté de la situation discutée à même le lexique.
6 Le concept de « blanchité » est issu des Cultural Studies et désigne une condition sociale. Sur ce sujet, voir Cervulle 2010.
7 Notre traduction.
8 Notre traduction.
9 Sauron est l’un des personnages du roman en trois volumes de J. R. R. Tolkien Le Seigneur des Anneaux (1954-1955). Sa particularité est d’être majoritairement re/présenté sous la forme d’un œil, dissocié de tout corps, balayant le monde du sommet de sa tour. Une image puissante d’une surveillance centralisée intimidante.
10 Cette proximité est notamment facilitée par des caméras 360° à la taille peu intrusive.
11 Cette caméra, pourtant allumée, n’a enregistré aucunes images de ce moment. Mémoire saturée ? Mauvaise manipulation de notre part ? Nous ne savons pas.
12 Sur ce sujet, voir Baudrillard 1979, De Lauretis 1987, Fabio 1999, Greco et Kunert 2016, Bourcier 2018.
13 Sur ce sujet, voir Didi-Huberman 2002.
14 Notre traduction.
15 Un lip-sync est un genre de performance bien connu de l’univers drag contemporain et notamment popularisé par l’émission Ru Paul Drag Race. Il consiste en une synchronisation du mouvement des lèvres avec les paroles d’une chanson afin de « faire croire » au public qu’on la chante.
16 À ce sujet, voir Mulvey 1975 et Foucher Zarmanian 2016.
17 Elle naît plus précisément du sang d’Ouranos tombé dans la mer, ce qui forme une écume.
18 Le quatrième mur désigne ce mur imaginaire au-devant de la scène qui sépare les artistes des spectateurs et spectatrices qui les regardent jouer au travers.
19 Notre traduction.
20 Notre traduction.
21 C’est à peu près de cette manière que dans Les Mots et les Choses (1968) Michel Foucault explique le travail du peintre Diego Velázquez avec son tableau Les Ménines (1656). Cette peinture est, pour le philosophe, la représentation de la représentation classique.
22 Université Savoie Mont Blanc, département Communication Hypermédia.
23 Terme anglais qui désigne les caractéristiques d’un dispositif immersif et/ou interactif (tel que le jeu vidéo) que sont l’action et les règles du jeu, par opposition aux effets graphiques et sonores.
24 Le point pivot (l’emplacement de la caméra 360°) est dans la VR une caméra virtuelle depuis laquelle regarde l’observateur.
25 C’est l’une des potentialités qu’affectionne Nelson Sullivan. Durant une interview filmée avec sa propre caméra Sullivan compare l’aspect fisheye de ses vidéos à celles des séquences de l’ordinateur Hal 9000 du film 2001 : L’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick : « La lentille en œil de poisson (fisheye) [en faisant le parallèle avec le film de Kubrick] elle est tellement déformée qu’elle n’est évidemment pas la réalité mais c’est quelque chose à partir duquel vous pouvez reconstruire la réalité, donc vous réalisez que vous regardez de l’information pure et non la vraie chose. [...] vous voyez quelque chose à partir duquel vous reconstruisez votre propre idée de ce qu’était cette réalité » (notre traduction), Nelson Sullivan discusses the Reality of Video in the Chelsea Hotel (2017), [en ligne] 5ninthavenueproject
AHMED Sara (2006), Queer phenomenology: orientations, objects, others, Durham, Duke University Press.
ANDRIEU Bernard (2011), Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive, Nancy, Presses universitaires de Nancy.
BAUDRILLARD Jean (1979), De la séduction, Paris, Galilée.
BOURCIER Sam (2018), Queer zones : la trilogie, Paris, Éditions Amsterdam.
BOURRIAUD Nicolas (2009), Radicant. Pour une esthétique de la globalisation, Paris, Denoël.
BRANDON Carole (2016), L’Entre [corps/machine]. La Princesse et son Mac, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
BUOB Baptiste (2017), « Splendeur et misère de la ciné-transe. Jean Rouch et les adaptations successives d’un terme ‘‘mystérieux’’ ». L’Homme. Revue française d’anthropologie, 223-224, p. 185-220.
BUTLER Judith (2005), Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte.
CERTEAU Michel de (1990), L'invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, coll. « Folio. Essais » (1re éd. 1980).
CLETO Fabio (1999), Camp. Queer Aesthetics and the Performing Subject: A Reader, Ann Arbor, University of Michigan Press.
CERVULLE Maxime (2010), « Politique de l’image : les Cultural Studies et la question de la représentation, réflexion sur la ‘‘blanchité’’ », in CERVULLE Maxime, LINDGAARD Jade, MACÉ Éric, MAIGRET Éric, McROBBIE Angela, MORLEY David, NEVEU Éric (dir), Cultural Studies. Genèse, objets, traductions, Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information, coll. « Paroles en réseau », p. 46-49.
DE LAURETIS Teresa (1987), Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction, Bloomington, Indinan University Press.
DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix (2009), Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique » (1re éd. 1991).
DIDI-HUBERMAN George (2002), L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Éditions de Minuit.
FEDERICI Silvia (2020), Par-delà les frontières du corps. Repenser, refaire et revendiquer le corps dans le capitalisme tardif, Paris, Éditions Divergences.
FERRARINI Lorenzo (2017), « Embodied Representation: Audiovisual Media and Sensory Ethnography », Anthrovision, 5.1, [en ligne] http://journals.openedition.org/anthrovision/2514.
FOUCHER ZARMANIAN Charlotte (2016), « Arts visuels », Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La Découverte, p. 67-76.
GRECO Luca (2018), Dans les coulisses du genre. La fabrique de soi chez les Drag Kings, Limoges, Lambert-Lucas.
GRECO Luca, KUNERT Stéphanie (2016), « Drag et performance », in RENNES Juliettes (dir.), Encyclopédie critique du genre : Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La Découverte, p. 222-231.
HARAWAY Donna Jeanne (2007), Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils (1re éd. 2002).
HEINICH Nathalie (2020), La cadre-analyse d’Erving Goffman. Une aventure structuraliste, Paris, CNRS Éditions.
HOOKS Bell (1992), Black Looks. Race and representation, Boston, South End Press.
LALLIER Christian (2018), « La pratique de l’anthropologie filmée. Retour sur le “terrain” de L’Élève de l’Opéra », Revue française des méthodes visuelles, 2, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/2/articles/01-la-pratique-de-l-anthropologie-filmee-ou-le-terrain-de-l-eleve-de-l-opera/.
LORENZ Renate (2018), Art queer : une théorie freak, Paris, B42.
MARIN CARRILLO Alba (2019), Innovación tecnológica y formas de representación en el documental social. Desde los formatos interactivos hasta las experiencias inmersivas, thèse de doctorat, Université Savoie Mont-Blanc et Université de Séville.
MERLEAU-PONTY Maurice (1976), Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. « Tel » (1re éd. 1945).
MULVEY Laura (1975), « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, 16 (3), p. 6-18.
MUÑOZ José Esteban (1999), Disidentifications. Queers of Color and the Performance of Politics, Minneapolis, University of Minnesota Press, coll. « Cultural studies of the Americas ».
MUÑOZ José Esteban (2019), Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity, New York, New York University Press (1re éd. 2009).
NANCY Jean-Luc (2006), « Toucher », in BERNARD Andrieu (dir.), Le dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales, Paris, CNRS Édition, p. 497-499.
OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (1995), Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, Karthala.
ROUCH Jean (1979a), « Introduction », in FRANCE Claudine de (dir.), Pour une anthropologie visuelle, Paris-La Haye-New York, Mouton & Cie, coll. « Cahiers de L’Homme », p. 5-11.
ROUCH Jean (1979b), « La caméra et les hommes », in FRANCE Claudine de (dir.), Pour une anthropologie visuelle, Paris-La Haye-New York, Mouton & Cie, coll. « Cahiers de L’Homme », p. 53-72.
SAYAD Cecilia (2013), Performing Authorship. Self-Inscription and Corporeality in the Cinema, Londres, I.B. Tauris, coll. « Tauris World Cinema ».
ZITOUNI Benedikte (2017), « Revisiter les savoirs situés. L’objectivité et le monde coyote. Arts situés », communication du séminaire Arts situés de l’Université de Liège, [en ligne] http://hdl.handle.net/2078.3/221406.
5NINTHAVENUEPROJECT (2013), Amnesia at Gay Pride 1989, 16 min.
JARMAN Derek (1984), Will You Dance With Me?, 78 min.
LIVINGSTONE Jennie (1990), Paris is Burning, 78 min.
LADY GAGA (2013), Venus, collab. Stefani Germanotta, Paul Blair, Hugo Leclercq, Dino Zisis, Nick Monson, Sun Ra, 3 min 54.
ABSALON (1992), Cell No. 1 (installation), Londres, Tate.
BOTTICELLI Sandro (1484-1485), La Naissance de Vénus (peinture), Florence, Musée des Offices, Florence.
LACHAPELLE David (2009), Rebirth of Venus (photographie), Berlin, Gemäldegalerie Alte Meister.
Jordan Fraser Emery, « Dispositif immersif en contexte queer. Entre 360° et réalité virtuelle », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 5 | 2021, mis en ligne le 9 juin 2021, consulté le . URL : https://rfmv.fr