

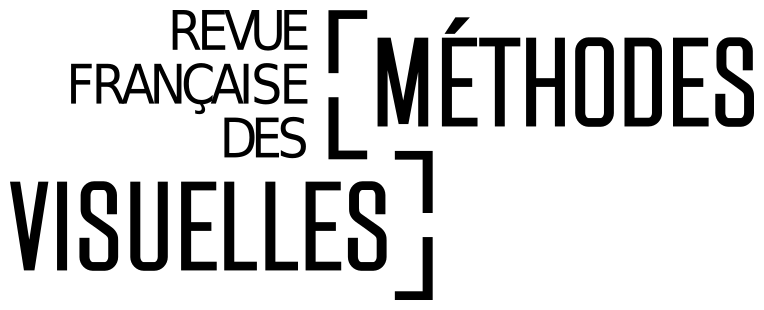
Joyce Sebag, PU (sociologie), Université d’Évry, centre Pierre Naville
Jean-Pierre Durand, PU (sociologie), Université d’Évry, centre Pierre Naville
Images 1 et 2 - Couverture et table des matières de l'ouvrage La sociologie filmique
© CNRS Editions, 2020
Quels peuvent être les mobiles pour que des sociologues en viennent à penser le cinéma documentaire comme l’une des issues aux problèmes posés dans leur quotidien de chercheurs ? Tout (ou presque) démarre d’une remarque d’un syndicaliste, ouvrier professionnel, entendue lors d’une recherche de terrain. Il disait combien leur parole avait été depuis toujours confisquée. Elle s’exprimait bien sûr dans les moments de résistance (grèves, manifestations, élections...) mais restait sans lendemain. Il disait aussi, suscitant une interrogation sur le rôle du chercheur, que les paroles que celui-ci recueillait allait servir sa carrière puisqu’elle serait traduite en « travaux scientifiques » mais qu’eux ne verraient aucun changement dans leur trajectoire professionnelle. Pourtant il avait, avec ses camarades, accepté de faire entrer les chercheurs en « clandestins » dans l’atelier, avec toutefois une visibilité suffisante pour que le contremaître les repère (malgré le bleu de travail prêté), mais ne dise rien parce que le « rapport de force » était alors en faveur des ouvriers professionnels compte tenu de la puissance syndicale. Faire entrer des chercheurs dans les ateliers était aussi une marque de leur capacité à imposer quelque chose à la direction, à leur hiérarchie. Ce qui allait de pair avec l’organisation de la vie dans l’atelier lorsqu’à la pause de midi, ils mettaient en place ce qui ressemblait à un buffet pour partager Pastis et sandwiches au milieu des chaînes de montage. Acte dont ils tiraient une fierté certaine parce qu’il était une marque de résistance à lire dans le regard du contremaître. Mais de cela les chercheurs n’en parlaient jamais dans leurs publications car ils avaient intériorisé l’idée que c’était un interdit dont la visibilité ne devait pas excéder l’espace de l’atelier et qu’en parler pouvait faire du tort à ceux qui les avaient accueillis. C’est d’ailleurs l’interdiction de l’alcool dans l’atelier qui a été l’un des premiers actes de remise en ordre de la vie ouvrière dans les ateliers par ce que l’on a appelé le nouveau management, avec l’avènement de la lean production. Cette pratique de l’apéro du midi s’inscrivait dans la logique des victoires symboliques comme l’installation de bancs en bordure de chaîne : car ceux-ci rendaient possible, lors des pannes de chaîne, la rencontre entre ouvriers et l’échange de parole, ce qui était perçu comme une sorte d’humanisation de cet espace. Pour faire image, ce militant expliquait que ces bancs leur permettaient même de parler de leur « cors aux pieds », soit un acte de reconnaissance de soi comme personne et non comme machine. Le pari de la sociologie filmique est alors de restituer une parole effacée tout en montrant ou en suggérant ce qui ne peut être rapporté dans un ouvrage ou dans un article.
L’écriture, la conceptualisation participent évidemment de la connaissance d’un milieu. Filmer ces espaces, ces hommes et ces femmes ne les rend pas toujours plus visibles, mais fait connaître différemment un monde du travail que l’industrialisation avait fermé au monde extérieur. Certes la fiction à travers de nombreux films avaient traité de ce problème et continue de le faire, Le désert rouge de Michelangelo Antonioni (1964) reste à ce titre emblématique de la séparation de ces deux mondes1 ; mais la fiction doit œuvrer par reconstitution ou investir des lieux autrefois dédiés à la production et aujourd’hui abandonnés (voir par exemple Ressources Humaines de Laurent Cantet, 2000). Comment la sociologie peut-elle, à partir de sa tradition et de ces canons, rendre compte du réel par les images/sons dont nous avons établi précédemment les rapports intrinsèques avec le sensible et les émotions, sans se renier ? Et plus encore, dans ce chapitre, nous allons tenter de montrer ce que l’usage du cinéma ou de la vidéo révèlent de la sociologie et à la sociologie en tant que discipline de recherche. Après avoir analysé les rapports entre sociologie filmique et interactionnisme (1), nous emprunterons à Norbert Elias pour saisir comment le sociologue-cinéaste peut se situer entre engagement et distanciation, en donnant toute son importance au point de vue (2). Dans une troisième section nous interrogerons le devenir, dans la sociologie filmique, de ce qu’il est convenu d’appeler les « résidus scientifiques » avant de conclure sur les pockets films et sur l’usage des smartphones.
À la différence de l’opéra ou du théâtre, le cinéma met en scène en permanence et en interaction au moins deux personnages : c’est cette interaction qui permet de saisir une situation, une pensée, qui produit de la connaissance à travers l’émergence de la réflexion de chacun, y compris en entretenant une tension (dramatique). Ce que montre la sociologie filmique (directement en images/son ou à travers l’exposé d’une situation) est une suite d’interactions qui produisent une pensée, des connaissances. En d’autres termes, l’objet principal que met en images/sons la sociologie filmique est un ensemble d’interactions qui font sens pour le réalisateur, à destination des spectateurs. Il y a donc une sorte d’homothétie, au moins formelle, entre la sociologie filmique et les paradigmes fondateurs du courant de l’interactionnisme symbolique (voire de l’ethnométhodologie).
En effet, ce courant né aux États-Unis entre les deux guerres repose sur quelques principes de base qui sont aussi constitutifs des pratiques de la sociologie filmique. On peut résumer ainsi ces principes de base de l’interactionnisme :
Dans la sociologie filmique, le réalisateur observe les interactions et les filme en situation. Mais bien souvent il intervient — même s’il est absent physiquement de l’image et de la bande son -— en posant des questions au.x sujet.s filmé.s.
C’est ici que l’homothétie formelle avec le courant de l’interactionnisme symbolique s’arrête mais que les principes de ce dernier perdurent en introduisant un autre type de relation, cette fois entre le sujet filmé et le sociologue qui l’interroge sur les significations de ses actes et sur ses représentations de son environnement, voire du monde plus généralement. L’interaction principale n’est plus seulement dans le film, elle se situe entre le filmeur et le filmé, tout en conservant l’essentiel du contexte constitutif de l’interactionnisme : petite communauté (bien souvent déviante), priorité accordée au terrain, connivence avec les sujets interrogés (voir le chapitre suivant pour une critique de celle-ci) et tentative dramaturgique du sociologue qui pousse le sujet interviewé dans ses retranchements pour lui faire exposer ses représentations et ses valeurs qui sous-tendent ses actions : ce sont ici autant d’emprunts à la sociologie compréhensive de Weber, à l’interactionnisme et à l’ethnométhodologie.
En résumé, le sociologue-cinéaste tend à privilégier la relation à son sujet plutôt que l’interaction entre individus comme le fait l’interactionnisme (et à la différence de ce que fait le cinéma de fiction) pour faire émerger une pensée et produire des connaissances. On pourrait parler d’homothétie renforcée puisqu’au-delà de son intérêt pour la seule interaction entre deux personnes qu’il doit objectiver, le sociologue-cinéaste doit privilégier son interaction avec le.s sujet.s pour atteindre la qualité escomptée lors du tournage et au-delà de son film. Il ne s’agit pas de dire que la sociologie textuelle n’a pas elle aussi à auto-analyser sa relation à l’interaction-objet de la recherche, mais elle n’a pas à se préoccuper de sa mise en scène, ou plus précisément de sa mise en images/sons. Ce travail de réflexivité et d’anticipation donne à l’interaction filmique entre le sociologue et son sujet (une interaction, une scène, un entretien) une intensité qui conduit nécessairement à un approfondissement de celle-ci. Ce moment de réflexivité sur la relation filmeur/filmé est d’autant plus important que l’instrument caméra transforme cette relation :
Toutefois, la sociologie filmique souhaite aussi dépasser l’observation des seules interactions pour traiter des structures sociales, de leurs influences sur celles-ci et des facteurs explicatifs des comportements et des valeurs. Des interprétations réductrices ont conduit à concevoir l’interactionnisme comme un courant tourné vers les relations interpersonnelles. Pourtant, ses fondateurs (en particulier E. Goffman) étaient très soucieux de les envisager dans un cadre social structurant, ce qui a pu être sous-estimé par certains sociologues se réclamant de ce courant, en particulier en France. Ainsi, nous pouvons effectivement dire que l’interactionnisme ou l’ethnométhodologie montrent leurs limites quand ils considèrent que l’analyse des interactions et de l’expérience personnelle suffit pour connaître les structures sociales. Car ici, comme l’écrit Robert Weil, « la structure sociale qui génère l’ordre social réside déjà dans le sens des interactions que maîtrisent les individus4 » . En d’autres termes, cette conception profondément empiriste émiette les structures sociales en microstructures (les interactions) en privilégiant une production endogène du sens, sans penser la nature des rapports entre ces structures.
Si la sociologie filmique peut emprunter à ces courants la richesse des réflexions sur les interactions — en particulier dans la relation filmeur/filmé —, elle doit aussi nourrir celles-ci et traiter de thèmes et d’objets qui dépassent les préoccupations d’une microsociologie. Ce qui est une manière de poser la question du rapport au monde du sociologue-cinéaste, soit aussi de son rapport à son objet.
Toutefois, la sociologie filmique souhaite aussi dépasser l’observation des seules interactions pour traiter des structures sociales, de leurs influences sur celles-ci et des facteurs explicatifs des comportements et des valeurs. Des interprétations réductrices ont conduit à concevoir l’interactionnisme comme un courant tourné vers les relations interpersonnelles. Pourtant, ses fondateurs (en particulier E. Goffman) étaient très soucieux de les envisager dans un cadre social structurant, ce qui a pu être sous-estimé par certains sociologues se réclamant de ce courant, en particulier en France. Ainsi, nous pouvons effectivement dire que l’interactionnisme ou l’ethnométhodologie montrent leurs limites quand ils considèrent que l’analyse des interactions et de l’expérience personnelle suffit pour connaître les structures sociales. Car ici, comme l’écrit Robert Weil, « la structure sociale qui génère l’ordre social réside déjà dans le sens des interactions que maîtrisent les individus » . En d’autres termes, cette conception profondément empiriste émiette les structures sociales en microstructures (les interactions) en privilégiant une production endogène du sens, sans penser la nature des rapports entre ces structures.
Si la sociologie filmique peut emprunter à ces courants la richesse des réflexions sur les interactions —en particulier dans la relation filmeur/filmé—, elle doit aussi nourrir celles-ci et traiter de thèmes et d’objets qui dépassent les préoccupations d’une microsociologie. Ce qui est une manière de poser la question du rapport au monde du sociologue-cinéaste, soit aussi de son rapport à son objet.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous faut revenir sur un constat fait en tant qu’enseignants-chercheurs dans le Master Image et Société : la question de la prise de distance par rapport à l’objet traité est d’autant plus importante que les premiers films des étudiants ont un rapport direct avec leur trajectoire sociale et familiale ; c’est déjà plus ou moins vrai quand il s’agit du choix d’un sujet pour un mémoire-papier, mais l’investissement est encore plus affectif quand il s’agit de rendre un film de fin d’études de 15’. Quoique nous découragions les portraits de famille, la proximité des films proposés avec le passé récent de l’étudiant exige un énorme effort de distanciation qui, pourtant, ne saurait renier la nécessité d’un engagement non moins profond. L’exercice consiste, en même temps, en la construction d’une analyse des relations sociales privilégiant la forme du récit et valorisant un ou des personnages à la dimension universelle, comme par exemple dans les bons romans (ou les films de fiction).
L’une des réflexions préliminaires est celle de la place du je dans la recherche puis dans le récit. Quoique cette question soit déjà présente avec l’écrit, il est probable que l’audio-visuel l’ait mis en lumière de manière plus forte et plus évidente que lorsqu’elle n’existait qu’à l’état latent :
Il est probable que le cinéma et la photographie introduisent plus de je dans la sociologie que ne l’a fait pendant longtemps le texte écrit. La place du je dans le propos « scientifique » le contextualise, il dit sa source. C’est une « affirmation qui dit, je vis » comme le souligne Luce Irigaray (1985). Elle ajoute: « le discours scientifique se veut neutre, duplicata sans affect de la réalité. Cette science n’est pas sans naïveté surtout quand elle se veut science du sujet, psychologie, sociologie, psychanalyse, linguistique..., raison irréversible, universelle. Elle se veut non-empiètement subjectif ». C’est cette introduction de l’affect, mais pas seulement, qui est aujourd’hui en jeu dans ce jeu (entre le filmeur et le filmé) qui est aussi un enjeu dans le pari de la sociologie filmique. Ainsi, cette dernière confirmerait la rupture de la sociologie avec ses positions positivistes passées, rupture effectuée à partir de l’introduction du je dans l’objet d’analyse lui-même. Ici en recourant par exemple à l’émotion, indissociable de l’expression cinématographique, la sociologie filmique réaffirme la place du je dans la discipline. D’où la nécessité de revenir aux questions de distanciation et d’engagement pour situer le je dans la démarche.
Le sociologue, comme tout chercheur en sciences sociales et humaines, ne peut écarter la question de sa place dans sa société qu’il l’étudie ou qu’il en analyse une autre... La question de l’engagement politique (et sociétal pourrait-on dire) est, en France, celle du statut et de la place de l’intellectuel dans la société depuis le fameux J’accuse d’Émile Zola en 1898. Comme tout autre individu, l’intellectuel est situé socialement et son approche, son point de vue, a à voir avec les normes sociales du groupe auquel il appartient. Cependant, l’intellectuel qui naît en tant que figure sociale avec « l’affaire Dreyfus » se voit obligé de se révéler, y compris à lui-même, tout en étant contraint selon l’expression de Maurice Blanchot à « une exigence simple, une exigence de vérité et de justice, revendication de l’esprit libre contre la véhémence fanatique, exigence dont [il tire] une nouvelle autorité et parfois un bénéfice moral » (Blanchot, 1996, p. 23).
Ainsi, l’intellectuel se retrouve au centre de la défense de ces idéaux de justice qui sont donnés comme universels. Ce rôle qui l’a caractérisé pendant plus d’un siècle a été lui-même interrogé. Michel Foucault, que cite Maurice Blanchot, questionne cette place de l’intellectuel, en prenant des accents destructeurs de cette vision : « pendant longtemps, l’intellectuel dit “de gauche” a pris la parole et s’est vu reconnaître le droit de parler en tant que maître de la vérité et de la justice. On l’écoutait, ou il prétendait se faire écouter comme représentant de l’universel. Être intellectuel, c’était être un peu la conscience de tous » (Idem, p. 59). Mais la figure de l’intellectuel n’est pas seulement de gauche et Alice Kaplan (2004), dans son ouvrage sur le procès de Robert Brasillach, rappelle l’engagement à l’extrême droite de nombreux intellectuels français et interroge leur responsabilité pendant l’occupation et la justification du nazisme qu’ils ont contribué à faire admettre comme une idéologie acceptable ou à défendre.
L’intellectuel évoqué et mis en question aujourd’hui, comme le souligne le titre de l’ouvrage de Blanchot, c’est l’homme ou la femme qui de par sa place, énonce un certain nombre de propos qui seront entendus par un grand nombre et qui serviront de prêt à penser pour ceux qui sont supposés ne pas pouvoir construire avec discernement un point de vue. Et là encore, Blanchot interprète Mai 68 comme le moment où, « dans la force du mouvement anti-autoritaire (…) chacun se reconnaissait dans les paroles anonymes qui s’inscrivaient sur les murs et qui finalement, même s’il arrivait qu’elles fussent élaborées en commun, ne s’annonçaient jamais comme paroles d’auteur, étant de tous et pour tous dans leurs formulations contradictoires. Mais bien sûr cela fut une exception, elle ne fournit aucune solution même si elle donne une idée de ce que peut être un bouleversement qui n’a pas besoin de réussir ou de parvenir à une fin déterminée… et dont l’échec qui finalement le sanctionne ne le concerne pas » (Blanchot, 1996, p. 60).
Ainsi, comme l’évoque Agnès Pégorier dans son hommage à Blanchot, « le projet blanchotien apparaît autant esthétique, qu'éthique voire politique. Toutefois, moins naïf que les surréalistes, il ne croit pas que la poésie ou les mots puissent changer le monde. Toutefois encore, plus poète que révolutionnaire, il croit en la puissance contestataire du Verbe. Toutefois encore (bis), moins esthète que bien des intellectuels, il ne cesse de s'interroger sur les limites et les contradictions inhérentes à toute prise de parole, en même temps que sur sa valeur éthique. Toutefois toujours, moins dogmatique que bon nombre de ses contemporains, il ne cherche pas à résoudre ces apories par quelque détournement “idéologisant” de sa pratique » (http://www.alalettre.com/blanchot.php). Autant de questionnements qui traversent nécessairement l’esprit du sociologue-cinéaste qui, par sa fonction, produit et diffuse des connaissances et des idées à un public plus ou moins élargi.
1 Voir la fascination qu’exerce l’invisible sur les chercheurs mais aussi sur les cinéastes qui en isolent aussi la beauté comme le montre cet extrait d’entretien de Michelangelo Antonioni avec Jean-Luc Godard, Cahiers du cinéma, n°160 (novembre 1964) : « Auparavant, c'étaient les rapports des personnages entre eux qui m'intéressaient. Ici, le personnage central est confronté également avec le milieu social, ce qui fait que je traite mon histoire d'une façon tout à fait différente. Il est trop simpliste, comme beaucoup l'ont fait, de dire que j'accuse ce monde industrialisé, inhumain, où l'individu est écrasé et conduit à la névrose. Mon intention, au contraire (...) était de traduire la beauté de ce monde, où même les usines peuvent être très belles... La ligne, les courbes des usines et de leurs cheminées sont peut-être plus belles qu'une ligne d'arbres, que l'œil a déjà trop vue. C'est un monde riche, vivant, utile. »
2 On retrouve ici la dimension profilmique du documentaire telle que l’a définie Claudine de France à propos des modifications des comportements des sujets face à la caméra (cf. chapitre 1).
3 Cette préparation est un moment délicat, car il est nécessaire d’expliciter le projet avec ses tenants et ses aboutissants pour convaincre les personnages pressentis de participer au film, sans trop en dire pour ne pas induire des comportements et des déclarations « adaptés », c’est-à-dire correspondant à ce que ceux-ci pensent qu’il est bien de dire ou de faire ou correspondant aux attentes supposées du sociologue-cinéaste.
4 Voir pour la critique de ce courant sociologique le chapitre 10 de J.-P. Durand et R. Weil, Sociologie contemporaine, Éditions Vigot, 2006, qui comprend une analyse circonstanciée avec les références aux auteurs discutant l’interactionnisme et l’ethnométhodologie, tels que Alain Coulon, Michel Crozier, Lewis Coser, Pierre Bourdieu, etc.
Joyce Sebag, Jean-Pierre Durand, « La sociologie filmique. Chapitre 4. Le cinéma exacerbe les interrogations sociologiques », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 5 | 2021, mis en ligne le 9 juin 2021, consulté le . URL : https://rfmv.fr