

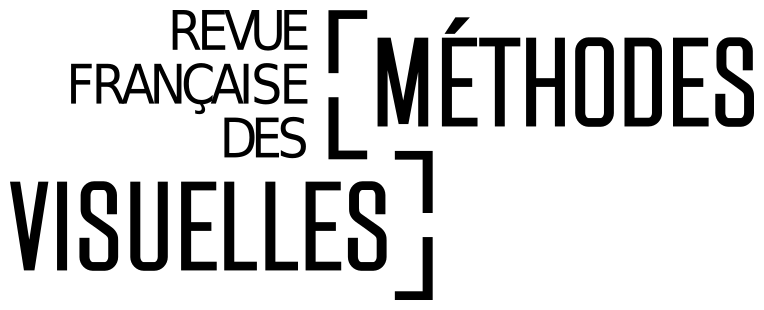
Federico Dotti, Collaborateur scientifique, Université de Genève, ÉDHICE
La transmission de l’histoire requiert un travail de déconstruction et reconstruction de savoirs et connaissances, une implication active dans le traitement du contenu. Lorsque l’acte de partage prend la forme d’une exposition, un dialogue s’instaure entre pratique historienne et artistique. L’œuvre d’imagination et de conception du dispositif communicationnel est traversée par des logiques spatiales et visuelles qui façonnent un espace-temps de confrontation, un environnement cognitif à même d’engendrer une forme de réflexivité. Leur attribuant de nouvelles significations, le statut d’objet, texte et image est transfiguré par la démarche expositionnelle. Éléments discursifs d’un média aux multiples systèmes sémiotiques, les expôts matérialisent et véhiculent le discours expographique au sein d’une scénographie qu’ils contribuent à fabriquer et dont ils subissent l’influence. Outil dialectique, l’exposition propose mais n’impose pas. Elle expose une vision du monde à un public, lequel s’y confronte lors de la visite par des activités inférentielles et d’interprétation. Cet article propose d’explorer le processus de création de l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises.
Mots-clés : Histoire, Exposition, Objets, Scénario, Scénographie
The transmission of history requires deconstruction and reconstruction of knowledge, an active involvement in the content’s treatment. When the act of sharing takes on the form of an exhibition, a dialogue is established between historical and artistic practice. Imagination and conception of the communicative device is crossed by spatial and visual logic that produces a spatiotemporal confrontation, a cognitive environment capable of generating a form of reflexivity. Endowing them with new meanings, the status of objects, texts and images is transfigured by the exhibition process. As discursive elements of a medium composed by multiple semiotic systems, the exhibits materialize and convey the expographic discourse within a scenography that they contribute fashion and whose influence they undergo. As dialectical tool, the exhibition proposes but does not impose. It exposes a vision of the world to an audience, confronting itself throughout the visit by means of inferential and interpretative activities. This article explores the creative process of the exhibition Figures de l’ombre, histoires genevoises.
Keywords : History, Exhibition, Objects, Script, Scenography
Chaque ensemble social pense, produit et organise ses figures de la marge. Porteuses d’un potentiel danger, elles s’avèrent toutefois indispensables afin de bâtir, dans une relation d’affrontement, les éléments fondamentaux autour desquels gravitent les sociétés elles-mêmes (Schmitt, 1978). Ce processus de fabrication accompagne les évolutions, en sécrétant et réinterprétant une panoplie de personnages, d’images et d’appellations qui traversent les époques. Au XIXe siècle, les envers sociaux se concentrent dans les « bas-fonds » où sévissent crime, misère et vice : trois composants à intensité variable qui caractérisent les réalités de la transgression (Kalifa, 2013). Miroir d’une société, cette dernière se dévoile depuis ses marges.
L’histoire sonde les dynamiques profondes des mondes sociaux et fait surgir les modes de régulation des sociétés par la confrontation avec l’altérité. Au travers de son approche, elle met en perspective les formes d’hétérogénéité qui façonnent les structures sociales afin qu’elles deviennent saisissables et imaginables (de Certeau, 1973). Longtemps écrite depuis le « centre », l’histoire des dominé·e·s et des exclu·e·s demeure encore reléguée au sein des « périphéries » de l’historiographie (Riot-Sarcey, 2016).
Dans l’écriture de l’histoire, la phase de circonscription est une étape indispensable : une période, un objet et un lieu (de Certeau, 1975). « Aliéné·e·s », « indigent·e·s » et « détenu·e·s » représentent le point de départ pour appréhender la Genève du XIXe siècle. Engendrées par des dynamiques de construction culturelle et sociale, ces catégories peuplent les imaginaires sociaux (Baczko, 1984) qui, à l’intersection entre réalité et fiction, génèrent des figures pour la plupart désincarnées (Farge et al., 2004).
Dans le cadre de cet article, nous allons explorer la fabrication d’un dispositif de communication, tel qu’elle se déploie dans le processus d’imagination et de création de l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises1, bâtie au confluent des démarches expographique et historienne. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de notre doctorale en didactique de l’histoire qui interroge les enjeux de la transmission d’une histoire des formes de marginalités. La pluralité des espaces publics investis par la discipline historienne conduit à réfléchir aux différents médias possibles pour la mettre en scène et aux multiples situations sociales au sein desquelles elle se trouve convoquée. La transmission de l’histoire implique un travail d’adaptation en vue de son partage, quelle que soit la forme qu’elle dessine dans l’acte de médiation (Mazeau, 2020). Se fraie, dès lors, un chemin : l’idée de proposer une réflexion sous la forme d’une exposition cherchant à inscrire des phénomènes du présent dans une épaisseur temporelle afin de pouvoir interroger les mécanismes à l’œuvre dans leur fabrication. Le partage de l’intelligible se joint au partage du sensible.
En ce sens, l’exposition répond à une double finalité. D’une part, elle est appréhendée comme objet de recherche dans la mesure où elle permet de véhiculer un propos en direction d’un public : elle s’avère un lieu de production de significations, un travail de communication d’un savoir scientifique (Davallon, Flon, 2013). D’autre part, l’exposition crée les fondements de la récolte des données pour notre thèse de doctorat, elle représente notre dispositif de recherche. Onze classes du postobligatoire du canton de Genève prennent part à l’enquête. L’activité culturelle est alors structurée en trois temps : la passation d’un questionnaire pré-visite, la découverte de l’exposition lors d’une visite guidée, la passation d’un questionnaire post-visite. Les données récoltées sont ensuite complétées par des entretiens avec les enseignant·e·s ayant accompagné leurs classes. Cette dernière étape du projet correspond à la phase de la réception du discours expographique, lors de laquelle visiteur·se·s dialoguent avec les contenus exposés, s’y confrontent, les interprètent et produisent un nouveau rapport aux savoirs.
Le couple recherche-création s’avère ainsi décliné sous deux formes : celle propre à l’exposition en tant qu’œuvre de réalisation, où la pratique artistique se mêle à l’approche historienne en vue de concevoir une démarche de transmission de l’histoire ; et celle propre à l’enquête, où l’exposition représente un dispositif de recherche permettant de collecter et analyser les opinions et les points de vue du public. Or, dans le cadre de ce texte, nous allons nous concentrer sur la première de ces deux dimensions.
En tant que concepteurs du projet, nous endossons une double casquette, celle de chercheurs en sciences sociales et celle de commissaires d’exposition. Dans une logique conjuguant visuel et spatial (Davallon, 1999), le questionnement guide la quête des traces matérielles du passé et leur traitement en vue de leur transmission : comment mettre en scène les écarts, les espaces de transgression et les mécanismes responsables de leur délimitation ? Comment l’approche historienne peut-elle investir la démarche d’exposition en vue d’explorer les réalités sociales les plus enfouies ? Comment raconter l’invisible du monde social ? Comment rendre protagonistes d’un récit à caractère historique, l’espace d’un instant, des personnes souvent reléguées à jouer des rôles passifs ou de deuxième plan ? Comment sonder les profondeurs des mondes sociaux au prisme d’une exposition ?
La genèse du projet réside dans son idée. À partir d’elle se développent des pistes pour la mise en place de l’exposition, scandée par une succession de phases – par moments synchroniques – qui s’influencent réciproquement et qui nourrissent l’écriture du scénario expographique jusqu’à sa spatialisation concrète. Monde utopique, espace de langage, univers imaginé, le questionnement investit différents degrés interdépendants de production de sens au sein de ce média. Exposer signifie réécrire un savoir qui préexiste au dispositif conçu pour le médiatiser au moyen de nombreux systèmes sémiotiques (Davallon, 1996). Ce geste relève d’un travail conceptuel et de création, d’une œuvre d’imagination et d’invention qui engage l’ensemble des personnes composant l’équipe de réalisation. Si c’est le commissaire d’exposition qui pose sa signature et qui est le garant de la cohérence du message, ce dispositif est le résultant d’une pluralité de voix qui s’expriment à l’unisson, chacune apportant ses spécificités à la fabrication d’un discours unique (Chaumier, 2018) : « une exposition est avant tout un objet issu de la mise en œuvre d’une technique. Elle est un artefact. À ce titre, elle répond donc à une intention, c’est-à-dire à un but ou à une volonté, de produire un effet. La chose est difficile à nier. Toute la question est de savoir ce qui est visé par cette intention ou, si on veut, quelle est la fonction assignée à l’exposition » (Davallon, 1999, p. 9).
Par l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises, nous souhaitons créer un espace depuis lequel les structures sociales et les dynamiques qui les gouvernent se trouvent interrogées (Sompairac, 2020), cherchant à raconter la Genève du XIXe siècle à partir de quelques catégories de la population qu’elle relègue dans ses marges. Notre positionnement engagé ambitionne l’émergence d’un questionnement chez le public venant ébranler certitudes et évidences dans une relation dialogique. Les questions de société orientent, dès lors, notre démarche, s’ouvrant au débat et à la mise en confrontation d’une pluralité de points de vue (Poli, 2002). Le message qu’elle délivre n’est donc pas un « prêt-à-penser », mais plutôt le produit d’une représentation de la réalité sociale avec laquelle se confronter lors de la visite.
L’exposition est un dispositif médiatique multimodal. Acte de monstration, fait de langage, en son sein, plusieurs registres langagiers sont mobilisés afin de donner forme à un propos destiné à être interprété par un public qui l’appréhende en se déplaçant dans un espace. Sur le plan sémiotique, le matériel de l’exposition obéit à deux opérations de traitement de contenu. Savoirs, connaissances et objets sont soumis à un traitement figuratif, c’est-à-dire la fabrication d’unités de présentation représentatives, et à un traitement narratif, soit la transformation du contenu en contenu exposable en vue de son appréhension par un public. Dimensions sémiotique et médiatique fusionnent entre elles dans un geste de communication ostensive (Davallon, 1999).
L’exposition n’impose pas, elle propose, c’est un ensemble de discours. À partir d’une lecture du monde, elle génère un propos dont l’énoncé se prête à une rencontre avec des modalités d’appropriation. En son sein, fond et forme, contenu et scénographie cherchent à narrer une histoire en étroite collaboration, mais ce n’est que lors de la phase de réception que le récit s’accomplit au travers de l’interprétation œuvrée par les visiteur·se·s. Suivant la thématique traitée, la nature de l’exposition et les objets déployés, elle s’avère un média qui en convoque d’autres. Dans un dispositif expositionnel ayant trait à l’histoire notamment, photographies, lettres, ouvrages et autres formes de témoignages sont autant de signifiants intégrés au sein d’une structure qui compose le message global.
Dispositif de communication, l’accès à son contenu étant public, l’exposition est à compter parmi les mass-médias. Ses spécificités structurelles répondent à trois registres de sens : linguistique, analogique et métonymique. Le premier ordre de sens est celui du langage et du symbole, il opère au moyen de relations signifiantes ; le deuxième est celui de la représentation basée sur la ressemblance et l’analogie, c’est l’univers de l’icône ; quant au troisième, c’est celui de l’organisation spatiale et du contact. Cette dernière dimension est celle qui confère sa spécificité à l’exposition : « c’est un mass-média dont l’ordre dominant, celui qui définitif sa structure de base, est l’ordre métonymique : l’exposition se constitue comme un réseau de renvois dans l’espace, temporalisés par le corps signifiant du sujet, lors de l’appropriation » (Veron, Levasseur, 1991, p. 34).
Concevoir une exposition ne signifie donc pas seulement présenter des objets et des textes. Pratique culturelle, c’est un travail d’écriture, de rythme, de brassage de textures et de connivences qui fait d’elle un média. C’est un outil dialectique dans un lieu d’interaction façonné par une alliance discursive et spatiale (Davallon, 1999).
Rédiger un scénario expographique s’apparente à une véritable œuvre d’écriture. C’est un geste de traitement d’un contenu en devenir qui se voit déployé dans un espace, une projection virtuelle d’objets et supports dans un lieu ayant ses propres caractéristiques architecturales. Cette esquisse accompagne la création d’une trame narrative d’après les objectifs fixés et fournit la base à la future spatialisation des objets et supports au sein de la salle d’exposition. Le canevas du projet s’élabore ainsi à partir du plan de la salle (Gonseth, 2011).
Le processus de scénarisation de l’exposition s’opère de la dimension macro à celle micro, mobilisant les multiples langages qui la caractérisent : architectures, scénographie, textes, objets, images, couleurs, lumières, etc., comme étant des éléments d’un ensemble (Poli, 2002). Ce mode d’écriture combine une orchestration de décisions opérationnelles et techniques associant découpages narratifs et séquences logiques en vue de structurer un dispositif destiné à communiquer un propos : « à travers l’écriture, le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir, selon un discours qui n’est plus épistémologique, mais dramatique » (Barthes, 2015, p. 19).
Conjuguant dimension spatiale et dimension narrative, le concept discursif qui structure la fabrication du scénario s’organise autour de plusieurs critères qui orientent sa rédaction. L’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises traite d’une thématique générale, composée de trois thématiques spécifiques représentées par les trois figures à partir desquelles nous chercherons à sonder la société genevoise du XIXe siècle : « aliéné·e·s », « indigent·e·s » et « détenu·e·s ». L’agencement spatial implique dès lors au moins une division trilogique de l’espace.
À chaque séquençage thématique correspond de fait une institution. Se traduit ainsi, en espace, une forme de spécialisation institutionnelle qui traverse la Genève du XIXe siècle et qui donne naissance aux institutions modernes telles que la prison pénitentiaire, l’asile des aliénés et l’unification de l’assistance publique sous l’égide de l’hospice général. Ce processus fonde le système d’assistance et de répression dont l’écho résonne encore aujourd’hui. Mais, à côté d’une division pragmatique de l’espace et des solutions formelles de séquentialité thématiques, se pose la question des potentialités du partage de l’espace en termes de vecteur de sens.
La matrice symbolique s’insère dans un agencement architectural esthétique et fonctionnel pouvant fournir des clés de lecture du propos expographique, produisant un supradiscours. Signifiant, cet aménagement spatial s’inspire du « panoptique » de Jeremy Bentham. Sans être vu, depuis un lieu central, ce dispositif permet d’observer et de surveiller tout ce qu’il se passe dans les espaces qui l’entourent, où les personnes qui s’y trouvent sont potentiellement sous un contrôle constant. Élément représentatif de la société de surveillance (Foucault, 2012), cette figure architecturale constitue le socle de la mise en scène, soutenant l’idée d’une surveillance généralisée de toute une partie de la population qui dévie des chemins battus, en défiant, pour des raisons diverses, l’ordre social.
Le recours à une telle structure souhaite représenter un regard surplombant, incessant et jugeant auquel sont soumises certaines catégories de la population. Ce choix découle de son influence sur la société genevoise du XIXe siècle. En effet, la construction de la prison pénitentiaire de la Tour-Maîtresse de Genève prend la forme d’un semi-panoptique apparent (Roth, 1981). Très fonctionnel, le plan panoptique avait également été proposé lors de l’édification de la Maison cantonale des aliénés2, mais il finira par être écarté en raison de sa connotation carcérale (Fussinger, Tevaearai, 1998).
L’importance que recouvre la notion d’espace au sein du dispositif expositionnel donne lieu à une spatialité signifiante qui se modélise à partir d’une figure archétypale et caricaturale : « il y a un rapport entre sa fonction et la figure qui la rend possible, qui a comme vertu esthétique, notamment, d’articuler l’échelle du proche (la cellule du condamné) et le lointain, la machine générale de la prison, le centre plein et sa périphérie, dans un même topos » (Sompairac, 2016, p. 112).
Cette installation garantit la cohérence logique du discours en jetant les bases d’une multitude de connexions entre les thématiques et les objets mobilisés pour en rendre compte. La spatialité intérieure qui en résulte présente une configuration formée des trois espaces thématiques aux propriétés très semblables, d’une structure centrale qui constitue un espace de transition entre le monde réel et l’univers utopique de l’exposition, ainsi qu’un cinquième espace, le hall du bâtiment, d’où l’on aperçoit le début du parcours et d’où l’on commence le voyage.
La mise en intrigue s’articule autour de questions, transversales et spécifiques, auxquelles il faut donner une réponse tout en composant avec l’impossibilité de réunir la totalité des facteurs et des causes ayant influencé un événement ou un fait du passé. Par un processus d’« élémentation » (Astolfi, 2008), il s’agit d’organiser un ensemble d’informations au sein d’un environnement cognitif propice à l’établissement de liens entre les objets, les connaissances et savoirs que l’on souhaite communiquer et le public qui interagit avec ces derniers par le biais d’inférences et d’interprétations (Davallon, 1996). Plusieurs horizons discursifs gouvernent de fait la rédaction du scénario.
La séparation des espaces thématiques fournit une logique qui structure la narration et, par la même occasion, produit une grille de lecture d’appréhension facile permettant au public de s’orienter dans la salle. En prenant appui sur des catégories partageant la population qui relèvent de constructions sociohistoriques, et dont nous souhaitons mettre en discussion les mécanismes à l’œuvre, les barrières sont porteuses, elles aussi, d’une forme de symbolisme à partir duquel émerge un questionnement. Ainsi, par la création de lieux de passages reliant la totalité de l’espace expositionnel, une forme de circularité vient interroger ces lignes de partage, offrant la possibilité de traverser d’une thématique à l’autre.
Au sein de chaque espace thématique, tel un récit se structurant en chapitres et sous-chapitres, le contenu est soumis à des opérations de séquençage. Disposé en unités d’information, le récit général est partagé en autant de microhistoires au fonctionnement indépendant (Chaumier, 2012). S’éloignant par ses spécificités d’une pratique livresque, dans un dispositif au caractère tridimensionnel, les rapports chronologiques et morphologiques permettent de déjouer une forme de linéarité contraignante, en s’appuyant sur la dimension marchante de l’appropriation du discours expographique. L’absence d’un cheminement imposé, exception faite pour l’entrée et la sortie, garantit une pleine autonomie au public dans la découverte des contenus, relisant et réécrivant, de fait, une trame personnelle et potentiellement différente à chaque visite.
Les multiples lignes de partage opérées sur un plan horizontal lors de cette rédaction s’accompagnent d’une mise en tension discursive entre le haut et le bas : une polyphonie énonciative qui donne la parole directement aux acteurs et actrices historiques, en opposant le point de vue des élites et des philanthropes genevoises à celui des personnes touchées par des mesures institutionnelles
Signes tangibles des événements, les objets représentent les traces physiques des sociétés et cultures passées et présentes, proches ou lointaines. Porteurs d’une dimension testimoniale qui relate l’activité humaine et des relations interindividuelles au sein des ensembles sociaux, ils contribuent à la construction des représentations symboliques des communautés dont ils sont distinctifs. Leur puissance évocatrice et la portée interprétative que l’on peut dégager participent à la compréhensibilité du monde. L’objet ne possède pas de valeur intrinsèque, l’expression de cette dernière mute en suivant la trajectoire biographique qui se déroule en diverses étapes. La destination fonctionnelle initiale – la fonction primaire de l’objet, celle pour laquelle il a été conçu – n’est qu’une première signification, le point de départ du trajet. La connaître signifie pouvoir connaître l’objet et s’approprier son histoire. Son statut est circonscrit par sa fonction en relation au champ d’utilisation à l’intérieur duquel il est inséré, transfigurant sa portée signifiante sans le transformer du point de vue morphologique. L’utilisation d’un objet est un acte de fabrication sociale et symbolique qui transforme sa signification (Bonnot, 2002).
La sélection des objets s’opère en vue de l’exposition, de leur monstration et du rôle qu’ils pourront endosser au sein d’un dispositif véhiculant un message. Leur pertinence et leur catégorisation se révèlent en fonction de leur future présentation. La quête de matériel, le dépouillement des archives et l’acte de collecte transforment le statut des objets par leur inscription dans un nouvel ensemble cohérent (Pomian, 1987). Leur polysémie est à nouveau investie en raison de la fonction qui leur est attribuée lors d’un dialogue rythmé et soutenu par la présence d’autres expôts et en relation avec le milieu ambiant (Hainard, 2007). Les objets sont ainsi mobilisés en tant que vecteurs d’intelligibilité dans un processus de fabrication d’un univers discursif, car « l’exposition est d’abord et avant tout un ensemble d’objets agencés spatialement » (Davallon, 1996, p. 398).
Tout objet est porteur d’une valeur communicationnelle, un pouvoir de raconter qui est lié à sa signification évocatrice. Fragments d’histoire de l’humanité s’y cèlent dans l’attente d’être révélés au grand jour par l’exposition à un nouveau regard par une nouvelle mise en scène. Exhibé au sein d’une exposition au milieu d’autres éléments avec qui dialoguer, il participe à l’écriture d’une nouvelle configuration narrative d’après les questions qu’on lui pose (Malagugini, 2008). Le geste de sélection s’opère à partir de la représentativité de l’objet et de son pouvoir d’essentialisation. Ce dernier doit être en mesure de parler aussi au nom des absent·e·s.
Afin de pouvoir matérialiser le récit fondé sur la mise en tension d’une multivocalité, la recherche se concentre, dans un premier temps, sur deux typologies distinctes d’objets pouvant nous permettre de rendre compte de la complexité des mondes sociaux sur lesquels nous souhaitons nous pencher. La quête de formes de témoignages datant du XIXe siècle commence, dès lors, par les traces écrites : les lettres et les livres. Les premières évoquent des fragments de vie d’aliéné·e·s, indigent·e·s et détenu·e·s et représentent les seules traces nous permettant de donner la parole aux individus et catégories subalternes. Manuscrites, parfois caractérisées par une maîtrise limitée de la langue française et des conventions épistolaires, leur nature est intime et privée. Elles ne sont pas conçues pour être exposées au regard d’un large public et, comme dans toute pratique d’écriture, le destinataire influence son contenu et la manière de le raconter, ce qui est dit et ce qui est omis, ce que l’on pense recevable et ce qui ne l’est pas. Conservées dans les archives, ces traces nous parviennent puisque les personnes impliquées se sont confrontées, à moment ou à un autre de leur vie, pour des raisons diverses, avec le pouvoir. Ces existences « n’ont et n’auront plus jamais d’existence qu’à l’abri précaire de ces mots » (Foucault, 2001, p. 242).
Images 7 et 8 - Communication clandestine, dilapidation de pain et refus de travail punis de deux jours de cachot, 15 jours de cellule dont quatre au pain et à l’eau.
© Archives d’État de Genève, Prisons Cf 87
Au travers de ces écrits, nous pouvons nous rapprocher des expériences de vies ordinaires, des « gens de peu », de leurs difficultés au quotidien, de leurs espoirs et incertitudes, mais aussi de leurs marges d’action. Outre nous fournir des informations quant à leur cadre de production, ces lettres sont d’une importance capitale pour comprendre la complexité du fonctionnement sociétal, car elles représentent les seules paroles à même d’offrir un contrepoint aux discours des élites politiques et économiques. Elles s’avèrent une manière de refigurer les oublié·e·s de l’histoire. Ces « témoignages singuliers sont la substance même de la réflexion historique » (Farge, 1997, p. 70).
Dans une exposition à trait historique, le recours aux témoignages, quelle que soit leur nature, revient à donner la parole aux acteur·rice·s, ce qui nourrit le récit de singularités. Inscrits, entre autres, dans le registre verbal du dispositif (Poli, 2002), ils supportent, non seulement, les propos du discours général, l’exemplifient et le complètent, mais peuvent aller jusqu’en devenir le protagoniste. Au lieu de parler à la place de quelqu’un d’autre, le commissaire crée un espace de parole pour les bribes de vécus à partir desquelles s’articule la démarche expographique. Ce travail nécessite de jongler avec les dimensions symboliques et émotionnelles propres au témoignage évoquant un sujet de caractère social (Idjéraoui-Ravez, 2012).
Quant aux livres, ils relèvent de plusieurs formats : ouvrages, mémoires, essais, codes de loi. Rédigés en vue de leur publication et de leur diffusion, ces objets nous permettent d’appréhender les discours qui soutiennent la fabrication des structures sociales qui régissent la vie en société. D’une écriture normée et maîtrisée, ils évoquent et expriment une certaine appartenance sociale, celle réservée aux élites, à la classe dirigeante. Cette rédaction est un exercice de pouvoir d’une partie restreinte de la population qui se trouve en position de domination. Elle relate des grands discours sur la pauvreté, sur l’aliénation mentale, sur la criminalité, ainsi que sur les mesures à mettre en place pour prendre en charge ces secteurs de la population jugés malheureux, mais dangereux pour l’ordre économique et social.
Aux côtés de ces deux premières typologies d’objets, un autre registre intègre notre collecte. Caractérisées par leur force évocatrice, leur efficacité communicative et leur dimension représentative, images et photographies relèvent d’une dimension compréhensive très intuitive (Malagugini, 2008). Les sociétés se dévoilent par la référence symbolique dont les images sont porteuses. Ces dernières exposent le contenu qu’elles subliment par le registre visuel, son décor et ses ambiances, mais relatent également de leurs conditions de production.
Le matériel photographique projette un instant passé dans l’instant présent : « ce que la photographie reproduit n’a lieu qu’une seule fois : elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. En elle, l’événement ne se dépasse jamais vers autre chose » (Barthes, 2019, p. 15). Ces différents degrés d’information qui se dégagent matérialisent visuellement des faits en les présentant comme réels : « l’évidence toujours stupéfiante de : cela s’est passé ainsi » (Barthes, 1964, p. 47).
L’image est une précieuse alliée dans la reconstruction du passé, qu’il s’agisse de livres d’histoire ou d’expositions. Cependant, si « l’évidence » dont elle est porteuse, cette « tentation du réalisme », s’avère très séductrice, l’image n’est pas la réalité, elle n’en est qu’une représentation (Burke, 2001). Elle cèle tout autant qu’elle montre, renfermant divers degrés dialectiques. Ceci convoque un travail d’interprétation de l’objet qui porte à la fois sur son contenu (les informations factuelles délivrées par l’image), tout comme sur son contenant (le discours de pouvoir qu’accompagne l’objet-image lui-même). Cadres de production et univers iconique entretiennent des rapports intrinsèquement étroits (Del Busto, 2020).
La photographie contribue à façonner et à médiatiser les imaginaires sociaux. Elle matérialise mœurs, modes de vie et hiérarchies sociales. Elle projette, dans le présent, l’image d’un moment plus ou moins éloigné dans le temps et dans l’espace à partir de laquelle spectateur·rice·s dégagent du sens, en interprétant sa polysémie (Bellasi, 1984). En tant qu’objet, elle décèle une dimension historique qui diffuse un jeu de trois temporalités : le temps représenté qui concerne le sujet immortalisé par l’objectif, le temps représentant qui désigne le contexte de production de l’image et le temps du visionnement, le moment où un regard s’y pose (Heimberg, 2011).
Tout comme pour les lettres, la quête d’images du XIXe siècle, commence, elle aussi par un travail de dépouillement d’archives. Le Centre d’iconographie de la bibliothèque de Genève3 conserve de nombreux fonds d’images, qui, dans notre cas, concernent essentiellement les institutions dont il est question dans l’exposition.
Si ces photographies répondent à un besoin de conservation de la mémoire, elles œuvrent également en faveur d’un travail de visibilisation et de promotion des institutions. C’est notamment le cas des établissements dédiés à l’assistance aux indigent·e·s où l’action sociale bénéficie de cette mise en scène.
Dans cette archive, aux photographies s’intercalent des cartes postales qui ouvrent à une nouvelle dimension dialogique entre témoignages écrits et images. La production de cartes postales répond à une logique de production d’un bien de consommation et de communication par laquelle l’on contribue à la circulation d’une certaine vision maîtrisée et contrôlée de l’institution. Là aussi, c’est une mise en scène qui véhicule l’image que l’on souhaite présenter.
La recherche de matériel iconographique se poursuit au sein des Archives d’État de Genève dans lesquelles nous découvrons un registre photographique des détenus4. Les portraits conservés dévoilent des visages formatés par la pose et la technique photographique inspirée par la méthode scientifique d’Alphonse Bertillon, visant la description, la classification et l’identification des criminel·les et des délinquant·e·s (Gilardi, 1978) : « dans les portraits artistiques et commerciaux, les questions de mode et de goût dominent tout. La Photographie judiciaire, dégagée de ces considérations, nous permet d’envisager le problème sous un aspect plus simple : quelle pose est théoriquement la meilleure pour tel ou tel cas ? » (Bertillon, 1890, p. 2).
C’est un processus d’objectivation de l’être humain inscrit au sein d’un « régime de visibilité » auquel la photographie participe activement. L’objectif de l’appareil photographique devient un instrument scientifique (Del Busto, 2020). En figeant les premiers visages de la déviance et en remplaçant les premières planches anthropologiques, elle contribue à un remaniement des représentations de la réalité sociale (Kalifa, 2013).
La prise d’image génère une trace et immortalise l’existence d’un événement en transformant son caractère souvent provisoire (Panattoni, 2011). Parmi les nombreux visages, deux images brisent la monotonie du registre par leur originalité. Non seulement elles s’écartent de la série dans laquelle elles sont logées en termes de sujet photographié, mais elles incarnent également la marge de manœuvre la plus importante que l’on puisse dégager au sein d’une institution totale : l’évasion.
Ainsi, par la recherche iconographique, la future narration de l’exposition incorpore une dimension visuelle aux trois thématiques. Images et photographies permettent de représenter les institutions en leur donnant une forme observable ayant un fort pouvoir d’évocation. Cartes géographiques et plans des institutions complètent ce registre visuel et offrent la possibilité d’observer la même ville, les mêmes lieux mais dans leur forme d’il y a plus de 150 ans. La variable géographique demeure, dès lors, statique tandis que le curseur du temps la traverse.
La scénographie n’est pas simple décor, c’est là que la part artistique du projet se concrétise. Dans un rapport interrelationnel, la forme subit l’influence du fond qu’elle contribue à véhiculer et à élaborer. Une fusionnante hétérogénéité de couleurs, matériaux, agencements, textures, ambiances sonores et lumières transforme en un élément physique le discours expographique, combinant dimensions esthétique et conceptuelle, composant avec le domaine du sensible et de l’intelligible. Rythmes, formes et mouvements matérialisent le domaine des idées et concepts dans celui du tangible et observable, percevable par les sens. Or, « considérons maintenant l’espace d’exposition comme le lieu réceptacle du discours. Voilà où peut-être la pratique artistique de l’installation influence l’évolution du langage de l’exposition » (Perron, 1992, p. 164).
La puissance visuelle de la mise en exposition est la première à entrer en résonance avec les registres de perception des visiteur·se·s de l’exposition, elle représente un premier niveau d’accrochage du public (Sompairac, 2020). Ainsi, la scénographie permet de voir le propos, de le lire visuellement : « la totalité du dispositif devient donc “hyperimage”, assemblage d’éléments scénographiés appartenant à la fois au registre de l’objet, du texte et de l’iconographie » (Gonseth, 2000, p. 159). L’impact des logiques spatiales et visuelles contribue à donner forme au dispositif et génère l’image de l’exposition.
Alors que le commissaire de l’exposition œuvre au niveau de la grammaire et de la syntaxe du discours, le scénographe5 travaille avec le registre morphologique et expressif du discours. L’entente entre les deux nécessite dynamique et grande complicité. La scénographie traduit le parti pris de son concepteur, la vision du monde qu’il souhaite partager et avec qui le public se confronte et débat. Le travail scénographique s’attelle, dès lors, à la réalisation d’une ambiance générale pouvant toucher l’intellect et la sensibilité du public (Poli, 2002).
L’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises se distingue par son atmosphère ambiante sombre, le noir étant la couleur dominante. Arrivé·e·s dans le hall du bâtiment qui héberge l’espace d’exposition, visiteur·se·s se trouvent face à la porte d’entrée de la salle qui s’ouvre sur un tunnel faiblement éclairé. L’introduction générale, suspendue à l’entrée, les informe des intentions communicatives du commissaire et de la vision qu’il propose par son discours. C’est une sorte de contrat, un pacte à partir duquel, une fois l’engagement du concepteur dévoilé, il sera possible de se confronter avec le contenu exposé.
Une ténue lumière au ras du sol invite le public à diriger le regard vers le bas où sont collées trois phrases de trois couleurs différentes, une pour chaque thématique6. Cette première amorce annonce le ton de l’exposition et souhaite entrer en résonance avec l’actualité.
En poursuivant leur chemin, visiteur·se·s se trouvent face à trois portes : « aliéné·e·s », « détenu·e·s » et « indigent·e·s ». Sur le plan de l’appropriation du dispositif, ceci comporte une première information : l’absence d’un cheminement imposé. Chaque personne est libre de commencer par la thématique qui l’intrigue le plus. Un film effet miroir sans tain collé sur les vitres des portes suggère l’idée de surveillance et de contrôle dont font l’objet ces différentes parties de la population.
De fait, registres esthétique et communicationnel modifient l’appareil langagier du dispositif. Le travail scénographique relève d’une alliance entre installation et mise en exposition, puisque l’individu pénètre droit au sein d’une œuvre signifiante contribuant à véhiculer le discours général : « l’espace d’investigation s’est déplacé des limites du cadre à celles de la salle et le regardeur est à l’intérieur de l’œuvre. À la manière d’un radar à la recherche d’un signal, il scrute alors l’ensemble de l’espace qu’on lui soumet et tente de décoder tout ce qu’il perçoit à la recherche de l’œuvre globale. En ce sens, l’installation apparaît comme un excellent, probablement le meilleur, procédé “interactif” de mise en valeur » (Perron, 1992, p. 164).
Les emplacements à l’intérieur desquels se déploie le discours expographique se situent à des degrés de signification variables. Parmi eux, il existe de « hauts-lieux signifiants » (Davallon, 1999) qui se distinguent en deux typologies. La première acquiert ce statut en raison de la grande concentration de renseignements qu’elle propose et qui permet d’appréhender le contenu de l’exposition, soient-elles des informations d’ordre contextuel ou organisationnel. Ainsi, après l’introduction générale située en début de parcours, trois introductions aux espaces sont placées près des portes thématiques afin de fournir des pistes de lecture et des éléments sociohistoriques plus spécifiques.
Quant à la deuxième typologie, elle concerne les sites dégageant une grande portée symbolique et qui favorisent la médiation entre l’univers de l’exposition et celui du public. Ce sont des intermédiaires vers cet « ailleurs » qui se matérialise dans la mise en scène de l’exposition. Dans l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises, ces points coïncident avec trois installations expressément conçues pour l’occasion et qui mettent au premier plan la correspondance d’aliéné·e·s, détenu·e·s et indigent·e·s.
Du côté des détenu·e·s, la présentation des lettres prend la forme d’un dispositif audiovisuel. Dans un coin de la salle, la projection d’une vidéo, dans laquelle défilent les images de la prison d’où les lettres ont été écrites, des photos de lettres ou des visages des personnes enfermées, s’accompagne d’une bande sonore au sein de laquelle une comédienne et un comédien prêtent leur voix aux détenu·e·s et aux membres de leur famille7. L’intimité du lieu, favorisée par l’utilisation d’un rideau noir, crée un emplacement délimité. Un banc invite visiteur·se·s à prendre place.
Concernant les indigent·e·s, nous optons pour la présentation d’une trentaine de lettres imprimées sur des feuilles et installées dans un meuble. Dans un autre coin de la salle, visiteur·se·s peuvent ainsi se servir et découvrir de manière aléatoire des instants de vie couchés sur papier. Chaque feuille comporte la photographie du document original au recto et la transcription de son contenu ou d’un extrait suivant la longueur du texte au verso8. Ici aussi, la présence d’un banc et d’un rideau noir souhaite inspirer une ambiance quasi confidentielle.
Quant aux aliéné·e·s, nous nous concentrons sur une correspondance exceptionnelle d’une extrême richesse. Le dossier de Madame F.9 comporte 30 documents où, aux lettres que cette dernière adresse au directeur de la police centrale et au département de Justice et Police, s’intercalent les réponses institutionnelles, telles que des enquêtes de police et des rapports médicaux. Ces écrits relatent le processus d’internement de cette femme. Suspendus au plafond par un fil transparent, des panneaux A4 comportent les photographies des documents au recto et la retranscription de certains extraits au verso. Là encore, nous avons recours aux voix de comédien·ne·s dont la lecture des extraits est diffusée par des haut-parleurs10. Cette installation commence du côté des indigent·e·s, en raison des conditions socio-économiques de Madame F., qui bénéficie d’une forme d’assistance, et se termine du côté des aliéné·e·s, car elle finira sa vie enfermée à l’asile.
Le choix de ces dispositifs contribue à fabriquer l’ambiance scénique et apporte une forme de nouveauté au schéma de l’exposition. Alors que la présence d’éléments répétitifs s’avère nécessaire afin d’assurer la cohérence narrative et faciliter le repérage et la compréhension des contenus à transmettre (Sunier, 1997) dans le but de maintenir éveillée l’attention du public, l’écriture expographique cherche à exploiter d’autres registres sensoriels et formats de présentation.
Dans les trois cas de figure, le rapport entre reproduction et original se réalise au travers de la mobilisation de la prise d’image photographique permettant de numériser des documents d’archives et de les rendre accessibles dans d’autres espaces publics, physiques et sociaux. Reproduire documents et images revient à questionner directement l’absence de l’objet par sa réplique. Le traitement numérique offre la possibilité d’inscrire le document au sein d’une nouvelle collection, d’une nouvelle mise en scène qui transcende également la substance papier dont il est composé, en concevant d’autres possibilités de présentation et en contribuant ainsi à rythmer la visite.
La reproduction joue avec la possibilité d’une confrontation avec la source elle-même. Visiteur·se·s en appréhendent les caractéristiques visuelles : couleurs, dimensions, détails, calligraphies et contenu. Différents supports peuvent être investis lors des tirages, en exploitant au maximum son potentiel de médiation inscrit au sein d’une scénographie que les images contribuent à générer.
En outre, alors que l’objet authentique est porteur d’un caractère unique, sa reproduction dans une exposition historique n’entraîne pas de perte de valeur, car la qualité reliquaire de l’objet lui-même est dépassée par le sens qu’il possède (Desvallées, 2006). La présence de l’image du document original accentue la véridicité du témoignage.
Or, l’histoire de Madame F. nous permet d’introduire ici les derniers hauts-lieux signifiants de notre exposition : les transitions thématiques. Une fois le seuil d’une porte thématique franchi, les visiteur·se·s sont libres de déambuler comme bon leur semble, traversant les barrières qui séparent les séquences thématiques ou en passant de nouveau par la structure centrale. Réalisés avec des barres d’aluminium et prenant la forme de barreaux, ces cloisonnements – rendus ainsi perméables et poreux – sous-tendent, d’une part, que les lignes de partage de la population n’étaient et ne sont toujours pas bien délinées et délimitées et, d’autre part, que ces catégories et étiquettes sont en déplacement constant suivant les époques et les sociétés. Dans le but de garantir une circulation complète entre les espaces, deux passages munis de rideaux permettent de connecter les deux thématiques séparées par le tunnel qui conduit à l’espace central.
Afin de renforcer le caractère symbolique et le questionnement de ces limites, des objets, des extraits de documents ou des citations soulignant la porosité de ces divisions sont présentés à proximité de ces lieux de transitions thématiques et accompagnent les visiteur·se·s qui les traversent.
La correspondance exposée implique un dernier niveau, plus intime, du rapport aux catégories. Dans les fragments de vie que l’on peut découvrir au travers de cette correspondance, certains chemins de vie franchissent, allant jusqu’à cumuler, les rapports aux différentes institutions et les étiquettes qu’y en découlent.
Dans le cadre d’une exposition, la présentation des objets (quelle que soit leur nature : documents, photographies, lettres, enregistrement audio ou vidéo, etc.) permet de matérialiser un propos. Une multitude de systèmes sémiotiques cohabite au sein de la logique narrative. Savoirs et connaissances que l’on souhaite transmettre trouvent dans les expôts un « prétexte » à la narration (Hainard, Kaehr, 1984), mais ces derniers sont des choses muettes, ils ne parlent pas d’eux-mêmes. Grâce à leurs singularités et aux significations qui leur sont accordées par le commissaire d’exposition, les objets deviennent des éléments à partir desquels développer un récit, vecteurs d’un acte de communication qui se joue entre transmission et compréhension, entre proposition et interprétation. En tant que composants d’une structure langagière, leurs particularités et spécificités contribuent à ériger l’ensemble du discours, faisant office de médiateurs entre l’univers de l’exposition et le public. Cela relève de l’interprétance interne, « c’est-à-dire le processus par lequel des éléments présents à l’intérieur du média facilitent la compréhension de l’ensemble » (Davallon, 1999, p. 184).
Le contenu est traversé par une mise en tension entre une histoire d’en haut et celle d’en bas, façonné par une polyphonie énonciative qui injecte des formes de singularités dans la narration historique. En s’appropriant le caractère dépaysant de l’histoire (Veyne, 1971), au croisement du fictionnel et du réel dans une alchimie de symboles et significations, l’exposition génère un espace-temps propice à interroger la complexité du monde (Sompairac, 2020). Les objets exposés devraient davantage servir de prétexte à une approche opérationnelle afin que visiteur·se·s puissent être mis·e·s en situation de pouvoir les interroger. Dès lors, « faire qu’une exposition communique demande à l’instance de production d’envisager un guidage de ce travail de reconstitution du savoir à partir des éléments disséminés à travers des objets, des textes, des lieux, des vidéos, des manipulations » (Davallon, 1996, p. 398).
D’entente avec la logique expographique, l’ensemble du matériel mobilisé compose « le tissu des signifiants qui constitue l’œuvre » (Barthes, 2015, p. 16) et le commissaire de l’exposition puise dans ce répertoire langagier afin de bâtir la narration. Textes, images, témoignages et autres composants convergent dans la scénographie qui donne corps au discours et participe à la transmission du message (Sompairac, 2016). Par un double mouvement, les objets contribuent à la création de l’image scénographique en même temps qu’ils en subissent l’influence : « la constitution d’une image scénographique ou hyperimage constitue donc un lieu et un moment particuliers et instables de la création et de la découverte d’une exposition, lieu ni trop éloigné, ni trop proche, moment ni trop long, ni trop court, où la coprésence de l’ensemble des éléments embrassés par un même regard à distance moyenne produit un effet de sens particulier, une émotion ou des potentialités d’association, par exemple » (Gonseth, 2000, p. 160).
Il s’agit, dans un premier temps, de repenser l’objet, sa perception, sa fonction, en vue d’un nouvel assemblage rhétorique. S’ensuit sa répartition spatiale au sein du nouveau contexte, compte tenu des particularités de l’espace d’exposition et des nécessités propres au moment de la visite.
La mise en scène expositionnelle s’avère, de fait, une combinaison de mouvements et de fonctionnements sémiotiques différents. Jean Davallon (Davallon, 1999) en identifie trois ordres :
Le travail d’interprétation auquel s’attellent visiteur·se·s peut être plus ou moins constant et intense. La visite se présente comme une découverte constante. Traitements rythmiques, graphiques, morphologiques, jeux de couleurs et de textures contribuent à la lisibilité de la trame narrative et à l’appréhension du propos expographique en facilitant l’interprétation et les activités inférentielles de la part du public. La distinction et la qualification des textes et des expôts qui peuplent la scénographie participent à la reconnaissance et à l’interprétation du sens des objets. Ce processus de déchiffrement investit également la mise en espace, la disposition et la scénographie – formes, couleurs, matériaux, structure, etc. – en tant que signifiants : « au cours de la visite, par le double jeu des combinaisons et des répétitions de traits, des effets de sens d’ensemble s’organiseront progressivement à partir des effets de sens attachés aux composants » (Davallon, 1999, p. 71).
Ainsi, dans le cadre de l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises, nous avons recours à un certain nombre d’éléments répétitifs, des aides afin de soutenir et guider l’appropriation du contenu. Par-delà l’attribution d’un code couleur à chaque espace thématique, repris au niveau des phrases collées au sol dans le tunnel, des titres sur les portes et des panneaux des introductions aux espaces, une première distinction formelle s’opère sur le plan des objets entre originaux et reproductions. Nous décidons de nous en servir pour souligner la multivocalité sur laquelle se bâtit la narration et qui se réalise dans l’opposition entre une histoire d’en haut et celle d’en bas.
Le point de vue des élites et des philanthropes est évoqué par la présence d’objets originaux du XIXe siècle, disposés dans des meubles en carton alvéolaire noir faisant office de vitrine. Le matériel est le même que celui employé pour la réalisation du tunnel. Très léger et malléable, il s’adapte parfaitement aux conditions propres à une exposition temporaire et participe, par sa couleur, à une atmosphère ambiante sombre.
Des extraits des ouvrages, essais et codes de loi sont retranscrits sur des panneaux suspendus au plafond, obligeant le public à lever la tête pour les lire, renforçant l’idée d’une vision surplombante.
Les deux colonnes présentes dans la salle sont également investies par la scénographie qui les transforme en meubles où sont exposés les codes de loi. Là aussi, des extraits d’articles de loi et d’appréciations à leur sujet sont transcrits et imprimés sur le carton.
Par contraste, dans l’impossibilité de se procurer les documents d’archives orignaux, les lettres des d’indigent·e·s, détenu·e·s et aliéné·e·s sont toujours des reproductions. Qu’elles soient présentées sous forme d’image imprimée, de projection audio-vidéo, ou de bande sonore, elles sont identifiables par rapport aux écrits propres aux élites qui sont des objets authentiques. La variation en termes de supports souhaite éveiller la curiosité et stimuler l’attention en évitant la surcharge de lecture (risque très élevé dans le cadre d’une exposition documentaire). La distinction entre lettres et livres ne concerne plus seulement leurs caractéristiques spécifiques de média, elle devient un facteur opérationnel de traitement de contenu. Dès lors, « les expôts forment des effets de sens qu’ils produisent en contexte par interrelation : les objets se fécondent les uns les autres par leur mise en correspondance, ils font naître un supradiscours, celui de l’interprétation par le visiteur qui les décode, et les réintègre à ses propres schémas interprétatifs produisant un hypertexte » (Chaumier, 2012, p. 75-76).
Dans un premier temps, le classement de ces différents objets est morphologique. Qu’ils soient originaux ou des reproductions, la subdivision procède par une séparation en catégories pour se concentrer ensuite sur son contenu qui en détermine l’emplacement au sein d’une thématique d’abord, puis au sein de chaque îlot. Dans une écriture spatialisée, les unités d’information sont ensuite disposées dans l’espace afin de tisser une trame narrative dont la construction et l’ordre relèvent des décisions des visiteur·se·s qui les découvrent en déambulant (Chaumier, 2012) : « l’exposition peut être considérée comme une figuration complexe d’unités d’étalement, composées soit de texte, soit d’images, soit d’une combinaison des deux, soit d’objets. La mise en espace de ces unités (l’étalement), définit un réseau de parcours possibles, qui est le support métonymique fondamental de l’exposition : envers/revers, visible/caché, droite/gauche, haut/bas, proche/lointain » (Veron, Levasseur, 1991, p. 40).
Textes et images se mêlent à plusieurs niveaux au sein de l’exposition. Ils habitent le même espace et œuvrent, avec leur portée communicationnelle spécifique, à la transmission du propos général. Le texte endosse une fonction rhétorique macro-discursive et intercède dans le discours expographique au niveau exoscénique et endoscénique (Poli, 2002) : il introduit, approfondit, identifie, nomme, découpe. Et surtout, il bénéficie d’une certaine autonomie parmi les différents systèmes sémiotiques à l’œuvre dans le dispositif expositionnel : « en ne lisant que le texte, le visiteur devrait normalement parvenir à acquérir une vue d’ensemble de la trame narrative » (Jacobi, 1996, p. 331).
Quant à l’image, elle aussi remplit plusieurs fonctions : du registre esthétique à scénique, elle intègre la scénographie en tant qu’objet sémiotique puissant, véhiculant un ailleurs auquel le public peut se référer pour accéder à la reconstruction d’une représentation visuelle du contexte évoqué. Par leur force de suggestion, « les photographies dans l’exposition participent d’un processus d’immersion des visiteurs dans le passé et dans les événements exposés » (Poli, Ancel, 2014, p. 61).
La mitoyenneté de textes d’images investit souvent les panneaux qui peuvent se présenter comme des unités d’information autonomes, composées de plages à lire et de plages à voir, donnant lieu à un panneau « scriptovisuel » (Jacobi, 1996). L’univers iconique cohabite, dès lors, dans un espace délimité voué à la production de connaissances, avec plusieurs éléments qui collaborent à la production de connaissances.
Par une combinaison des registres typographique et visuel, signes linguistiques et non linguistiques collaborent à l’unisson. De fait, « la scénographie ne peut faire l’économie de la question du traitement de l’information dans l’espace. C’est l’une de ses raisons d’être, s’agissant en particulier d’expositions documentaires, et dès lors, dans ces cas particuliers, c’est aussi un rapport intime avec la production graphique que cela s’annonce » (Sompairac, 2020, p. 76).
En construisant de nouvelles associations, ces gestes de présentation dessinent une configuration narrative qui façonne par la même occasion l’identité visuelle du dispositif. L’articulation dialectique des signifiants qui le traverse et le matérialise baigne dans une alchimie de sens qui puise ses éléments dans les registres symboliques et langagiers pour proposer un discours. La signification de ce dernier sera la résultante d’un processus d’appropriation et d’interprétation de la part du public, faisant jaillir la compréhension du propos (Davallon, 1999).
Dans le cadre de notre recherche doctorale, posture artistique et posture de chercheur s’allient et dialoguent dans l’acte de création : la conception et la réalisation du média expositionnel. Ce travail d’équipe est le format tangible de la présentation et de l’expression d’un discours scientifique que l’on veut rendre public (Grésillon, 2020). Il s’éloigne des colloques, conférences et séminaires cherchant à se démarquer de cet entre-soi qui les caractérise, pour emprunter d’autres chemins de médiatisation et de diffusion de la recherche académique auprès d’un public non spécialiste.
Penser et concevoir un objet médiatique influence le processus de recherche dès ses balbutiements. La programmation, la réécriture du savoir et les bornes structurelles du projet sont gouvernées par l’idée, l’intention et les objectifs envisagés. Le dépouillement d’archives, la collecte et la sélection d’objets et documents sont orientés par leur cadre de présentation et par leur rôle futur au sein du discours expographique. Le dispositif envisagé influence et dirige la réflexion et l’investigation de la réalité que l’on cherche d’abord à comprendre, puis à rendre intelligible et à raconter.
Dans le cadre d’un mass-média (qui englobe une pluralité de médias), espaces, objets, images, textures, couleurs, textes et autres supports sont soumis à un traitement figuratif et narratif, s’engageant comme autant d’unités ayant chacune leur singularité mais travaillant à la construction d’une structure narrative complexe et globale. Le registre de l’intelligible et celui du sensible entretiennent une relation dialogique, pierres angulaires d’un système de transmission-compréhension, ils sont convoqués dans la logique narrative qu’ils contribuent à façonner.
Le circuit de communication se termine par un acte d’interprétation lors de la visite qui se caractérise par une appropriation kinesthésique du propos (Davallon, 1996). Si la présentation influence directement l’appropriation du message, la dimension spatiale spécifique à l’exposition et la non-linéarité discursive qui peut en découler tracent des itinéraires potentiellement nouveaux à chaque rencontre entre le public et les objets exhibés. C’est pourquoi l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises est envisagée à la fois comme une fin en soi, mais aussi en tant que dispositif de recherche destiné à recueillir des données auprès des visiteur·se·s, afin de pouvoir confronter une hétérogénéité d’imaginaires par le biais du récit que nous avons mis en scène. Le cadre théorique rencontre, dès lors, la dimension empirique et le registre de l’analyse. La part artistique s’articule ainsi intimement à l’ensemble du processus de recherche.
2 Archives d’État de Genève, Aliénés A1, rapport sur le plan panoptique.
4 Archives d’État de Genève, Prisons Ce 56.
5 Le scénographe de l’exposition est Thierry Kleiner : https://www.combosition.com
6 Asile des Vernets, le 23 février 1893 : « Je demande ma sortie de cette maison officielle de scélérats, de voleurs de la pire espèce pour n’en pas dire plus ; du reste je n’ai ni de près ni de loin rien à foutre dans un milieu aussi infect et pourri que celui-là. Monsieur T. »
Prison de l’Évêché, le 23 mai 1896 : « Monsieur le Directeur Veuillez je vous prie maccorder de ne pas me coupés les cheveux ce moi silvouplait. De votre très humble serviteur B. »
Genève, le 22 octobre 1892 : « Monsieur le Directeur, Je viens par la présente demander à Monsieur s’il était possible d’obtenir des souliers pour moi et les enfants ne pouvant pas encore m’en acheter. Nous avons eu une tellement mauvaise année. Madame C. »
(Les trois couleurs n’ont pas de valeur symbolique. Elles servent uniquement comme points de repère et sont reprises lors des titres thématiques collés sur les portes, ainsi que dans le cadre des introductions spécifiques).
7 La vidéo est accessible ici : https://www.unige.ch/fapse/figures-de-l-ombre/detenus/lettres-détenus
8 L’ensemble des lettres présentées dans l’exposition peut être consulté ici : https://www.unige.ch/fapse/figures-de-l-ombre/indigents/lettres-indigents
9 La transmission de l’histoire de Madame F. a été revisitée grâce à une publication qui prend la forme d’un projet photo-éditorial : https://www.unige.ch/fapse/figures-de-l-ombre/publication
10 Afin de rendre accessible l’histoire de Madame F. dans un format numérique, à la fin de l’exposition nous avons réalisé un montage audiovisuel en synchronisant les lettres et documents institutionnels composant son dossier avec l’enregistrement des extraits lus par les comédien·ne·s : https://www.unige.ch/fapse/figures-de-l-ombre/alienes/Madame-F
ASTOLFI Jean-Pierre (2008), La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, coll. « Cahiers Pédagogiques ».
BACZKO Bronislaw (1984), Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, coll. « Critique de la politique ».
BARTHES Roland (1964), « Rhétorique de l’image », Communications, 4, p. 40-51.
BARTHES Roland (2019), La chambre claire. Note sur la photographie, 1re édition 1980, Paris, Éditions de l’Étoile, Gallimard-Le Seuil, coll. « Cahiers du cinéma ».
BARTHES Roland (2015), Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France prononcée le 7 janvier 1977, 1re édition 1978, Paris, Le Seuil, coll. « Points ».
BELLASI, Pietro (1984), « À propos du mouchoir de Gulliver : essai sur l’imaginaire miniaturisant », in HAINARD Jacques, KAEHR Roland (dir.), Objets prétextes, objets manipulés, Neuchâtel, Musée d’ethnographie de Neuchâtel.
BERTILLON Alphonse (1890), La photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques, Paris, Gauthier-Villars et fils, imprimeurs-libraires, Éditeurs de la Bibliothèque photographique.
BONNOT Thierry (2002), La vie des objets. D’ustensiles banals à objets de collection, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France ».
BURKE Peter (2001), Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, Ithaca, Cornell University Press.
CHAUMIER Serge (2012), Traité d’expologie. Les écritures de l’exposition, Paris, La documentation Française, coll. « Musées-Mondes ».
CHAUMIER Serge (2018), Altermuséologie. Manifeste expologique sur les tendances et le devenir de l’exposition, Paris, Hermann Éditeurs.
DAVALLON Jean (1996), « À propos de la communication et des stratégies communicationnelles dans les expositions de science », in La science en scène, Paris, Presses de l’École normale supérieure.
DAVALLON Jean (1999), L’Exposition à l’œuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique, Paris, L’Harmattan, coll. « Communication et Civilisation ».
DAVALLON Jean, FLON Émilie (2013), « Le média exposition », Culture & Musées, hors-série, p. 19-45.
DE CERTEAU Michel (1973), L’absent de l’histoire, Paris, Mame, coll. « Repères ».
DE CERTEAU Michel (1975), L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, coll. « Sciences humaines & sociales ».
DEL BUSTO Meira (2020), Cuerpos en el psiquiátrico, la mirada y la cámara : de la posibilidad de representación de la locura en el siglo XIX, Beau Bassin, Editorial Académica Española.
DESVALLÉES André (2006), « Mémoire, histoire, muséologie et vérités historiques », XXIX Encuentro Anual de ICOFOM. XV Encuentro Regional de ICOFOM LAM. « Museología e Historia : Un campo de conocimiento », [en ligne] http://docplayer.fr/9468245-Memoire-histoire-museologie-et-verites-historiques-andre-desvallees.html
FARGE Arlette (1997), Des lieux pour l’histoire, Paris, Le Seuil, coll. « La librairie du XXe siècle ».
FARGE Arlette, LAÉ Jean-François, CINGOLANI Patrick, MAGLOIRE Franck (2004), Sans visages. L’impossible regard sur le pauvre, Montrouge, Bayard.
FOUCAULT Michel (2012), Surveiller et punir, 1re édition 1975, Paris, Gallimard, coll. « Tel ».
FOUCAULT Michel (2001), « La vie des hommes infâmes », in Dits et écrits II. 1976-1988, Paris, Gallimard.
FUSSINGER Catherine, TEVAEARAI Deodaat (1998), Lieux de folie. Monuments de raison. Architecture et Psychiatrie en Suisse romande, 1830-1930, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Les archives de la construction moderne ».
GILARDI Ando (1978), Wanted! Storia, tecnica e estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria, Milano, Gabriele Mazzotta Editore.
GONSETH Marc-Olivier (2000), « L’illusion muséale », in GONSETH Marc-Olivier, HAINARD Jacques, KAEHR Roland (dir.), La grande illusion, Neuchâtel, Musée d’ethnographie de Neuchâtel.
GONSETH Marc-Olivier (2011), « Le jeu du tandem : relation expographe/scénographe au musée d’Ethnographie de Neuchâtel », in CÔTÉ Michel (dir.), La fabrique du musée de sciences et sociétés, Paris, La documentation Française, coll. « Musées-Mondes ».
GRÉSILLON Boris (2020), Pour une hybridation entre arts et sciences sociales, Paris, CNRS Éditions.
HAINARD Jacques, KAEHR Roland (dir.) (1984), Objets prétextes, objets manipulés, Neuchâtel, Musée d’ethnographie de Neuchâtel.
HAINARD Jacques (2007), « Le trou : un concept utile pour penser les rapports entre objet et mémoire », in DEBARY Octave, TURGEON Laurier (dir.), Objets & Mémoires, Paris-Québec, Éditions de la Maison des sciences de l’homme-Les presses de l’Université de Laval.
HEIMBERG Charles (2011), « Musées, histoires et mémoires, avec des élèves », Le cartable de Clio, 11, p. 119-132.
IDJERAOUI-RAVEZ Linda (2012), Le témoignage exposé. Du document à l’objet médiatique, Paris, L’Harmattan, coll. « Communication et civilisation ».
JACOBI Daniel (1996), « Les textes dans les musées des sciences et des techniques », in La science en scène, Paris, Presses de l’École normale supérieure.
KALIFA Dominique (2013), Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Le Seuil, coll. « L’univers historique ».
MALAGUGINI Massimo (2008), Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi, Milano, Edizioni Franco Angeli, coll. « Serie di architettura e design ».
MAZEAU Guillaume (2020), Histoire, Paris, Anamosa, coll. « Le mot est faible ».
PANATTONI Roberto (2011), « I volti della follia, come in una fotografia », in PANATTONI Roberto (a cura di), Parole e immagini dal manicomio. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento. Milano-Torino, Bruno Mondadori, coll. « Ricerca ».
PERRON Michel (1992), « L’exposition comme milieu d’exploration », in VIEL Annette, DE GUISE Céline (dir.), Muséo-séduction, muséo-réflexion, Québec, Musée de la civilisation et Service des parcs d’Environnement Canada.
POLI Marie-Sylvie (2002), Le texte au musée : Une approche sémiotique, Paris, L’Harmattan.
POLI Marie-Sylvie, ANCEL Pascale (2014), Exposer l’histoire contemporaine. Évaluation muséologique d’une exposition : Spoliés ! L’« aryanisation » économique en France 1940-1944, Paris, La Documentation française, coll. « Musées-Mondes ».
POMIAN Krzysztof (1987), Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires ».
RIOT-SARCEY Michèle (2016), Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris, La Découverte, coll. « Sciences humaines ».
ROTH Robert (1981), Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L’exemple de la prison de Genève (1825-1862), Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de sciences politiques ».
SCHMITT Jean-Claude (1978), « L’histoire des marginaux », in LE GOFF Jacques, CHARTIER Roger, REVEL Jacques (dir.), La nouvelle histoire, Paris, Éditions de Retz-C.E.P.L., coll. « Les Encyclopédies du savoir moderne ».
SOMPAIRAC Arnaud (2016), Scénographie d’exposition. Six perspectives critiques, Genève, Metis Presses, coll. « vuesDensembleEssais ».
SOMPAIRAC Arnaud (2020), Espaces scénographiques. L’exposition comme expérience critique et sensible, Genève, Metis Presses, coll. « vuesDensembleEssais ».
SUNIER, Sandra (1997), « Le scénario d’une exposition », Publics et Musées, 11-12, p. 195-211.
VERON Eliseo, LEVASSEUR Martine (1991), Ethnographie de l’exposition, 1re édition 1983, Paris, BPI – Centre Georges Pompidou, coll. « Études et recherche ».
VEYNE Paul (1971), Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, Le Seuil, coll. « L’univers historique ».
Federico Dotti, « Figures de l’ombre. Sonder les marges au prisme des démarches expographique et historienne », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 7 | 2023, mis en ligne le 21 juillet 2023, consulté le . URL : https://rfmv.fr