

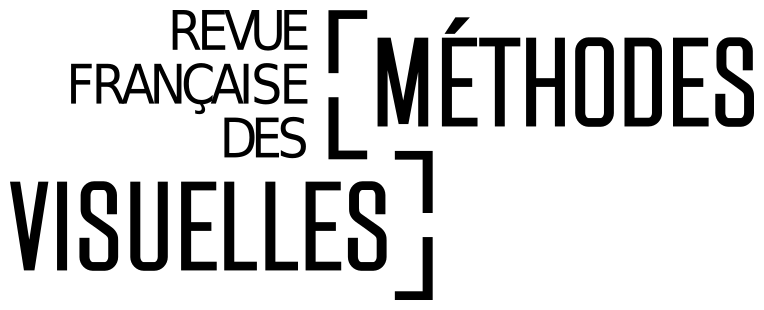
Daniel Vander Gucht, Professeur à l’Université libre de Bruxelles, GRESAC
Cet article entend contribuer à la réflexion sur la posture et le statut de chercheur consubstantiels à toute recherche artistique et scientifique orientée vers les mondes sociaux avec une finalité d’intervention sociale. Cette contribution vise, par ailleurs, à lever les ambiguïtés et les impasses d’un système académique qui continue à subordonner la recherche en art à la thèse universitaire en faisant fi de la nature même de ce que peuvent représenter la réflexivité épistémique, mais également les modalités de recherche, d’expérimentation et de questionnement propres à la pratique artistique.
Mots-clés : Recherche, Méthode, Hybridation, Épistémologie, Formation
This article intends to contribute to the debate on the posture and the status of any type of scientific or artistic research oriented towards the social worlds with a purpose of social intervention. My contribution also aims to remove the ambiguities and impasses of an academic system that continues to subordinate research in art to the university ph. doctorate standards by ignoring the very nature of what epistemic reflexivity can represent but also the methods of research, experimentation and questioning specific to artistic practice.
Keywords : Research, Method, Hybridization, Epistemology, Training
La question qui introduit à la problématique du dossier de ce numéro de la Revue française des Méthodes visuelles, consacré aux méthodes créatives dans les sciences sociales, telle qu’elle est formulée – « Comment se pense et se fabrique la recherche sur les mondes sociaux lorsqu’elle prend corps dans une forme artistique ? » – a pour avantage d’élargir d’emblée la réflexion à toutes les formes d’hybridation entre les sciences humaines et les arts et les lettres, mais également à toutes les entreprises artistiques ayant pour ambition de rendre compte de manière rigoureuse et informée de l’organisation des mondes sociaux et de la vie sociale en général. C’est ce qui, au-delà des sciences sociales stricto sensu, ouvre littéralement la porte et élargit le champ des méthodes créatives au théâtre comme à la littérature (depuis la querelle des doctes et des lettrés [Viala, 1985] et aux arts depuis qu’ils ont connu leur « tournant académique » qui en fit des arts libéraux – histoire retracée par Nathalie Heinich (Heinich, 1993) – capables de rivaliser avec les sciences et la poésie pour rendre compte et analyser les mondes sociaux concrets qui sont également au cœur de l’investigation sociologique. Cette approche prend, par ailleurs, le contre-pied du phénomène de spécialisation croissante que l’on constate dans tous les domaines du savoir et des pratiques universitaires qui se sont toujours arc-boutés sur une posture positiviste pour asseoir leur autorité et évincer toutes les formes concurrentes de savoirs sur les mondes sociaux. Cette manière de discréditer les approches jugées non orthodoxes par l’université est bien connue dans l’histoire des sciences et c’est, du reste, le mouvement académique lui-même qui a façonné notre paysage intellectuel, au point d’identifier modernité et spécialisation, avec ses cloisonnements et ses axiomatiques disciplinaires.
S’agissant d’identifier toutes les formes d’emprunts et d’hybridation, d’interférence ou d’interfécondation entre les arts et les sciences – voire entre l’épistémologie des sciences sociales et la praxis artistique – et, plus précisément, de repérer les écrivains et les artistes qui auront produit une œuvre de nature ou de portée sociologique. On pourrait encore élargir la longue liste des ouvrages déjà existants sur le sujet et s’interroger ad libitum sur le statut et la qualité professionnelle, du moins sur la nature et l’empreinte sociologique de photographes tels que Lewis Hine ou August Sanders, de cinéastes comme Jacques Tati, Frederick Wiseman ou Laurent Cantet, ou encore d’écrivains comme Honoré de Balzac, Émile Zola, Marcel Proust, Robert Musil, Georges Perec ou Annie Ernaux, parmi tant d’autres auteurs et artistes qui continuent à adopter ou à emprunter, qui un point de vue, une méthode d’enquête ou une théorie sociologique, psychosociologique ou ethnologique.
Nombre d’artistes basent, à partir des années 1960, leur travail sur le mode du journalisme d’investigation et de la sociologie critique, marquant un tournant décisif puisque faisant de l’artiste un enquêteur (Baqué, 2004 ; Caillet 2014, 2019), voire un médiateur apprenant à travailler avec les gens plutôt qu’un commissaire du peuple ou une conscience s’exprimant en leur nom1. Parmi ceux-ci, Hans Haacke, artiste allemand naturalisé américain, dresse et révèle systématiquement et impitoyablement, depuis les années 1960, le substrat socio-économique (l’« infrastructure ») des institutions culturelles prétendument désintéressées, mettant à mal la « dénégation de l’économique » qui serait au principe du « champ artistique » de Pierre Bourdieu – avec qui il partage la conviction que la liberté, pour l’art comme pour la science, consiste à mettre au jour le non-dit institutionnel, à « vendre la mèche », à jouer le rôle d’agent double. Dès novembre 1969, Hans Haacke administra un questionnaire aux visiteurs de la galerie Howard Wise à New York en leur demandant de préciser leur date de naissance et leur lieu de résidence, venant compléter, en direct, le profil sociologique des amateurs d’art à l’aide d’épingles plantées dans un tableau des classes d’âge et une carte géographique de la ville de New York. Ses enquêtes portent ainsi sur le recrutement social du monde de l’art, les rapports entre le monde de l’art et le marché immobilier, la composition des conseils d’administration des grands musées et les intérêts de ses membres dans le monde de la finance, de l’industrie et de la politique, soit les rapports entre l’art et le pouvoir en général2. On ne peut manquer de penser, ici, à l’usage fait par des artistes de l’arsenal méthodologique des sociologues et, plus particulièrement, de l’enquête par questionnaire standardisé, notamment dans l’étude internationale initiée par les artistes russes Vitaly Komar et Alexander Melamid. Adeptes d’une forme décapante et ironique de pop soviétique qu’ils qualifient de « Sots Art », faisant subir à l’imagerie du réalisme socialiste russe des outrages quasi dadaïstes, ils sont exclus des associations officielles d’artistes en URSS et doivent s’exiler aux États-Unis. En 1993, dans Painting by Numbers, leur critique aiguisée des conventions artistiques les amène à interroger les critères de goût, sur le mode des sondages d’opinion. Sur la base de questionnaires standardisés, administrés suivant les règles de l’art sociologique à des échantillons de population dans le monde, ils identifient les caractéristiques plaisant et déplaisant le plus dans une œuvre d’art pour chacun des pays et ont produit, à partir de ces données statistiques [d’où leur titre : « peindre selon des données chiffrées »], une modélisation du goût moyen – type idéal pour user du terme sociologique approprié –, soit le tableau préféré et le tableau le plus détesté de ces nations (Wypijewski, 1997 ; Bayar, 2005).
Une intuition partagée par beaucoup de sociologues de l’art est que les artistes peuvent se révéler des « sociologues en acte ». Ce qui ne signifie nullement que les artistes soient des auxiliaires de la sociologie, pas plus que de la psychanalyse ou de la philosophie politique du reste. Ils n’ont à vrai dire pas besoin du secours de ces disciplines – dont ils n’ont, le plus souvent, qu’une connaissance de seconde main – pour proposer un travail de critique sociale. Il n’en reste pas moins que nombre d’artistes contemporains – et non des moindres – ont manifesté plus que des appétences sociologiques dans leur démarche artistique critique, au point que Daniel Buren ressente le besoin de préciser qu’il a renoncé depuis à cette approche critique de l’art de peur de ne plus faire que de la sociologie (Buren, Heinich, 2014).
À partir des années 1970, comme un appel d’air, l’art se fait critique des conditions de vie et des croyances collectives de ce qu’on commence à appeler la société de consommation (Baudrillard, 1972) et du spectacle (Debord, 1967) où la « majorité silencieuse » (Baudrillard, 1978) ne s’exprime qu’à travers des sondages d’opinion, empruntant de fait, pour un temps du moins, les mêmes chemins que le sociologue. Songeons notamment au premier livre de Georges Perec, lui-même ancien étudiant en philosophie du sociologue Jean Duvignaud (Duvignaud, 1993), Les Choses (Perec, 1965 ; Leenhardt, 2014), relatant la vie d’un jeune couple de sondeurs d’opinion vivant dans les grands ensembles, au premier film sociologique réalisé par Jean Rouch, père du film anthropologique, et le sociologue Edgar Morin en 1960, Chronique d’un été, aux deux films de Jean-Luc Godard de 1966, Masculin-féminin et Deux ou trois choses que je sais d’elle – conçus comme de véritables enquêtes sociologiques – ou encore au film réalisé en 1973 par le dessinateur Gébé et Jacques Doillon, Alain Resnais et Jean Rouch, L’An 01 avec cette phrase emblématique : « Si on faisait un pas de côté au lieu de sonner chez soi on sonnerait chez le voisin ! »
Innombrables sont les expériences artistiques contemporaines qui se jouent de ce type de décalages et de recadrages de la vie ordinaire, quotidienne et routinière dans le but de révéler, à la fois, les ressorts du fonctionnement dit « normal », au sens sociologique du terme, de notre mode de vie par l’irruption d’un élément perturbateur et faire émerger à la conscience la possibilité de se réapproprier sa propre vie et de produire du lien social. L’art devient un catalyseur, voire un antidote, aux industries de la conscience. Il se fait résistance aux impositions culturelles et partage, avec les sciences humaines, un pareil dévoilement des représentations sociales dominantes et de la doxa, des formes de pouvoir et de violence symbolique à l’œuvre dans la société via la culture tandis que la société devient elle-même le matériau de l’intervention artistique et sociologique. Cet art contemporain, qui a intégré les données et les enseignements des sciences humaines, travaille à dissoudre les frontières disciplinaires, mais, surtout, les frontières de l’art et de la vie en associant le spectateur à l’œuvre de manière participative. La philosophie de cette entreprise est fournie par le mouvement Fluxus3 et magistralement formulée par Robert Filliou qui déclarait que « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » – ce qui devrait ainsi rendre sans objet la sempiternelle question : « Est-ce bien encore de l’art ? » (Filliou, 2003). Ce travail artistique impliqué dans la vie de la communauté a déjà une histoire longue d’un demi-siècle dans l’histoire de l’art international (qu’il me suffise d’évoquer Joseph Beuys, Allan Kaprow, Gordon Matta Clarke, Lygia Clark, Krzysztof Wodiczko, Jochen Gerz, Thomas Hirschhorn) et mobilise un nombre considérable d’artistes professionnels dans le monde, même si leurs actions ne se retrouvent généralement ni au musée ni dans les foires commerciales d’art. Cette manière d’activisme artistique repose sur deux axiomes de base implicites : le premier stipule que la vie en société est le matériau et l’espace que travaille l’artiste, au sens où Joseph Beuys parlait de « sculpture sociale » (Beuys, 1988) ; le second considère que les relations qui constituent la vie sociale sont bien une affaire de formes. Les problèmes humains sont liés à la représentation et les problèmes relationnels sont aussi des problèmes de forme ; c’est du reste ce qui rend le travail des artistes avec les personnes atteintes de troubles mentaux, ou prises dans des relations conflictuelles, particulièrement intéressant et profitable car ils peuvent contribuer à dénouer des nœuds, échapper aux routines et sortir des formes convenues ou compulsives en imaginant de nouvelles configurations possibles. Confronté à des situations critiques et à des questions relationnelles et sociales, le travail de l’artiste est d’autant plus précieux qu’il les aborde en qualité d’artiste et non de thérapeute ou de sociologue, lui permettant de mettre en pratique son savoir et ses compétences en matière de formes. Ces actions artistiques, qui sont autant d’histoires de relations et d’expériences vécues et partagées, sont pleinement et directement concernées par l’organisation de la vie en commun. La représentation du monde que nous propose l’art est moins spéculaire que spéculative. En ce sens, convoquer l’art pour savoir où nous nous situons dans le monde consiste non pas à nous voir à travers un objectif ou à contempler notre reflet dans un miroir, mais à faire l’expérience d’un rapport au monde qui nécessairement « ébranle le sens du monde » (Barthes, 1963, 11), comme le dit Roland Barthes à propos de la littérature, en donnant à penser ce qu’il pourrait être plutôt qu’en donnant à croire qu’il n’est que ce qu’il est – programme commun, encore une fois, à la sociologie critique comme à l’art spéculatif impliqué dans la vie sociale. C’est du reste ce qu’exprime Allan Kaprow, reconnaissant, pour sa part, que les situations vécues évoquées comme exemples d’« art ressemblant à la vie » (« lifelike art ») n’ont ontologiquement rien d’artistique et qu’elles pourraient, dit-il, « être étudiées de manière plus appropriée par les sciences sociales, s’il fallait absolument les étudier » (Kaprow, 1996). Mais sans doute la qualité artistique, ou pour mieux dire poétique, de ces expériences esthétiques tient-elle précisément, pour ces artistes, à l’adoption d’une posture résolument non scientifique et non idéologique alors même qu’elles prennent pour matériau la société : elles relèvent exclusivement de l’expérience sensible ; elles sont exemplaires et non démonstratives ; elles donnent à voir et à penser, mais ne prétendent rien prouver ; elles ne nous convainquent pas, mais nous émeuvent et nous perturbent ; elles empruntent la voie du partage d’expériences sensibles (non réductibles à la sensibilité) et non de la transmission de savoirs ou de l’élaboration d’une doctrine.
Les premières expériences associant de manière plus intime chercheurs en sciences humaines et artistes prennent la forme de collectifs renouant avec l’idée de laboratoire où se mène la recherche collective. Ces derniers marquent ainsi leur rupture avec le régime artistique de la singularité irréductible de l’artiste, mais aussi bien avec la figure de l’« intellectuel charismatique » de type sartrien comme maître à penser, au profit de la figure de l’« intellectuel spécifique » dont les convictions politiques sont fondées sur la spécificité de sa discipline intellectuelle, comme préconisé par Michel Foucault, ou encore de l’« intellectuel collectif » mis à l’honneur par les sociologues du collectif « Raisons d’agir » réunis autour de Pierre Bourdieu, et dont l’engagement citoyen est la résultante du fruit des recherches conduites par une communauté scientifique sur des questions sociales. Je pense plus particulièrement ici au Collectif d’art sociologique dont l’intention consiste explicitement, comme l’exprime Fred Forest, à « essayer de réaliser dans l’agir l’épanouissement de la créativité, non par une évasion ou une fuite hors du réel social, mais dans sa confrontation avec lui dans le but de le modifier, de le transformer » (Forest, 1977, p. 46). Comme le dit très justement le sociologue Jean Duvignaud, ces artistes n’ont de cesse « de prendre les gens au piège de leur propre représentation » (Forest, 1977, p. 16). Ces interventions d’art sociologique ont à voir avec les « recherches-actions », la « socio-analyse », l’« observation participante » et l’« analyse institutionnelle » qui rencontrent un engouement particulier durant ces années 1970 (Fischer, 1977). Ce qui ne surprend guère quand on sait que le Collectif d’art sociologique fut fondé en 1974 par un artiste vidéaste (Fred Forest), un sociologue (Hervé Fischer) et un psychologue (Jean-Paul Thévenot). Il ne s’agit pas pour autant, pour les artistes, de se faire sociologues et, pour les sociologues, de se prétendre artistes, mais d’initier un nouveau dialogue entre art et sciences humaines. Ainsi, la soutenance de thèse d’État à la Sorbonne en sociologie de Fred Forest, agent des PTT4 sans formation, ne doit pas être prise comme un gage de scientificité de l’art sociologique, mais plutôt comme une action d’art sociologique questionnant l’institution universitaire et ses procédures, comme l’indique l’omniprésence de la caméra vidéo de Fred Forest filmant l’intégralité de la cérémonie. Les départements universitaires de sciences de l’information et de la communication et de philosophie des sciences relayeront les travaux de chercheurs scientifiques qui partagent cette même épistémé5.
L’objet de l’art sociologique n’est plus confiné au « monde de l’art », mais prend la société elle-même – définie ici comme « intersubjectivité » – pour matériau d’action et d’étude. Comme l’écrit encore Fred Forest, « pour l’“artiste sociologique”, le problème n’est donc plus de savoir que représenter, comment le représenter, mais comment provoquer la réflexion sur les conditions mêmes de notre environnement social et ses mécanismes » (Forest, 1977, p. 196). La finalité de cette entreprise consiste ainsi à proposer une sorte de plateforme épistémologique et méthodologique pouvant accueillir sur un pied d’égalité artistes et scientifiques appelés à collaborer pour questionner le monde social en faisant montre d’« imagination sociologique ». Tous intégrent les méthodes de recherche éprouvées des sociologues comme des artistes (plasticiens, cinéastes, écrivains, etc.) qui arpentent nos territoires pour enregistrer leurs temporalités et leurs ambiances, comprendre, exposer et analyser les pratiques, les discours et les logiques de leurs habitants à l’aide de protocoles d’enquête, de repérage et d’entretiens éprouvés. Ils organisent des actions artistiques de rue conçues comme des manifestations d’une sociologie impliquée, au sens où elle produit des effets de connaissance et de conscience qui affectent directement la réalité vécue.
Le cas de figure qui nous occupe relève donc clairement des emprunts ou de l’inspiration que les sociologues eux-mêmes vont chercher du côté des arts et des lettres pour étoffer, renouveler ou enrichir leur propre arsenal d’outils et de techniques d’abordage et de questionnement du monde social en découvrant et en libérant toujours davantage leur imagination sociologique, comme le recommande depuis longtemps Howard Becker (Becker, 2009). En revanche, nous voudrions prévenir contre cet attendu commun selon lequel les méthodes créatives seraient à aller chercher du côté artistique, voire jusque dans notre « part artiste », comme si la créativité ou l’imagination étaient de fait des attributs et des qualités proprement artistiques et non scientifiques. Du conte philosophique au roman naturaliste, réaliste, expérimental ou à thèse (Girard, 1983 ;Broch, 1985 ; Dubois, 2000 ; Bouveresse, 2008 ; Barrère et Martuccelli, 2009) jusqu’au tournant linguistique qui a redéfini la sociologie et l’ethnologie comme des narrations ou des récits, fussent-ils non fictionnels (Rorty, 1967 ; Geertz, 1996 ; Berard, 1998 ; Clifford, 2003), de la photo et du cinéma documentaire ou d’investigation à la sociologie visuelle ou filmique (Vander Gucht, 2017), et des arts plastiques dans leur moment sociologique et relationnel (Bourriaud, 1998 ; Ardenne, 2000a, 2000b, 2002 ; Vander Gucht, 2014) ou sémiologique et ethnologique (Foster, 2005) jusqu’à la recherche-action et création dans le monde académique au tournant du XIXe siècle, il n’y aurait ainsi plus de solution de continuité.
Et l’on sait les positivistes acharnés à invoquer régulièrement la botte secrète du sociologue patenté que serait la « neutralité axiologique » et à défendre cette fameuse « rupture épistémologique » qui distinguerait, de manière incontestable, la science sociologique du sociologisme vulgaire, voire de la vulgate sociologique et la prémunirait de l’engagement politique, mais aussi des arts et de la littérature qui ne feraient que la contaminer par leurs approximations et leurs élucubrations non validées par des protocoles scientifiques auxquels je reste moi-même attaché par déformation professionnelle mais aussi parce que je continue à croire en leur vertu heuristique. Dès lors, plutôt que de chercher à développer la « part artistique » du chercheur ou de travailler à dissoudre les exigences de la science sociologique pour la fondre dans un hypothétique savoir empirique, voire dans une pratique chamanique du monde qui est aux antipodes de la conception que je me fais du savoir sociologique, serais-je plutôt enclin à réévaluer les rapports et les similitudes comme les différences entre ce qu’on qualifie de « recherche » en art et en science, ou plus précisément dans les sciences sociales. Ne pas opposer ni confondre, mais conjuguer, telle est la nature de la complexité du réel et le principe de la fécondité de la connaissance, telle est aussi la marque de l’intelligence sociologique qui se distingue du sectarisme disciplinaire et corporatif. Il me paraît en effet crucial de rappeler aux étudiants en sciences sociales, puisque l’enseignement universitaire est l’une de mes fonctions et attributions professionnelles, que la méthode ne se borne pas à l’application mécanique de protocoles et de dispositifs de recueil et d’analyse de données selon des techniques éprouvées. Elle consiste, selon les préceptes de Charles Wright Mills (Wright Mills, 2015), à faire preuve d’« imagination sociologique » afin de se mettre, non pas dans la peau, mais bien dans la situation de l’autre (ce qui est différent de l’empathie), mais aussi de poser un regard curieux sur sa propre société sous des angles inédits, soit de « changer de perspective à volonté », de développer cette faculté imaginative qui questionne à chaque fois les apparences du monde social (sa phénoménalité plutôt que sa phénoménologie) à nouveaux frais, de se servir de manière instrumentale et non dogmatique des théories pour questionner le réel. Il convient d’interroger à la suite de Georg Simmel les formes de la vie sociale6 en tant qu’expérience et interaction, quitte à s’inspirer des artistes pour rafraîchir notre regard, élargir notre gamme sensorielle et émotionnelle, renouveler notre équipement d’investigation du réel et même nous déniaiser sur le plan narratif en prenant, pourquoi pas, quelques leçons d’écriture auprès des écrivains de notre temps plutôt que d’entretenir cette illusion positiviste elle aussi d’une écriture neutre, car non questionnée ni problématisée. Le sociologue se doit donc d’inlassablement se décentrer, à l’instar du Candide de Voltaire ou du Persan de Montesquieu. « Je est un autre » écrivait Rimbaud, cette magnifique formule nous ramène à la posture fondatrice de la sociologie qui consiste en cette distanciation nous rendant étrangers à nous-mêmes, comme le suggère la devise humaniste du poète romain Térence que le sociologue américain Charles Wright Mills proposait en guise de programme pour la sociologie : « rien d’humain ne m’est étranger » (Wright Mills, 1959).
Dans un cadre épistémologique hypothético-déductif de la science paradigmatique, il y a découplage de la recherche (le chercheur répond à une question théorique en validant ses hypothèses) et de l’action (intervention ou action participative sur le terrain pour modifier une situation en fonction des résultats de la recherche), de sorte que le savoir théorique validé scientifiquement soit également la réponse appropriée à apporter sur le terrain. La recherche-action opère ainsi un renversement de perspective qui repose sur une méthode inductive ancrée dans le terrain afin d’identifier une question émergente pouvant faire l’objet d’une montée en généralité ou non, mais où, selon les principes de l’analyse institutionnelle de René Lourau (Lourau, 1974), c’est l’action collective qui produit l’analyse de la situation et non l’application d’une théorie toute faite.
Dans le cas de la recherche-création basée sur le même modèle méthodologique, la recherche sociologique – qui identifie les rapports de force en présence dans des situations concrètes de la vie quotidienne ou ordinaire – s’associe avec la création artistique – qui travaille les relations et les représentations sociales à partir de leurs formes –, pour imaginer, recadrer et transformer des situations bloquées ou stériles avec les acteurs sociaux de terrain. Il s’agit donc d’agir sur les forces sociales à travers leurs formes sociales de manière réflexive, spéculative et critique – soit en expérimentant des situations de vie comme sont habilités, sinon habitués, à le faire les sociologues comme les artistes. La recherche équivaut, ici, à l’expérimentation de l’humain, non pas en situation de laboratoire, mais bien in vivo dans les conditions de vie réelle où l’on pratique la participation observante plutôt que l’observation participante, ou pour le dire plus simplement, où l’expérimentation se fait au cas par cas avec la coopération, plus qu’avec le simple consentement des participants. Soyons clairs, s’il y a ici une part créative, elle ne porte pas directement sur la création d’œuvres, d’objets ou de théories, mais bien sûr la création de situations et de conditions d’existence, à partir de rencontres et d’expérimentations du vivre-ensemble dans l’esprit de ce que proclamait Jeremy Deller lorsqu’il expliquait en ces termes son parcours d’artiste : « I went from being an artist who makes things, to being an artist who makes things happen [J’étais un artiste qui fait des choses et je suis devenu un artiste qui fait que des choses se produisent] » (Thompson, 2012, p. 17).
Cela ne signifie nullement que la recherche artistique procède des arts appliqués, pas plus que la recherche sociologique et les sciences humaines en général ne sont de la recherche appliquée orientée vers la formulation de solutions pratiques à des problèmes sociaux – ce qui relève, du reste, plutôt de la mission du politique que du scientifique qui, lui, va préalablement convertir ces problèmes sociaux (pourquoi les choses ne se déroulent-elles pas « normalement », c’est-à-dire « habituellement » ?) en questions sociologiques (qu’est-ce que la « normalité » ? De quoi la crise est-elle le signe ? Quels sont les forces et les rapports de force en présence pour édicter et imposer nos normes sociales ? etc.). La recherche en art, comme en science, consiste à questionner plutôt qu’à formuler des réponses forcément provisoires, partielles et dictées par une conjoncture (les modes artistiques et intellectuelles qu’on appelle en termes savants des paradigmes, reposant eux-mêmes sur des axiomes indémontrables) et par un champ de spécialisation régulé par des experts qui appliquent des critères de validité artistiques et scientifiques déterminés. En ce sens, la recherche-création valorise le processus de pensée artistique ou scientifique plutôt que la production d’œuvres ou de théories, s’apparentant ainsi au combat de la recherche fondamentale si mal comprise des pouvoirs publics comme du grand public. Elle représente également un défi encore non rencontré par ces chercheurs qu’on persiste à soumettre à un exercice de « théorisation de la pratique » alors qu’il s’agirait plutôt d’opérer une réelle révolution épistémologique consistant à « réinterroger la dimension incarnée, sensible, affective, de la pensée et des savoirs, en rompant avec le positivisme de la démarche scientifique », comme le dit Mireille Losco-Lena, professeure des universités en poste dans une école d’art française (Losco-Lena, 2017 ; Prévot et Rioual, 2018). Révolution qui nous mettrait également en garde, avec un grand à-propos, contre le risque d’instrumentalisation de la pratique artistique, forcément réflexive et expérimentale, même quand elle n’est pas théorisée et explicitée par les formes autorisées de production et de présentation du savoir universitaire (écrits théoriques ou conférences) sous le prétexte potentiellement mortifère pour la recherche artistique de la rendre modélisable, transposable et rentable dans une visée productiviste et utilitariste. Et cela alors que le financement des arts est de plus en plus soumis à des justifications administratives et à des critères de légitimité scientifique (Delacourt, 2014, p. 5).
Si le sociologue académique met souvent un point d’honneur à montrer la société telle qu’elle est et à expliquer pourquoi elle est ainsi et pas autrement, n’en déplaise aux tenants de l’orthodoxie, le sociologue peut également imaginer ce que la société pourrait être en en suivant le penchant de ses valeurs et de ses convictions qu’il ne peut indéfiniment faire mine d’ignorer et en les jaugeant à l’aune de son savoir spécialisé – Émile Durkheim, Max Weber, Charles Wright Mills, Anthony Giddens ou Pierre Bourdieu ne firent jamais rien d’autre en sociologues impliqués à défaut d’être engagés. Sans céder à un quelconque messianisme, il semble assez naturel et fondé que tout sociologue et tout artiste concerné par le sort de ses semblables soit tenté de descendre de l’Olympe et d’agir sur et dans le monde pour faire fructifier et partager son savoir et son savoir-faire. La recherche scientifique et artistique se fait alors « recherche-action » et « recherche-création ». Ces collaborations, parfois hybrides, parfois transdisciplinaires, trouvent de plus en plus souvent un écho, voire un asile, dans les écoles d’art et les universités. Toutefois, le terme même de « recherche-création » ne semble pas encore univoque dans la mesure où il est parfois encore utilisé comme simple synonyme de « recherche artistique » dans les écoles d’art et, dans le contexte des doctorats en art et science de l’art conduit en co-tutelle entre une université et une école supérieure d’art, ces thèses au jury bicéphale demeurent encore trop souvent scindées entre une partie de « pratique » artistique et une partie de « théorie » universitaire. La « thèse » proprement dite apparaît alors comme la partie discursive et réflexive du travail qui ne peut s’exprimer qu’à travers le logos sur le modèle des thèses d’histoire de l’art ou d’esthétique. Tout se passe comme si le binôme recherche-création n’allait toujours pas de soi et renvoyait plutôt au dualisme théorie-pratique, ou comme si la recherche en art ne concernait que le niveau méta de la pratique. Comme le répète à juste titre Howard Becker, « il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie » (cité dans Becker, 1986). Rappelons, à cet égard, qu’une théorie n’est qu’un outil plus ou moins bien adapté pour questionner la réalité du monde et qu’elle ne vaut que si on peut la mettre en pratique, qu’il s’agisse des sciences dites exactes ou des sciences humaines. Il est du reste symptomatique que l’on continue à faire un distinguo entre le chercheur-artiste (le scientifique qui explore des voies non conventionnelles, renvoyant à cet archétype de l’artiste comme être excentrique, original, imprévisible et apparenté à la figure de la folie, de la neurasthénie et de la mélancolie7 ) et l’artiste-chercheur (l’artiste qui pense, car, selon cet autre cliché de l’artiste8 fantasque, il serait plus habitué à rêvasser, à délirer ou à s’amuser qu’à travailler, étudier et produire) étant (sous-)entendu qu’un chemin ne vaut pas l’autre. On persiste ainsi à opposer l’affect et le percept associés aux arts par les effets induits au concept qui serait l’apanage de la philosophie et des sciences qui le produisent, niant de la sorte toute forme de pensée artistique.
En Belgique9, qu’il s’agisse de la Communauté flamande ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les ponts entre les écoles d’enseignement supérieur artistique et les universités sont récents et timides. Ils se limitent, en réalité, à l’école doctorale 20 qui organise des thèses de « doctorat en art et science de l’art » pour les étudiants en art entre une école d’art et une université, le promoteur étant un professeur du corps académique universitaire et le co-promoteur, un professeur d’une école d’enseignement supérieur artistique de type universitaire (EsA). Le programme doctoral y est conçu sur le modèle universitaire des thèses en histoire de l’art et en esthétique. Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, que les écoles d’art, qui disposent au demeurant de professeurs de cours théoriques extrêmement compétents, se sentent déconsidérées par les pouvoirs publics de tutelle comme par leurs collègues universitaires. Des enseignants des écoles supérieures artistiques belges avaient pourtant déjà bien pavé la voie d’une reconsidération de la recherche en art en rédigeant les principales missions de cet enseignement supérieur artistique, précisant notamment que « L’enseignement artistique dispensé dans l’enseignement supérieur se doit d’être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lequel les arts et leur enseignement s’inventent de manière indissociable. Les arts qui s’y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales, mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l’évolution et à la transformation de la société. En prise sur les leçons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l’enseignement de l’art est prospectif, il stimule l’ouverture au futur, à l’inédit » (Décret relatif à l’enseignement supérieur artistique du 17 mai 1999, art. 3, partie 1). L’effet pervers de ce décret, comme le souligne Bruno Gosse, enseignant en école d’art et président de l’association A/R (pour Art/Recherche) qui promeut la recherche en art en Fédération Wallonie-Bruxelles (à qui ce décret doit beaucoup), aura été que la recherche soit dorénavant exclusivement identifiée qu’aux troisièmes cycles des études en art, soit les études doctorales en art calquées sur le modèle universitaire, suivant les directives européennes, et dont seules les universités sont habilitées à délivrer les titres de docteur (Goosse, 2018), comme si la part de recherche restait l’apanage de l’université. Cette subordination insupportable génère, non seulement, une inévitable compétition larvée et inutile entre enseignants universitaires et professeurs de cours théoriques des écoles d’art – qui se côtoient dans ces jurys composites –, mais également des réflexes corporatistes regrettables auxquels j’ai assisté plus d’une fois de la part de membres universitaires de ces jurys. Estimant que les étudiants en art inscrits dans cette école doctorale 20 en art et sciences de l’art n’ont pas « le niveau » des étudiants universitaires, l’attribution du grade de docteur leur est refusée. Certains membres se décident même à se retirer de ces jurys pour ne pas cautionner ce qu’ils considèrent comme une dérive, voire une dévalorisation des titres universitaires, craignant même, comme le déclarent certains, que ces titres « universitaires » permettent à ces artistes-chercheurs de briguer des postes universitaires. Outre le caractère, à mon sens, inapproprié de la forme de la thèse universitaire à laquelle ne sont pas formés les étudiants en art et qui ne correspond pas à leurs besoins en matière de formation et de recherche – faute d’avoir correctement identifié les caractéristiques propres à la recherche artistique par rapport à la recherche scientifique – et l’incrimination de sa direction bicéphale et rivale responsable des débordements et des mouvements d’humeur et d’incompréhension réciproque que je viens d’évoquer sommairement, la qualification même de ce doctorat en « Art et Sciences de l’art » ne laisse d’être équivoque et sa formulation actualisée renforce encore le caractère schizoïde de l’entreprise dont témoigne quasi systématiquement, dans toutes les soutenances de thèses en art et sciences de l’art auxquelles j’ai participé à l’Université libre de Bruxelles où j’enseigne, l’attitude des membres du jury qui, depuis l’accompagnement jusqu’à l’évaluation finale, se répartissent les compétences respectives et se mettent en retrait, s’estimant illégitimes ou incompétents. En effet, alors que la présentation officielle de l’École doctorale 20 stipulait sur le paradoxal mode cryptoholistique que « Le doctorat en Art et sciences de l’art se compose d’une partie pratique, une réalisation artistique […], et d’une partie théorique, une thèse écrite, les deux étant en étroite connexion, formant un tout, lequel est comme tel l’objet de l’évaluation finale, il ne s’agit même plus désormais de stimuler la recherche en art, mais d’“articuler” les arts et les sciences (désormais scotomisées ou déliées de leur objet artistique pour, imagine-t-on, favoriser des hybridations plus directement technologiques avec les sciences physiques et naturelles) de sorte que ledit doctorat “ne se confond, dès lors, ni avec la recherche en art, ni avec la recherche sur l’art” » (Goosse, 2018, p. 7). Comprenne qui pourra !
Certes, la recherche artistique, tout comme scientifique, est une pratique difficile à identifier, mais, comme le rappelle encore Bruno Gosse, il est primordial de l’identifier si l’on souhaite que les écoles d’art s’émancipent de cette tutelle ombrageuse de l’université et que les principes actifs de cette recherche en art soient actés et s’expriment à travers des financements et dans des cadres institutionnels reconnus. C’est ce qui a motivé la tenue d’un colloque organisé sur ce sujet et en constitue la conclusion (Académie des sciences et des arts de Belgique, 2013). Et c’est sans doute là que la sociologie de l’art peut apporter une contribution appréciable à ce débat :
Enfin, la sociologie de l’art, en abordant l’art et la science comme vocation, mais également comme expérience de vie indissociables de notre nature curieuse et spéculative (Dewey, 2005), permet de cerner plus finement cette articulation entre invention, innovation et création et de comprendre, de manière non normative, ce qui rapproche et ce qui distingue la recherche artistique de la recherche scientifique, sans recourir à des artifices sémantiques ou à des poncifs dogmatiques, même si, comme le fait remarquer à juste titre Tim Ingold : « La recherche n’est pas une opération technique […] C’est plutôt une manière de vivre avec curiosité – c’est-à-dire avec soin et attention » (Ingold, 2018, p. 90). La science, comme l’art, demeurent à cet égard avant tout une expérience de vie et une quête radicale de vérité et de liberté dont les conditions sont constamment à conquérir par le chercheur (artiste ou scientifique) voué (telle est sa vocation) à questionner les catégories de pensée et les représentations sociales qui font que l’on pense ordinairement ce que l’on pense, que l’on aime ce que l’on aime et que l’on croit ce qu’on croit (Bourdieu, 1980 ; Vander Gucht, 2011, 2016).
Quant à l’implémentation, pourtant bien nécessaire, d’un Fonds de la recherche artistique qui serait le pendant du Fonds de la recherche scientifique, bien développé et très actif et qui reconnaît les scientifiques comme des chercheurs qualifiés tout en finançant les projets de recherche scientifique, elle peine à voir le jour. Les résistances sont à chercher tant du côté des artistes, qui ont le sentiment d’une ingérence de l’université sur leur territoire, que des scientifiques qui ont encore bien du mal à concevoir que la création et la pratique artistiques engagent et constituent une véritable activité de recherche (Académie des sciences et des arts de Belgique, 2013). L’étape déterminante qui permettrait de concilier de manière organique la recherche et la création serait, sans doute, de considérer et de penser ensemble ces deux termes liés par la formation : ce qui caractérise et définit l’activité du chercheur, comme du créateur, est d’être en permanence en apprentissage, de ne jamais cesser de se former et de s’informer, de rester curieux et disponible aux possibilités que nous ouvrent la recherche et la création, dont c’est la raison d’être. La posture du chercheur en art, comme en science, qu’il soit par ailleurs enseignant-pédagogue, chef de travaux ou artiste professionnel, est fondamentalement cette dynamique et ce goût d’expérimenter, d’essayer au risque de rater, mais de « rater mieux » comme disait Samuel Beckett (Alandete et al., 2020), d’apprendre de tout et de tous, mais surtout de concevoir la recherche comme une « leçon de choses » permanente, mais aussi comme une forme de bricolage heuristique qui procède par essais et erreurs, où l’on apprend forcément plus de ces dernières et où la réussite consiste à découvrir quelque chose qu’on ne cherchait pas (« Je ne cherche pas, je trouve », disait Pablo Picasso en 1926, repris par Picasso, 1998). À propos de l’artiste belge Wim Delvoye, Jean-Pierre Criqui déclare que « l’art est un jeu qui se joue en changeant les règles » (Criqui, 2007). En quoi consiste précisément la liberté artistique qui ne prétend pas du tout à une posture en surplomb théorique ou en apesanteur sociale par rapport aux règles de l’art, mais correspond au contraire à une manière de faire jouer ces règles, de montrer qu’il y a du jeu en tant que flottement, latitude d’action, possibilité poiétique (poien signifiant faire) qui fait advenir ce qui n’existait pas (Platon, 2005b). Poiesis donc, mais aussi praxis qui transforme le sujet lui-même par l’expérience qu’il fait de l’art ou de la science. Tout cela pour dire que la recherche en art comme en science est un synonyme d’heuristique, pour autant que l’on cherche à définir de manière non prescriptive cette partie essentielle du travail artistique et du travail scientifique.
Le binôme recherche-création n’a, dès lors, de sens et de portée véritable que par la triangulation de la formation. Moins pour faire du scientifique ou de l’artiste un pédagogue (c’est qu’il est nécessairement, ne serait-ce que par défaut, puisqu’il ne peut être que médiateur de son œuvre et de sa pensée, elle-même médiée) qu’un apprenant permanent – comme tendent à se gausser les fins esprits qui leur reprochent avec condescendance de « n’avoir jamais quitté les bancs de l’école » ou de « chercher sans jamais trouver ». Il ne faut pas entendre cet apprentissage dans le sens productiviste du terme (se former à un métier ou à un poste ou suivre des « formations continuées », comme on dit en Belgique, ou complémentaires pour rester compétitifs et attractifs sur le marché de l’emploi), mais dans le sens des humanités classiques, c’est-à-dire la paideia des Grecs, de l’humanitas des Romains ou de la Bildung de Goethe. Soit, par un processus d’éducation permanente, cultiver notre civilité, civiliser nos mœurs (Elias, 1973), en d’autres mots nous rendre plus humains et aimables grâce à l’éducation et à la formation de l’esprit qui nous fait accéder à l’humanité par la fréquentation des œuvres de culture10. L’activité indissociablement créative, réflexive, critique et spéculative est bien la condition indispensable d’une citoyenneté culturelle responsable (Rancière 2000, 2008 ; Ruby, 2005, 2014 ; Zizek, 2011 ; Jey, 2013), bien loin de toutes les invocations rhétoriques à une quelconque participation culturelle souvent factice, ersatz de démocratie. Si l’art et la science sont des domaines dont la recherche est la raison d’être, c’est parce que ce sont là des activités formatives et transformatives (Saint-Luc, 2014). C’est du reste ce qu’exprime très exactement et très éloquemment Jean-Loup Rivière lorsqu’il précise qu’un artiste-chercheur (et c’est vrai aussi bien sûr du chercheur-créateur) n’est pas « un artiste qui cherche plus qu’un autre, ou qui se prend comme objet d’étude. Il ne s’agit pas non plus de produire une œuvre plus ou moins réflexive (théâtre dans le théâtre, jeu de citations autoréférentielles, etc.), la modernité en a souvent fait son miel. L’artiste-chercheur fabrique une œuvre qui rend visible son enseignement, au sens où Brecht voulait rendre visibles les sources de lumière. C’est une œuvre éclairée, son originalité est ouverte. Mais il faudrait […] trouver un terme qui suggère la dynamique et la puissance pédagogique de l’œuvre de l’artiste-chercheur. C’est ainsi que la recherche création n’a pour moi pas de sens hors la perspective de l’enseignement, enseignement de soi-même et des autres dans toutes les circonstances, tous les lieux dédiés, et sous des formes établies ou à imaginer. […] le critère de ce qui s’appelle recherche-création me semble donc être principalement le pédagogique, dans un sens le plus large possible. Un artiste qui soutient une thèse en recherche-création devient docteur, et l’on sait que ce mot signifie celui qui enseigne… » (Prévot, Rioual, 2018, p. 62).
Il convient de rappeler ici que ce que la création et la recherche ont en commun, comme l’art et la science, et dont la culture comme la mythologie ont pour fonction anthropologique d’entretenir, c’est de produire des représentations qui sont essentielles à notre ancrage et à notre orientation dans le monde et dans le temps. Toute société, comme tout individu, a besoin de représentations du monde, des autres et de soi pour tenter de donner un sens à son existence, se rattacher à une histoire et pouvoir s’imaginer un futur, un devenir. Différentes institutions remplissent cette fonction selon les cultures et les époques. Dans notre culture, la religion, l’art et la science ont historiquement, suivant des relations de subordination et de dépendance variables au fil de l’histoire, assuré cette mission consistant à dégager et à hiérarchiser les valeurs qui structurent notre organisation mentale à laquelle correspond notre organisation sociale. Avec la tragédie chez les Grecs, la perspective à la Renaissance, le roman au XIXe siècle, le cinéma au XXe siècle et les séries télé aujourd’hui, comme l’avait vu Georg W.F. Hegel, l’art est ce qui permet à une époque, à une société, de se regarder elle-même, de prendre la mesure de ses contradictions et de se donner une perspective d’avenir. Les formes symboliques sont « des voies d’accès au monde », comme le rappelle Habermas (cité par Rochlitz, 1995). Henri Geldzaler, ancien directeur du Metropolitan Museum de New York et complice de nombre d’artistes contemporains, considère, lui, que l’art nous sert en quelque sorte d’interface entre le monde et nous, comme le doudou sert aux enfants à savoir où s’arrête leur corps et où commence le monde extérieur (Geldzahler, 1990). L’art, dans l’expérience que nous en faisons, est ainsi notre manière de nous connecter au monde et cette expérience sensible mêle inextricablement de l’affect (cela touche, émeut, c’est une dimension essentielle de l’art qui doit en effet nous ébranler physiquement, même si c’est aussi, sans doute, la part la plus rentable pour les industries culturelles qui font de l’émotion le maître mot de leur communication), du percept (cela dévoile et fait voir, selon la fameuse formule de Paul Klee : « l’art rend visible » (Klee, 2018, p.34) et du concept (cela nous aide à comprendre les rapports entre les choses et les êtres, car ces relations prennent des formes repérables) (Daniel Vander Gucht, 2014).
1 Pour une analyse de ce passage d’un « paradigme absolutiste » à un « paradigme relationnel » dans les années 1960 et dans le sillage du structuralisme, voir Vander Gucht, 2014.
2 Il n’est pas surprenant que deux des plus importants sociologues de l’art se soient intéressés à lui. Howard Becker, qui avoue volontiers avoir été initié à l’art contemporain par le travail de Hans Haacke, lui consacra un essai co-signé avec John Walton (Becker, 2011), une première tentative d’évaluation de la valeur de la démarche de Haacke non plus en tant qu’artiste plasticien, mais du point de vue proprement sociologique. Pierre Bourdieu, quant à lui, eut un long entretien avec lui qui sera publié en 1993 (Bourdieu et Haacke, 1993).
3 Mouvement artistique créé à Wiesbaden en 1962 à l’occasion de concerts-performances et qui réunira des artistes comme John Cage, George Brecht, Allan Kaprow, Robert Filliou, Ben Vautier, Daniel Spoerri ou Nam June Paik pour ne citer qu’eux.
4 PTT : Postes, télégraphes et téléphones.
5 De nombreuses personnalités atypiques dans le monde académique contribuèrent à cette hybridation interdisciplinaire, dont Abraham Moles, scientifique spécialisé en électro-acoustique qui soutint, dès 1954, une seconde thèse de doctorat d’État à la Sorbonne intitulée La Création scientifique sous la direction de Gaston Bachelard et créa, en 1966, l’Institut de psychologie sociale des communications à l’université de Strasbourg. Président de la Société française de cybernétique, son ouvrage Art et ordinateur (1971) transpose en esthétique les théories de Shannon et s’inspire des pratiques de l’Oulipo dont il est l’invité d’honneur en 1970. Il est également à l’initiative de la création de l’Académie nationale des Arts de la Rue (ANAR) en 1975. On peut encore évoquer la pensée d’intellectuels fort influents dans l’intelligentsia artistique de l’époque comme Vilém Flusser, (Flusser, 1973), Gilles Deleuze et Félix Guattari avec leurs rhizomes et leur schizoanalyse qui opposent leur ontologie révolutionnaire des devenirs à l’histoire des identités assignées (Deleuze et Guattari, 1980), ou le philosophe des sciences Paul Feyerabend et son épistémologie anarchiste (Feyerabend, 1979, 2003), mais aussi la notion de « pensée sauvage » (Lévi-Strauss, 1962) et plus près de nous encore la théorie de « l’acteur réseau » ou de la « sociologie de la traduction » (Akrich, Callon et Latour, 2006), entre autres écrits inspirant les artistes actuels, tout comme l’« écologie des pratiques » (Stengers, 2006) et « la connaissance située » (Haraway, 2009).
6 La sociologie des formes sociales de Georg Simmel, qualifiée de « formale » ou de « formelle » est une sociologie de l’interaction sociale et de l’expérience de vie au sens de Wilhelm Dilthey, Simmel ayant du reste consacré des essais très éclairants sur le style artistique et la création artistique (Georg Simmel, 1986).
7 Voir Wittkower, 1985 ; Kris et Kurz, 1987.
8 Voir de Maison Rouge, 2003 ; Vander Gucht, de Mello, 2016.
9 Pour autant, ce clivage entre formation artistique et formation universitaire subsiste sur l’ensemble de l’aire linguistique francophone. J’en veux pour preuve l’annonce du programme doctoral SACRe de l’université PSL qui ambitionne d’« explorer les territoires communs de la recherche et de la création, permettre à des créateurs et à des chercheurs de travailler et d’inventer ensemble » (https://collegedoctoral.psl.eu/doctorat-psl/programme-doctoral-sacre/), faire cohabiter et collaborer « des créateurs et à des chercheurs » pour « une étroite articulation de la pensée et du sensible », mais ne pas les confondre : aux uns la création et la sensibilité, aux autres la recherche et la pensée. Voilà comment les vieux réflexes ont la peau dure.
10 « La paideia, précise Henri-Irénée Marrou, ne visait pas l’enfant en tant que tel, mais l’homme développé, achevé, en qui il devait s’accomplir, et en ce sens, cette éducation se prolongeait toute la vie à la recherche de la perfection. Aussi bien, Cicéron traduisant paideia n’a-t-il pas trouvé de meilleur mot qu’humanitas » (Marrou, 1948).
Académie des sciences et des arts de Belgique (2013), Einstein, Duchamp et après ? La recherche dans l’enseignement supérieur artistique, actes du colloque organisé à l’initiative du Conseil supérieur de l’Enseignement supérieur artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2012 à l’Académie des sciences et des arts de Belgique, Bruxelles, CSESA.
AKRICH Madeleine, CALLON Michel, Latour Bruno (dir.) (2006), Sociologie de la traduction : textes fondateurs, Paris, Mines ParisTech/les Presses, coll. « Sciences sociales ».
ALANDETE Christian, DANIEL Hugo, Karmitz Marin, Marin Maguy, Tubridy Derval (2020), Giacometti/Beckett. Rater encore. Rater mieux, Lyon/Paris, Éditions Fage/Fondation Giacometti.
ARDENNE Paul (2000a), L’Art dans son moment politique, Bruxelles, La Lettre volée.
ARDENNE Paul (2000b), Micropolitiques, Grenoble, Le Magasin.
ARDENNE Paul (2002), Un art contextuel, Paris, Flammarion.
BAQUÉ Dominique (2004), Pour un nouvel art politique. De l’art contemporain au documentaire, Paris, Flammarion.
BARTHES Roland (1963), Sur Racine, Paris, Le Seuil, p. 11.
BAUDRILLARD Jean (1972), Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard.
BAUDRILLARD Jean (1978), À l’ombre des majorités silencieuses. La fin du social, Paris, Denoël.
BARRÈRE Anne, Martuccelli Danilo (2009), Le Roman comme laboratoire. De la connaissance littéraire à l’imagination sociologique, Paris, Le Septentrion.
BAYAR Devrim (2005), Komar et Melamid. Un art de la médiation, Bruxelles, La Lettre volée.
BECKER Howard S. (1986), Écrire les sciences sociales, Paris, Economica.
BECKER Howard S. (1991), Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion.
BECKER Howard S. (2011), L’Imagination sociologique de Hans Haacke, Bruxelles, La Lettre volée.
BECKER Howard S. (2009), Comment parler de la société. Artistes, écrivains et représentations sociales, Paris, La Découverte.
BERNARD Régis (1998), « La sociologie comme récit », in Laplantine François, Lévy Joseph, Martin Jean-Baptiste, Nouss Alexis (dir.), Récit et connaissance, Lyon, Presses universitaires de Lyon, p. 255-265.
BEUYS Joseph (1988), Social Sculpture, Invisible Sculpture, Alternative Society, Free International University. Conversation with Eddy Devolder, Gerpinnes, Tandem.
BORGDORFF Henk (2012), The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia, Amsterdam, Leiden University Press.
BOURDIEU Pierre (1980), « Comment libérer les intellectuels libres ? », in Bourdieu Pierre, Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit.
BOURDIEU Pierre, HAACKE Hans (1993), Libre-échange, Paris, Le Seuil/Les Presses du réel.
BOURRIAUD Nicolas (1998), Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel.
BOUVERESSE Jacques (2008), La Connaissance de l’écrivain : sur la littérature, la vérité et la vie, Marseille, Agone.
BROCH Hermann (1985), Création littéraire et connaissance, Paris, Gallimard.
BUREN Daniel, HEINICH Nathalie (2014), « La culture à l’épreuve de l’art contemporain », Débat à l’Université libre de Bruxelles, le 18 septembre.
CAILLET Aline (2014), Dispositifs critiques : le documentaire, du cinéma aux arts visuels, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
CAILLET Aline (2019), L’art de l’enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales, Paris, Mimésis.
CLIFFORD James (2003), « De l’autorité en ethnographie. Le récit anthropologique comme texte littéraire », in Céfaï Daniel (dir.), L’Enquête de terrain, Paris, La Découverte/Mauss.
DE MAISON ROUGE Isabelle (2003), L’Art contemporain, Paris, Le Cavalier bleu.
CRIQUI Jean-Pierre (2007), Portraits de plasticiens : Wim Delvoye, Arte vidéo.
DEBORD Guy (1967), La Société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel.
DELACOURT Sandra (2014), « Passe d’abord ton doctorat ! De l’alignement de la recherche artistique sur le modèle universitaire », L’Art même, 62, p. 5, [en ligne] http://www.lartmeme.cfwb.be/no062/documents/AM62.pdf
DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix (1980), Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit.
DEWEY John (2005), L’Art comme expérience, Paris, Gallimard.
DUBOIS Jacques (2000), Les Romanciers du réel, Paris, Le Seuil.
DUVIGNAUD Jean (1993), Perec ou la cicatrice, Arles, Actes Sud.
ELIAS Norbert (1973), La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy.
FEYERABEND Paul (1979), Contre la méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, Le Seuil.
FEYERABEND Paul (2003), La science en tant qu’art, Paris, Albin Michel.
FILLIOU Robert (2003), L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art, Dijon, Les Presses du réel.
FISCHER Hervé (1977), Théorie de l’art sociologique, Tournai, Casterman.
FLUSSER Vilém (1973), La Force du quotidien, Paris, Mame, 1973.
FOREST Fred (1977), Art sociologique. Vidéo, Paris, UGE, coll. « 10/18 », p. 46.
FOSTER Hal (2005), « L’artiste comme ethnographe » in Foster Hal, Le Retour du réel. Situation actuelle de l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005.
FOURMENTRAUX Jean-Paul (2011), Artistes de laboratoire. Recherche et création à l’ère numérique, Paris, Hermann.
GEERTZ Clifford (1996), Ici et là-bas, l’anthropologue comme auteur, Paris, Métailié.
GELDZAHLER Henry (1990), Interview dans le film de Marie Meijer, Art Ache, Stockholm, Meijer films.
GIRARD René (1983), Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Hachette.
GOOSSE Bruno (2018), Préambule à la revue A/R, 1, p. 6-9.
GOSSELIN Pierre, Le Coguiec Éric (dir.) (2006), La Recherche-création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Québec, Presses de l’Université du Québec.
HARAWAY Dona (2009), Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, Nîmes, Jacqueline Chambon.
HARAWAY Donna (avec Vinciane Despret et Isabelle Stengers) (2020), Vivre avec le trouble, Paris, Les Éditions des mondes à faire.
HEINICH Nathalie (1993), Du peintre à l’artiste, artisans et académiciens à l’âge classique, Paris, Éditions de Minuit.
HENNION Antoine, LATOUR Bruno (1993), « Objet d’art, objet de science. Note sur les limites de l’anti-fétichisme », Sociologie de l’art, 4, p. 7-24.
INGOLD Tim (2018), « L’art, la science et le sens de la recherche », A/R, 1, p. 90.
JDEY Adnen (dir.) (2013), Politiques de l’image. Questions pour Jacques Rancière, Bruxelles, La Lettre volée.
KAPROW Allan (1996), « L’expérience réelle (Artforum, décembre 1983) », in Kaprow Allan, L’Art et la Vie confondus, Paris, Centre Georges Pompidou.
KLEE Paul (2018), Théorie de l’art moderne, Paris, Gallimard, coll. Folio.
KRIS Ernst, Kurz Otto (1987), L’Image de l’artiste. Légende, mythe et magie, Paris, Rivages.
LEENHARDT Jacques (2014), Lire Les Choses de Perec, Bruxelles, La Lettre volée.
LÉVI-STRAUSS Claude (1962), La Pensée sauvage, Paris, Plon.
LOSCO-LENA Mireille (dir.) (2017), Faire théâtre sous le signe de la recherche, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
LOURAU René (1974), L’Analyseur Lip, Paris, Union générale d’éditions, coll. « 10/18 ».
MARROU Henri-Irénée (1948), Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris, Le Seuil.
NELSON Robin (2013), Practise as Research in the Arts. Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan.
PEREC Georges (1965), Les Choses, Paris, Julliard.
PICASSO Pablo (1998), Propos sur l’art, Paris, Gallimard.
PRÉVOT Géraldine, RIOUAL Quentin, « 9 x 9 questions sur la recherche-création », p. 35, [en ligne] https://www.thaetre.com/2018/06/16/recherche-creation/10/
RANCIÈRE Jacques (2000), Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique.
RANCIÈRE Jacques (2008), Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique.
ROCHLITZ Rainer (1995), « De l’expression au sens : perspectives esthétiques chez Habermas », Revue internationale de philosophie, vol.49, n°194.
RORTY Richard (dir.) (1967), The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, Chicago, The University of Chicago Press.
RUBY Christian (2005), Nouvelles Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Bruxelles, La Lettre volée.
RUBY Christian (2014), Spectateur et politique. D’une conception crépusculaire à une conception affirmative de la culture ?, Bruxelles, La Lettre volée.
SAINT-LUC Florence (2014), « La recherche-action : une recherche à visée formatrice et transformatrice », [en ligne] https://saintlucflorence.wordpress.com/la-recherche-action/
SENNETT Richard (2010), Ce que sait la main : La culture de l’artisanat, Paris, Albin Michel.
SIMMEL Georg (1986), La Sociologie et l’Expérience du monde moderne, Paris, Méridiens Klincksieck.
STENGERS Isabelle (2006), La Vierge et le neutrino, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/Le Seuil.
THOMPSON Nato (dir.) (2012), Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011, New York/Cambridge (MA)/Londres, Creative Time Books/MIT Press, p. 17.
VANDER GUCHT Daniel (2011), « Comment libérer les artistes libres ? », in Ducret André (dir.), À quoi servent les artistes ?, Zurich, Seismo.
VANDER GUCHT Daniel (2014), L’Expérience politique de l’art. Retour sur la définition de l’art engagé, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
VANDER GUCHT Daniel (2016), « Les artistes en liberté conditionnelle et la parole publique du sociologue », in Gaudez Florent (dir.), L’Art, le Politique et la Création, vol. 2 : La création artistique subversive. Actes du colloque de l’Université Pierre-Mendès-France/Grenoble 2, Paris, L’Harmattan, 2016.
VANDER GUCHT Daniel (2015), L’art est-il un luxe ou une nécessité ? [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=fqYBfk-goEQ
VANDER GUCHT Daniel (2017), Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
VIALA Alain (1985), Naissance de l’écrivain, Paris, Éditions de Minuit.
WITTKOWER Rudolph, WITTKOWER Margot (1985), Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l’Antiquité à la Révolution française, Paris, Macula.
WRIGHT MILLS Charles (1959), L’Imagination sociologique, Paris, Maspero.
WYPIJEWSKI JoAnn (dir.) (1997), Painting by Numbers: Komar and Melamid’s Scientific Guide to Art, New York, Farrar Straus Giroux.
ZIZEK Slavoj (2011), Vivre la fin des temps, Paris, Flammarion.
Daniel Vander Gucht, « De la recherche-action à la recherche-création. Ne pas opposer ni confondre mais conjuguer », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 7 | 2023, mis en ligne le 21 juillet 2023, consulté le . URL : https://rfmv.fr