

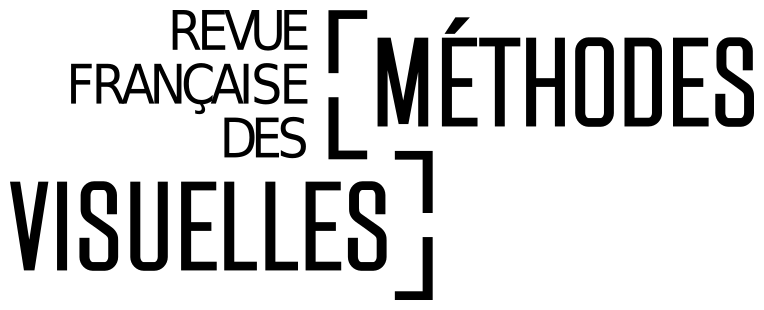
Olivier Chadoin, professeur de sociologie, ENSAP Bordeaux, PAVE, Centre Émile Durkheim, UMR 5116, CNRS
Le secteur de la santé a subi de profondes évolutions tout au long du XXe siècle, et, en conséquence, la pratique médicale. Le « modèle médical » et le « pouvoir médical » sont omniprésents dans nos sociétés contemporaines et l’on peut donc bien parler de « médicalisation de la société » au sens où de nombreux problèmes sociaux sont même aujourd’hui passés au registre médical. Ainsi, à la société provinciale du XIXe siècle correspondent une pratique médicale, une relation à la médecine particulière et un type de reconnaissance sociale singulier. À la société urbaine et technologique d’aujourd’hui en correspond une autre, dans laquelle la technologie et l’imagerie occupent une place prépondérante. Pour aborder ces questions et sur la base d’une analyse d’ouvrages monographiques, cet article dégage deux modèles type de pratique médicale à deux époques différentes. L’ambition est de voir ce qui, objectivement, est aujourd’hui différent dans la pratique médicale, depuis les aspects les plus significatifs tels que le colloque singulier jusqu’aux aspects les plus « micro » telle l’évolution du contenu de la trousse médicale. Il s’agit d’essayer d’appréhender l’évolution des traits de la pratique médicale actuelle tels que la rationalisation du travail médical, le développement de la technique et plus particulièrement les usages de l’imagerie médicale. Enfin, cet essai de compréhension des évolutions de la pratique médicale et des relations malade-médecin conduira à esquisser un programme de recherche sur la place et les usages de l’image (imagerie médicale) dans cette pratique.
Mots-clés : Médecine, Image, Imagerie, Technologie, Corps, Usages sociaux
The health sector has undergone profound changes throughout the twentieth century and, as a result, medical practice. The 'medical model' and 'medical power' are omnipresent in our contemporary societies, and we can therefore speak of the 'medicalisation of society' in the sense that many social problems have even today become medical. Thus, the provincial society of the 19th century has its own medical practice, its own relationship to medicine and its own type of social recognition. Today's urban and technological society is matched by another, in which technology and imagery occupy a predominant place. In order to address these issues and on the basis of an analysis of monographic works, this article identifies two typical models of medical practice in two different periods. The ambition is to see what, objectively, is different today in medical practice, from the most significant aspects such as the colloque singulier to the most « micro » aspects such as the evolution of the contents of the medical kit. It is an attempt to understand the evolution of the features of current medical practice such as the rationalisation of medical work, the development of technology and more particularly the uses of medical imaging. Finally, this attempt to understand the evolution of medical practice and the relationship between patient and doctor will lead to the outline of a research programme on the place and uses of images (medical imaging) in this practice.
Keywords : Medicine, Image, Imaging, Technology, Body, Social uses
L’expérience clinique représente un moment d’équilibre entre la parole et le spectacle, équilibre précaire car il repose sur un formidable postulat : que tout le visible est énonçable et qu’il est tout entier visible, parce que tout entier énonçable.
(Michel Foucault, 1963)
Politique de santé, système de protection sociale, accès différenciés aux soins, division du travail, tendance à la spécialisation, télémédecine... Le secteur de la santé a subi de profondes évolutions tout au long du XXe et du XXIe siècles1. La santé et, par voie de conséquence, la pratique médicale, sont aujourd’hui des enjeux primordiaux autant du point de vue des agents et patients eux-mêmes que du point de vue des gouvernants. Il n’est pas aujourd’hui de préoccupation plus prégnante que celle de son « capital corporel » et il suffit pour s’en convaincre de s’arrêter un instant devant les étals de quelconque kiosque à journaux. Les préoccupations sanitaires, qui, à l’origine, ressortissaient de la compétence de l’État ou de l’Église, semblent désormais avoir pénétré tout le corps social. Elles ont en effet bénéficié d’un grand intérêt au moment de l’industrialisation. C’est au moment où émerge le développement industriel que les hygiénistes vont voir leurs objectifs converger avec ceux du pouvoir, la santé devenant de plus en plus nécessaire au bon fonctionnement des sociétés en voie d’industrialisation. Puis, avec la naissance de la sécurité sociale, il semble, pour le dire vite, que dès les années 1950, on s’achemine vers ce que certains observateurs nommeront une « société médicalisée » (Conrad et Schneider, 1994). On voit alors se dessiner une double évolution : celle de la médecine et celle de la société.
Le nombre de médecins qui était de 15 000 à la fin du siècle dernier et de 25 000 en 1930, passe à 80 000 en 1975 puis à 216 000 aujourd’hui. Par ailleurs, c’est la conformation même de l’exercice de la médecine qui change de nature avec le développement de l’imagerie médicale, des spécialistes et des spécialités (en France, plus de la moitié des médecins sont des spécialistes ; Actes de la recherche en sciences sociales, 2005). Cette évolution de l’offre de soins s’accompagne également d’une augmentation du volume des dépenses de santé, qui constitue aujourd’hui la principale source d’activité des pays développés. Quant à l’hôpital, qui fut pendant longtemps l’asile des plus démunis, il est devenu l’installation type de toutes les sociétés modernes. Le « modèle médical » est donc omniprésent dans nos sociétés contemporaines et l’on peut donc bien parler de « médicalisation de la société » au sens où de nombreux problèmes sociaux comme l’alimentation, l’alcoolisme ou la drogue sont aujourd’hui passés au registre médical ; il est même aujourd’hui imposé au médecin de renseigner la société sur la capacité de travail d’un individu.
On pourrait d’ailleurs ici multiplier la liste de ces évolutions qui attestent tout autant les unes que les autres de la croissance du « pouvoir médical ». À travers ces mouvements brièvement esquissés, ce qui s’impose, c’est le fait qu’ils soient souvent cités pour arriver au constat selon lequel ils forment aujourd’hui des difficultés qui remettent en cause l’exercice de la médecine et sa légitimité. Parmi ces inquiétudes, au premier rang, se trouve la croissance des dépenses de santé (en France, plus importante que la richesse nationale), ensuite viennent celles sur l’efficacité de notre système médical face à certaines maladies actuelles. Mais le contexte présent pose également la question, plus pragmatique, de l’exercice du praticien individuel et de la place du patient, confrontés, l’un comme l’autre, à un système de santé complexifié par les nombreuses spécialités et le nombre, toujours croissant, de médecins.
Pour aborder ces questions, nous proposons de restituer, sur la base de deux ouvrages monographiques2, deux modèles type de pratique médicale à deux époques différentes. L’ambition étant de voir ce qui, objectivement, est aujourd’hui différent dans la pratique médicale, nous passerons alors en revue les aspects les plus significatifs tels que le colloque singulier comme les aspects les plus « micro » telle l’évolution du contenu de la trousse médicale. Il s’agit donc ici, à rebours des pratiques scientifiques « normales » et normées, d’être minimal et problématique : une économie des sources et un temps raccourci. Une approche certes ouverte à la critique mais que nous souhaitons capable d’ouvrir de nouveaux chantiers de recherche.
La comparaison des deux pratiques médicales vise à comprendre, non seulement, ce qui aujourd’hui est différent dans l’exercice du praticien mais également de tenter de caractériser le sens des changements survenus dans la relation « malade-médecin ». Il s’agit d’essayer d’appréhender le pourquoi de certains traits de la pratique médicale actuelle tels que la rationalisation du travail médical, le développement de la technique et de l’hôpital et les usages de l’imagerie médicale. Enfin, surtout, on va le voir cet essai de compréhension des évolutions de la pratique médicale et des relations malade-médecin conduira à esquisser un programme de recherche sur la place et les usages de l’image (imagerie médicale) dans cette pratique. En d’autres mots : à la société provinciale du XIXe siècle correspond une pratique médicale, une relation à la médecine particulière, un type de reconnaissance sociale singulier, et à la société urbaine et technologique d’aujourd’hui en correspond une autre dans laquelle la technologie et l’imagerie occupent une place prépondérante.
La médecine est d’abord un savoir sur le corps : son objet quotidien, sa pratique, c’est celle du corps. Elle en rend compte par des théories, le soigne avec des techniques, et surtout, tend à en imposer une vision à travers des concepts qui lui sont propres. Le corps est ainsi placé au cœur même de la relation entre le soignant et le soigné : le médecin est un spécialiste du corps et le patient qui consulte le fait non seulement pour entretenir son corps mais aussi parce qu’il ne dispose pas de la connaissance sur le corps nécessaire pour le faire seul. En réalité, nous ne possédons pas la compétence permettant le déchiffrement de notre mécanique intime. À mesure que le savoir et les techniques médicales progressent, ce qui est de l’ordre de notre propre corps nous échappe le plus souvent et apparaît comme domaine réservé du registre savant. Dès lors, on pourrait presque définir le médecin comme celui qui prétend au monopole de la définition du corps.
Mais, outre cela, le corps c’est également le lieu de l’être et du paraître où se lisent les marques du social (le temps, le travail...). Pierre Bourdieu, par exemple, montre très bien comment le rapport au corps est un indicateur pertinent pour l’analyste lorsqu’il nous dit « tous les principes de choix sont incorporés, devenus postures, dispositions du corps : les valeurs sont des gestes, des manières » (Bourdieu, 1984, p. 133). Ainsi, le corps c’est non seulement du « social incorporé » mais le rapport des individus à leur corps est une des dimensions par lesquelles se donne à voir leur situation dans l’espace social.
Dès lors, le corps apparaît comme un objet double : l’objet d’une perception renvoyant à un ordre de significations culturelles plus vastes qui forment le regard, et d’autre part l’objet de la science médicale qui le perçoit et le décrit selon les catégories qui sont les siennes – (néanmoins pas complètement détachées des significations culturelles qui forment notre manière d’appréhender le réel. Comment lit-on le corps ? C’est cette interrogation qui, nous semble-t-il, est pertinente pour penser les changements survenus dans la relation médicale. Aussi, le corps s’impose comme un indicateur significatif du changement en tant que, comme le dit Claudine Herzlich (1984), « reflet et miroir qui se donne à voir tout en donnant à voir ».
Il est au centre de la relation soignant-soigné, laquelle est sans doute le point d’orgue de tout travail sur la profession médicale : pour le médecin, comme pour le patient, elle constitue un moment crucial qui aux yeux de l’observateur social se donne à voir comme instant privilégié durant lequel la rencontre entre le malade et l’expert permet de décoder les rapports qu’entretiennent les différents groupes qui composent la structure sociale à un moment donné. En d’autres mots, il ne s’agit pas seulement d’un rapport interpersonnel mais aussi d’un véritable rapport social tant il met en jeu des rapports structurels inscrits dans la société globale. La relation entre le patient et le thérapeute, par le fait qu’elle met en jeu des valeurs sociales centrales, le rapport au corps par exemple, est donc de tout premier intérêt pour qui veut comprendre l’état de sa société.
De fait, la pratique médicale n’est pas isolée, mais bien au contraire, elle est largement soumise aux contingences que lui impose l’état du monde social. La définition et la forme que revêt la rencontre entre un médecin et son patient n’est donc pas entièrement donnée par les critères du savoir médical et du progrès scientifique mais elle est aussi largement soumise aux transformations sociales globales. Par conséquent, les relations malade-médecin qui en découlent dépendent elles-mêmes de l’état du système social mais aussi des outils technologiques comme l’imagerie médicale, qui orientent les modalités de la rencontre entre le médecin et son patient.
Les reproches généralement adressés à la médecine contemporaine sont bien connus puisque sans cesse repris par les faiseurs d’opinion : notre médecine serait « scientiste », « impersonnelle », « mécanique », et « hâtive » ; elle serait « déshumanisée » et ne fonctionnerait plus que comme une machine aveugle dont le moteur est la rationalité.
Est-ce-à-dire que la médecine de nos aînés fut plus attentive à nos maux que celle d’aujourd’hui ? Ne nous y trompons pas, les médecins du siècle dernier commirent beaucoup plus d’erreurs que nos contemporains3. Il suffit, pour s’en convaincre, de revenir un instant sur les descriptions de la littérature du siècle précédent. Chacun a ici à l’esprit Flaubert peignant l’opération du pied-bot du garçon d’écurie par Charles Bovary qui ne parvient pas à empêcher la gangrène, ni à éviter l’amputation nécessaire de la jambe. Cet exemple de l’officier tourmenté par son incompétence, qui jamais n’aurait concédé entreprendre cette opération s’il n’y avait été poussé par le pharmacien, illustre parfaitement la position des médecins du siècle dernier : ils sont les premiers à déplorer le manque d’objectivité de leur pratique et ils préféreraient mieux maîtriser les connaissances de l’organisme plutôt que de jouer aux « confesseurs des impressions subjectives ».
Si l’on compare la pratique médicale des praticiens du XIXe siècle à celle de ceux d’aujourd’hui, ce qui étonne le plus c’est non seulement ses tâtonnements et ses incertitudes mais c’est aussi le fait que la médecine est largement divisée4 sur les moyens de soigner et, faute de pouvoir réaliser des diagnostics parfaits, contrainte de s’appuyer sur des impressions, voire des intuitions.
Si l’on considère, par exemple, le cas du médecin de campagne, figure emblématique du siècle précédent, on aperçoit avec netteté comment celui-ci, contraint à un certain isolement, mais devant toutefois prendre de graves décisions, doit tout comprendre et tout savoir-faire. En fait, à cette époque où l’imagerie médicale est absente, le diagnostic repose en grande partie sur les facultés perceptives de l’homme de l’art et ses usages de la statistique médicale naissante. Il se renseigne alors sur tout, sa démarche est complètement empirique. Son diagnostic s’appuie sur tout et sur tous ; parmi les matériaux qui sont utiles et possibles : famille et voisins du patient, commerçants, histoire du patient, situation, apparence physique... Et, comme bien souvent le médecin ne peut rendre compte complètement de la situation du patient, son diagnostic s’appuie en grande partie sur un interrogatoire de ce dernier et de son entourage. Il devra, comme le relate par exemple Jacques Léonard, s’informer, sur la route, des conditions de vie de son patient, de ses moyens financiers ; si ce dernier ne dispose que de peu, ou pas du tout, de rentes, il aura à ajuster le montant de ses honoraires. Au besoin, dans certaines circonstances (si le patient et sa famille ne savent pas lire), il devra même prononcer son ordonnance à haute voix. Parfois, il aura même à composer avec les croyances vernaculaires et à tolérer certaines pratiques telles que les montagnes d’édredons destinées à provoquer d’abondantes sudations. Quant à ses prédictions curatives, elles devront faire avec les prédilections et les répugnances du patient : « le paysan admet les emplâtres, les baumes et les onguents, mais il déteste les lavements, les vomissements et les sangsues » (Léonard, 1977, p. 70).
Mais ce qui frappe encore plus, c’est la manière dont le médecin procède à son auscultation. En ces temps, où n’existent ni l’imagerie médicale ni les techniques d’exploration modernes et où les examens chimiques en sont à leurs balbutiements, le diagnostic est largement empirique et totalement déductif. À l’inverse de la pratique médicale moderne dans laquelle la relation malade-médecin est de plus en plus souvent médiatisée par la technique, le médecin du XIXe siècle a affaire directement avec le corps du patient. L’observation externe doit renseigner sur les maladies internes et le médecin est donc essentiellement un observateur : son diagnostic s’établit par la vue, le toucher, et l’écoute du patient. L’exploration manuelle joue en effet, dans sa pratique, un rôle de premier ordre et les « palpations, pétrissages et autres pressions variées », tout comme l’aspect de la peau du malade, apportent des informations essentielles à son diagnostic. La langue, les paupières, les veines, les ongles, de même que les humeurs (excréments, vomissures, crachat, sang hémorragique...) sont des indicateurs à ne pas négliger. François Lebrun (1995) rapporte, par exemple, que les médecins ont pris pour habitude, depuis qu’on a signalé la saveur sucrée de l’urine des diabétiques, de porter à leurs lèvres un doigt trempé dans l’urine du patient afin d’en étudier le goût, insipide ou non. On trouve d’ailleurs présent chez les médecins un très riche vocabulaire pour désigner l’odeur des matières, la consistance, la couleur... Le sang recueilli après la saignée, par exemple, est censé fournir de précieux renseignements sur l’état du patient.
Le médecin est donc, dans sa pratique, directement confronté au corps, il regarde, il renifle, il flaire et discerne. C’est d’ailleurs ici un des aspects les plus étonnants du changement introduit par l’arrivée de l’imagerie médicale et des techniques dites d’introspection : alors que le praticien du XIXe siècle a pour seuls indicateurs le malade, ses dires, sa situation (les visites sont très souvent faites à domicile), son corps, pour le médecin d’aujourd’hui il en est tout autrement. À présent, le corps semble se présenter plutôt comme un obstacle et les diagnostics se font de plus en plus souvent sur la base des techniques dites « intrusives ». Ce n’est plus alors le corps lui-même pris dans son environnement qui est signifiant pour l’expert mais son fonctionnement organique, interne, c’est-à-dire la mécanique intime et abstraite (pour le patient) qui fait se mouvoir le corps. Tout semble donc se dérouler comme si les signes externes (milieu de vie, humeurs du corps...) qui constituaient des indicateurs pour le médecin d’hier n’était, pour le praticien moderne, plus que des conséquences dont la véritable racine est à rechercher dans la boîte noire.
Ainsi, ce qui semble le mieux caractériser la relation médicale au XIXe siècle c’est son empirisme et sa capacité d’adaptation aux situations. Nous sommes ici en effet dans une société encore très peu rationalisée, n’ayant pas encore une croyance très forte en la science et, subséquemment, le médecin doit ajuster sa compétence aux situations. Il est loin de négliger les passions, les peurs et les vertiges, « il négocie la confidence qui peut éclairer et l’obéissance qui peut sauver » comme l’exprime très justement Jacques Léonard.
Au reste, il est intéressant de noter le fait que le médecin du XIXe siècle, à l’inverse de ses confrères du XXe siècle, est très peu équipé techniquement. Sa trousse médicale se résume en effet à bien peu de choses.
L’un des principaux changements de la relation malade-médecin est le fait qu’elle ne se déroule désormais que très rarement à domicile (comparé au siècle dernier) et que sa situation archétypale tend à devenir la structure hospitalière et son « armement technologique ».
Ainsi, si le médecin est avant tout quelqu’un qui palpe, qui examine, qui force l’intimité, qui se permet, et à qui l’on permet, parce qu’il est « compétent », des actes interdits à quiconque, le trait principal de cette pratique, et les problèmes qu’elle pose, sont ceux du rapport au corps. En effet, ce qui d’emblée permet de distinguer la relation soignant-soigné d’hier de celle d’aujourd’hui c’est bien, semble-t-il, le rapport entretenu par l’expert à l’égard du corps. Si ce qui forme l’essentiel de la pratique médicale du XIXe siècle, est une très grande attention portée à l’enveloppe charnelle du client, à son histoire, et aux émissions corporelles diverses, qui constituaient alors le quotidien du médecin, aujourd’hui il en est tout autrement. Il semble même qu’il y ait un certain déni du corps de la part des praticiens modernes. Quant aux humeurs, tout semble se passer comme si, en tant qu’aspect dégradant de la profession, elles étaient devenues taboues, comme si l’émergence de l’asepsie avait soudain « aseptisé » la relation médicale, rendant ainsi le corps plus distant ; les médecins ont d’ailleurs de moins en moins l’occasion d’y avoir affaire. Ainsi, ce qui semble se révéler dans cet état de fait c’est une distance prise par rapport au corps de plus en plus grande dans la forme de l’acte médical. Comme l’exprime Norbert Bensaïd, (Hamon, 1994), « le corps ça existe mais les médecins n’aiment pas penser qu’il est habité, sinon ça érotise et les angoisses surgissent, au fond le désir secret du médecin c’est de voir le corps comme un cadavre encore vivant5 ». Il y aurait donc, latent, comme un désir de déni du corps dans la médecine moderne. Est-ce à dire que nos médecins ne nous voient plus que comme des unités fonctionnelles, des machines à réparer ? Seraient-ils devenus des techniciens ? Il y a une série d’interrogations, suscitées par le constat précédent, qui demandent à être éclairées par un retour sur les conditions même de la pratique médicale moderne. En effet, ce qui différencie fondamentalement la relation « soignant-soigné » d’hier de celle contemporaine c’est, d’une part le fait qu’au siècle dernier la foi en la médecine était beaucoup moins forte qu’aujourd’hui (le médecin devait composer avec les croyances du cru), et d’autre part que cette relation n’était pas médiatisée, ou du moins très peu, par la technique (le thermomètre anal par exemple qui a fait scandale lors de son apparition et a mis très longtemps à s’imposer).
C’est là, semble-t-il, un des aspects les plus marquants du changement : on passe d’une médecine d’observation externe et manuelle à une médecine que l’on pourrait qualifier « d’introspection technologique » dans laquelle l’imagerie est omniprésente. L’illustration qu’en donne la chirurgie, à cet égard, est fort éloquente en ce sens que c’est là que les discordances entre techniques modernes et techniques anciennes sont les plus manifestes. Si l’on compare tout d’abord le contenu de la trousse médicale des médecins du XIXe siècle et que l’on met en parallèle les plateaux techniques de nos hôpitaux contemporains, on prend alors la mesure de cette technologisation. La trousse chirurgicale du médecin de campagne comprend en effet deux types d’outils6 : ceux de petite chirurgie et ceux destinés aux grosses opérations. À la première catégorie appartiennent les daviers (extraction dentaire), les sondes et les crochets, le scarificateur, la lancette, les bougies, les aiguilles et le fil, le cathéter (qui soulage les vessies), le bistouri (ouverture des abcès) ou encore les forceps. Dans la seconde catégorie, des objets plus inquiétants : couteaux, scies à amputation, trocarts pour ponctionner l’abdomen, tenettes et trépan etc. Outils souvent fournis par l’artisan du village dans lequel exerce le médecin.
Ainsi, si l’on met en parallèle un tel descriptif avec les moyens de la médecine moderne, on prend alors la mesure du changement introduit par la technologie et l’imagerie médicale. Mais dans le même temps, on comprend également pourquoi ces merveilleuses inventions que sont celles de notre temps ont changé les termes de la relation soignant-soigné. Alors qu’au XIXe siècle, le médecin est directement confronté au corps du patient, de nos jours la technologie s’est interposée entre les deux et le médecin a plus souvent affaire avec le « corps intérieur », et par là même, directement avec la pathologie, voire même à son image sur écran derrière une vitre qui l’isole du patient. Aujourd’hui, « on fait des examens (grâce à la technique) et on examine ensuite ».
Le corps tend à devenir seulement le support, ou le site, de la pathologie et cette dernière que l’on soigne et visualise sur écran. C’est d’ailleurs dans la structure hospitalière, lieu d’exercice le plus technicisé de la pratique, que le corps semble le moins perçu comme un corps habité. Il y est « tronçonné » (découpé en cibles), palpé (comme un matériau), pénétré (comme un labyrinthe) et « tenu à distance par des caméras ». Ainsi, en poussant à l’extrême ce raisonnement et, parodiant à peine Baudrillard, nous pourrions dire qu’il n’y a plus du corps que son image. Ces changements sont par ailleurs très nettement perceptibles lorsque l’on s’arrête un instant sur le langage utilisé par les hospitaliers eux-mêmes. En ce sens, les structures syntaxiques relèvent bien des structures mentales. Il n’est en effet pas rare, pour ne citer qu’un exemple de ces déplacements sémantiques, de pouvoir entendre avant une radiologie ou un scanner, le radiologue annoncer « faites entrer l’épaule », comme si ce qui constituait l’objet du praticien était la pathologie, seule, dégagée du corps de celui qui la supporte.
Ainsi, tout semble se dérouler comme si la technologie et la société modernes avaient abrégé le corps au titre de support ; comme si la médecine était soudain devenue une affaire de technique et d’imagerie et le corps une machine dans laquelle il est possible de dissocier les pièces du moteur de la carrosserie, l’intérieur... « La culture de nos hôpitaux ce n’est plus le découpage du cadavre, c’est un désir d’effraction du vivant, le désir d’anéantir l’autre dans ses moindres recoins, d’ouvrir la boite charnelle, c’est l’idée qu’on va comprendre les choses en les épluchant [...] les médecins vivent dans l’illusion que seul le réel compte » (Paul Hardouin dans Hamon, 1994, p. 77). Le corps devient donc pour le « toubib » moderne une énigme, un rébus ou un jeu de piste. Les médecins plaisantent d’ailleurs volontiers de leur diplôme en disant qu’il s’agit d’un « permis de chasse ». En effet, aujourd’hui il n’est plus question de palper, de sentir ou de renifler, « de négocier la confidence qui peut éclairer et l’obéissance qui peut sauver » ; une simple prise de sang apporte des informations à trois chiffres après la virgule : du propre, du net et surtout de l’indiscutable. Ainsi, l’association résolument moderne que forment technologies et sciences devient un outil implacable, sans faille ; désormais, le médecin est pris au sérieux et écouté, il n’a plus à négocier et composer avec les préférences et les répugnances du patient pour obtenir la confiance et l’obéissance qui, jusque-là, formaient la clé de voûte de toutes relations médicales.
Outre ce comportement nouveau dans le rapport au corps du fait de l’introduction de la technologie et de la rationalité instrumentale entre le soigné et le soignant, il semble que, dans la réunion singulière qui fait se rencontrer ces deux derniers, il faille ajouter un fait nouveau : la croyance en la science étant devenue générale dans le courant du XXe siècle (on pourrait sans doute dire autre chose aujourd’hui), le patient n’interfère plus dans le jugement du médecin. Ainsi, celui-ci devient l’expert ; il est celui qui détient le monopole de la vérité sur le corps. À ce sujet, une fois encore le parler des praticiens hospitaliers est éloquent : ils ne parlent pas de M. Untel ou encore du patient mais ils disent plutôt « je déshabille mon patient », comme si ce n’était finalement pas le malade qui se déshabillait, qui confiait son corps à la compétence du savant mais le médecin, qui, en possession du corps, décidait des orientations de ce dernier. Il y a donc là un changement notable : alors que le médecin du siècle dernier devait composer avec les coutumes populaires, que pour ne choquer personne, il préférait souvent mesurer la fièvre au pouls avec sa montre plutôt que sous les aisselles (ce qui aurait été vécu comme une intrusion par le patient), les médecins contemporains usent de techniques « intrusives », pénètrent les corps en images sans que ceux-ci ne protestent.
Au final, quelques traits significatifs se dégagent : l’arrivée de la technologie et de l’imagerie, la montée du pouvoir médical et enfin, conséquence des deux premiers caractères, un changement radical dans la perception du corps. Outre le rapport nouveau aux patients, l’introduction de la technologie et de la rationalité instrumentale semblent changer considérablement les choses. Selon toutes apparences, le changement essentiel qui est apparu dans la relation singulière qui réunit patients et médecins peut être caractérisé selon trois grands registres : d’abord, la foi en la science et au progrès, se traduit par l’innovation technologique, ensuite la rationalisation des méthodes de travail et de traitement dans le corps médical, et enfin la montée de la division du travail (qui se manifeste dans un découpage de plus en plus fin du corps en spécialités).
Ce qui semble avoir changé véritablement dans la pratique médicale, c’est donc l’image du corps du patient. Cependant, réfléchir sur la pratique médicale, ce n’est pas seulement réfléchir sur la relation du médecin au corps du patient. Et, si les perceptions du corps restent des traits pertinents du changement il est nécessaire d’élargir le propos afin de prendre en compte le contenu des perceptions du corps non plus de façon unilatérale (seulement du côté de la pratique du médecin) mais en parallèle à celles des patients. Car, si la relation malade-médecin ne peut être dissociée du contexte socio-historique dans lequel elle s’actualise, il convient de penser comment la perception que le patient a de son corps peut en modifier la définition.
Il s’agirait de comprendre comment les différentes connaissances sur le corps dont disposent les individus, en fonction des milieux sociaux auxquels ils appartiennent, peuvent changer la nature de la relation médicale et, par là même, se révéler comme des indicateurs pertinents des changements survenus dans la forme même de la pratique de l’expert, c’est-à-dire dans la relation de ce dernier à son patient. En d’autres termes, il faudrait pouvoir caractériser les schèmes de perception du corps que font fonctionner les patients face au mal et qui interfèrent dans la relation médicale elle-même. Mais avant d’atteindre un tel niveau d’interprétation, il faut décrire de façon plus concrète les principaux traits de cette perception du corps, la manière dont elle interfère dans la relation malade-médecin et comment cet état de fait a pu changer au cours du temps.
Parmi les aspects les plus saisissants, il en est un qui semble très bien illustrer le rapport de l’individu du XIXe siècle à l’endroit de la pratique médicale : la méfiance. Il y a, en effet, dans la société du siècle dernier une attitude de méfiance vis-à-vis du médecin qui est différenciée selon la position des individus dans l’espace social et qui est assez répandue pour constituer un critère ou un indice pertinent dans le repérage des évolutions. Il suffit pour comprendre cette attitude de citer le passage dans lequel René de l’Estrade proclame : « les mères en savent plus sur les convulsions que les médecins » (Lebrun, 1995). De même, dans les milieux les plus évolués, la bienséance veut que toute exploration gynécologique ou anesthésie sur une femme se fasse en la présence d’une amie. De même, Jacques Léonard (1977) rapporte que dans la majorité des familles, surtout à la campagne, les femmes ne font pas confiance au médecin en matière d’accouchement et de soins aux enfants.
Cette défiance apparaît différente selon les caractéristiques sociales des individus. Par exemple, il semble qu’il y ait eu, au cours du XIXe siècle, une attitude méfiante tout à fait singulière de la part des femmes à l’égard du corps médical. Et, si l’on sait toute l’ambiguïté des rapports hommes-femmes en ces temps, ces dernières étant considérées comme prédestinées à la maternité et faibles (subordonnées à l’ordre masculin), ceci ne permet pas de rendre totalement compte de l’attitude des femmes à l’égard de la médecine. Aussi, faut-il rattacher ces dispositions aux valeurs qui sont celles de la société du XIXe siècle pour saisir toute l’équivoque de la spécificité féminine comme l’ambivalence entretenue par le médecin à leur endroit.
En effet, nous sommes dans une société où la subordination sociale de l’être féminin en fait des êtres « à part ». On parle alors, y compris dans les milieux médicaux les plus avancés, de maladies de femmes, de leur tendance hystérique et parfois même, dévoilant le secret médical, les médecins aborderont la question de la « mauvaise conduite » de certaines d’entre elles7. Quant aux femmes, elles entretiennent largement le mystère qui les entoure. Leur extrême pudibonderie tient, en effet, à l’écart des médecins une large partie des affections de nature sexuelles dont elles souffrent. La toilette intime passe d’ailleurs pour du libertinage. Le mystère féminin restant entier, entretenu souvent par des croyances religieuses ou magiques, la rencontre du corps médical et du corps féminin ressemble alors à un « rendez-vous manqué » (Léonard, 1977).
C’est donc principalement de la ville que le changement d’habitude viendra. En effet, la modification attitudinale se fait avec le passage à une autre société et de manière différenciée puisque c’est de la ville (donc de l’urbanisation) et dans les milieux sociaux les plus éclairés, que le changement s’amorce. Il faut attendre que les médecins, en dépit de maints efforts pour conquérir cette « clientèle », rencontre en ville une certaine compréhension de la part de quelques « familles éclairées ». Mais, dans les milieux les moins informés, loin des dispensaires de la ville, les médecins ont énormément de mal à bannir définitivement les usages anciens, « Les écrits des médecins ne dépassent guère le cercle étroit des gens cultivés » (Lebrun, 1995, p. 22). En effet, le populaire s’est forgé sa propre image de la maladie et l’a intégrée dans une conception générale du monde, un ensemble de rapports doté de sens, une cosmologie.
Pour bien comprendre cet aspect du savoir populaire, on peut considérer d’autres catégories modestes tels que les ouvriers et les paysans qui, par les attentions qu’ils ont attirées sur eux révèlent bien le scepticisme des patients de cette société du XIXe siècle eu égard à la médecine. On trouve dans ces classes, auxquelles les médecins ont beaucoup consacré leurs efforts pour les atteindre, une forte méfiance de la médecine qui a pour corollaire une forme de savoir populaire singulier pour l’appréhension de leurs relations au savoir médical. Pour ce qui concerne les paysans on sait par exemple qu’ils furent durant longtemps l’objet d’une attention originale de la part du corps médical8. Cependant, ceux-ci ne semblent pas rendre aux médecins la compréhension qu’ils en reçoivent. Ils cultivent en effet les superstitions et accusent copieusement les médecins de cupidité et d’incompétence. Les proverbes en usage dans les campagnes françaises témoignent bien, à ce sujet, de leurs sentiments de méfiance. Pour les paysans, il vaudrait mieux prévenir que guérir et donner son argent au boucher et au boulanger plutôt qu’au médecin. Au fond, le paysan se demande si le médecin ne se réjouit pas des épidémies qui l’enrichissent. Néanmoins, ceux-ci tirent une certaine fierté de la fréquentation du médecin qui appartient à la bourgeoisie diplômée et, par ce biais, les médecins pourront peu à peu obtenir d’eux que soient observés quelques conseils d’hygiène domestique tels que le blanchiment des murs à la chaux, le remplacement des guenilles des enfants etc. cette discipline amorcera alors l’apprentissage de la propreté.
Quant aux ouvriers, à la différence des paysans qui pouvaient bénéficier d’une certaine compréhension du corps médical, ils suscitent d’énormes inquiétudes médicales, morales et sociales. Cette population misérable et dangereuse colporterait, selon les propos soucieux des médecins d’alors, les poux et les puces, les virus et les microbes, se laisseraient également aller à l’alcoolisme, la délinquance, le concubinage... Cependant, comme les paysans, les ouvriers trouveront chez les médecins, inquiets des risques pour le reste de la population, des défenseurs et même quelques fois des émancipateurs9, qui tous insistent sur la mort qui scelle l’opposition des ouvriers et des nantis.
On comprend donc que la lutte des médecins fut longue pour faire accepter aux couches sociales les plus modestes et les moins éclairées la nécessité de les consulter. Jusque-là, la maladie était restée dans l’ordre du fatum, la maladie apparaissait à ses classes comme un fléau et, à en croire les proverbes alors populaires, contre elle. Il fallait surtout compter sur Dieu : « dieu qui donne la plaie, donne le remède » ou « devant Saint-Blaise, tout mal s’apaise ».
Bien plus encore qu’un ancrage religieux relativement fort, ce que ces expressions nous donnent à voir c’est, une fois encore, la présence forte d’un sentiment de méfiance vis-à-vis de l’expert : « À la fièvre et à la goutte, les médecins ne voient goutte », « médecins et maréchaux font souvent mourir gens et chevaux », « Dieu guérit et le médecin encaisse » etc. Il y a donc là un ensemble d’indices qui conduisent à penser que la croyance au pouvoir de la science est faible, du moins en ce qui concerne ces classes, et que la défiance envers la médecine reste très présente. On explique et on comprend le fonctionnement du corps par un savoir tout autre qui fait se mêler la science, la religion et la magie, à l’idée selon laquelle « la nature fait bien les choses ». On rencontre d’ailleurs, à cette époque, toute une série d’ouvrages qui amalgament connaissances médicales et savoir populaire. Ainsi dans La médecine et la chirurgie des pauvres de dom Alexandre en 1714 on peut lire : « On s’attend bien qu’étant composé d’ingrédients communs, et même dégoûtants, ils seront méprisés et rejetés par les riches et par les personnes qui affectent en tout des airs de grandeur, même jusque dans l’usage des remèdes, n’estiment que ceux dans lesquels il entre des drogues rares, venues des Indes et à grands frais, et dont cependant très souvent l’effet le plus sensible est de vider leur bourse sans leur rendre la santé, pendant que les gens du commun se guérissent promptement et parfaitement des mêmes maladies par des remèdes simples et familiers, que leurs médecins n’osent souvent leur proposer, ou par crainte de blesser leur vanité et leur délicatesse, ou de passer eux-mêmes pour des médecins à remèdes de bonnes femmes, car c’est ainsi qu’on les appelle pour les rendre méprisables, quoiqu’il arrive tous les jours que les malades, après avoir usé très longtemps et inutilement des compositions les plus pompeuses de la médecine, sont guéris promptement par un remède indiqué par un paysan ou une femmelette » (Léonard, 1977).
Il y a donc, dans cette société du XIXe siècle, une sorte de théurgie, de savoir populaire, sur la maladie et le corps qui, comme l’atteste bien l’exemple des femmes, est en rapport avec un système de valeurs plus large produisant un rapport à la médecine spécifique et, par-là, affecte les modalités de la consultation. En effet, la méfiance est introduite non pas seulement du fait de l’ignorance mais aussi par le fait qu’il y a des valeurs sociales qui orientent la perception de l’être, de son corps, en conséquence, la relation malade-médecin en est affectée. Aussi, pour voir disparaître cette méfiance faudra-t-il attendre le développement de l’urbanisation et un accès plus large à la culture.
Ainsi, il semble que, dans cette société du XIXe siècle, ce qui caractérise la relation malade-médecin du côté du patient, c’est une position de méfiance. Situation qui, par ailleurs, semble être largement alimentée par certaines croyances populaires. Il semble qu’il y ait dans cette société une forme populaire de savoir sur le corps tout à fait singulier si on la compare à celle de notre temps. Et, même si celle-ci est le fait des couches sociales les plus modestes de la population qui se trouvent loin de la ville et de ses dispensaires, et ont peu fréquenté l’école, nous verrons qu’elle n’en est pas moins importante et que les médecins auront beaucoup de mal pour mettre leur pratique au service de ces populations. Les perceptions populaires du corps et de la maladie caractérisent bien cette époque et affectent les termes de la relation malade-médecin.
S’il y a une interprétation populaire du soin, il y a aussi une construction du corps et de la maladie qui s’articule sur des savoirs à peu près identiques. On sait, par exemple, que dans les descriptions anciennes, le corps et les symptômes sont montrés et décrits par les médecins mais qu’en revanche la souffrance est beaucoup moins présente. Les témoignages de ces temps ont l’allure de descriptions faites par des observateurs externes et c’est surtout les signes extérieurs du mal tels que la toux, la bile, le sang, les crachats etc. qui importent. Outre cela, ce qui frappe encore plus dans ces descriptions, c’est que « rien n’échappe au mal » et que celui-ci va jusqu’au bout, il ronge le corps et aucun de ses aspects ne lui échappe. Pour reprendre l’expression de F. Lebrun : le corps est transformé.
C’est, une fois encore, une appréhension externe, en ce sens que, même lorsqu’il s’agit d’approcher la partie interne du corps, ce sont des indices tels que les humeurs ou le pouls qui sont retenus. C’est d’ailleurs depuis la fin du Moyen-Âge jusqu’à l’apparition de la médecine clinique que la lecture du corps et l’action thérapeutique se distribuent entre deux corporations : les médecins et les chirurgiens. Aux premiers échoit la compréhension du corps interne à partir des humeurs, aux seconds, l’intervention qui active le corps externe. Néanmoins, c’est la première théorie qui domine puisque l’on opère peu et seulement à partir de la connaissance des signes extérieurs, qui, somme toute, demeure indécise.
Ce qui caractérise ces temps, c’est donc bien le fait que la maladie marque le corps. C’est l’aspect externe de la pathologie qui est tenu pour signifiant, et ceci, tant du point de vue du praticien que de celui du patient. Tout se passe comme si la maladie était une atteinte au corps externe, un « stigmate » Goffmannien. On peut citer ici le témoignage d’une jeune femme qui exprime sa peur de « ce qui se voit de l’extérieur » : « Dans la mesure où je ne vois pas les dégâts extérieurs de la maladie je ne suis pas effrayée par exemple, un cancer intérieur ne m’effraie pas, un cancer extérieur m’affole... quand je vois des gens avec une joue en moins je suis sûr que ce serait moi qui l’aurais ; je souffrirais bien plus d’avoir quelque chose de l’extérieur » (Herzlich et Pierret, 1984, p. 115).
Ainsi, le symbole de la maladie effrayante est celle qui s’attaque à l’intégrité du corps externe. Il y a, ici, un imaginaire de la maladie qui paraît beaucoup devoir à des maladies telles que la lèpre - symbole de la maladie horrible qui s’en prend directement à l’enveloppe charnelle. Dans cette conception populaire du corps et de la maladie qui, comme nous l’avons évoqué, s’enracine dans une pensée populaire qui assemble des données du christianisme à des éléments para-chrétiens, la maladie, en tant qu’elle est de l’ordre du naturel, voire du châtiment divin10 touche l’intégrité physique de l’individu et celui-ci est désigné et reconnaissable comme malade de par l’aspect externe de son corps. La maladie est de l’ordre du stigmate, elle est réelle car elle est visible et lisible dans l’apparence, c’est quasiment la marque d’une malédiction. Dans un tel contexte, c’est donc une vision globale du corps qui prévaut, le corps est « entier ». Mais, pour mieux comprendre les discordances existantes entre ces perceptions du siècle dernier et celles qui nous sont contemporaines, il nous faut ici appréhender les perceptions qui prévalent actuellement, car même si le changement apparaît manifeste au vu de la lecture du corps que nous venons de restituer, il faut néanmoins comprendre plus exactement ce qui fonde ces différences. Pour ce faire, dans cette partie, nous tentons de voir dans un premier volet ce qui a changé dans la perception du corps atteint par la maladie chez le patient, et ensuite de voir comment ce changement a pu venir modifier et affecter les termes de la relation malade-médecin.
« Un après-midi durant j’ai regardé fonctionner un scanner... Ce jour-là une manipulatrice Hypertyroïdienne, dans une ambiance de kermesse exaltée, vantait les performances du joujou prodigieux. Une vitre isolait phoniquement la tour de contrôle de l’aire d’examen... Les patients entraient un à un, vêtus d’une blouse verte. On ignorait tout de leur histoire, on connaissait seulement la mire. On leur ordonnait au microphone de s’allonger et de se laisser sangler... On appuyait sur F9... » (Hamon, 1994, p. 79). Ce qu’illustre bien cette brève et anodine relation, c’est un changement d’attitude qui se manifeste dans une rupture de la médecine actuelle avec le corps externe et dans un changement essentiel de la relation malade-médecin ; c’est aussi une nouvelle vision du corps externe, du corps malade, siège de la maladie. On voit, effectivement, que ce qui compte ici ce n’est pas la parole du patient (« une vitre isole phonétiquement »), ni son histoire (« on ignorait tout de leur histoire ») mais ce que l’auteur appelle la « mire », c’est-à-dire ce que l’on va visualiser de leur corps interne, la partie sélectionnée du corps où siège la pathologie supposée. Par ailleurs, on voit assez nettement dans ce récit la distance qui sépare, à la fois réellement et virtuellement, les médecins du patient (vitre, micro, écran...) qui ne sont nullement ici pour jouer aux « confesseurs des impressions subjectives » ni pour palper le malade et encore moins pour juger de la couleur de ses fèces ou autres humeurs. Ici, seul ce qui s’affiche sur l’écran semble être vrai. Ce qu’illustre cet extrait, c’est donc bien un abandon de la prise en compte des aspects externes de la pathologie au profit de sa représentation.
Plus profondément, on voit ici se distinguer l’aboutissement d’une révolution dans les moyens d’investigation qui, de plus en plus performants, permettent la pénétration intime du corps et la compréhension de son fonctionnement. Cette évolution, qui a commencé à partir du XVIIIe siècle avec les autopsies, s’est prolongée avec l’invention du stéthoscope (apparu vers 1880) de l’endoscopie11, du microscope, et enfin avec l’utilisation des rayons X, qui, à la fin du XIXe siècle, vont bouleverser l’approche de nombreuses affections. Avec cette nouvelle appréhension de « l’interne », le médecin, comme le patient, a renouvelé les schèmes de perception du corps. La vision d’un « corps-machine » ayant une mécanique interne, une boîte noire, va peu à peu s’imposer pour devenir la vision dominante. Nous sommes donc aujourd’hui dans le siècle d’une vision que l’on appelle, à juste titre, mécaniste. Le corps fonctionne, se répare – et on changera même parfois quelques pièces défectueuses ! Ainsi, le patient, comme le médecin, est amené à porter son regard, et à interpréter son corps depuis son fonctionnement interne. L’examen radiologique en particulier semble avoir étendu cette vision interne comme l’atteste l’exemple, assez répandu pour être tenu pour signifiant, des gens qui exhibent leur radiographie et tentent de lire le mal, sis sur le cliché, qui confère la preuve de son existence.
Dans la plupart des cas, il semble donc que le patient, comme le médecin, ait évolué vers une vision interne du corps malade. On a donc affaire à une nouvelle appréhension, comme si l’espace de la pathologie s’était déplacé vers l’intérieur de l’organisme et que, le malade avait adhéré à la perception médicale du mal (Herzlich et Pierret, 1984, p. 102), à l’approche technique du corps et les a faites siennes. Contrairement à l’individu du XIXe siècle, le malade d’aujourd’hui croit plutôt aux images médicales (radio, examens...) qu’à l’apparence de son corps. On passe donc à une appréhension technicienne de la part du patient lui-même qui, pour savoir s’il est malade, attend la vérité des examens et des images.
Pour donner une bonne illustration de ce changement, on peut citer le cas des diabétiques qui surveillent leur corps au quotidien à travers des taux de glycémie, des bilans phosphocalciques... Une autre preuve, plus forte encore, de cette évolution est la situation typique d’un individu qui rapporte à un de ses amis qu’il est atteint de telle ou telle maladie et l’autre de lui rétorquer « tu as fait des examens plus approfondis à tel hôpital, des radios, scanners ? » Comme si ce n’était pas la compétence du médecin, mais la fiabilité d’un équipement technique et d’imagerie qui était garante d’un diagnostic juste. À cet égard, il est d’ailleurs intéressant de noter que la technique elle-même semble devenir « machine à vivre » comme l’atteste le développement des prothèses de plus en plus sophistiquées, des pacemakers, des poumons artificiels. Sur ce sujet, les travaux sur l’humanité augmentée sont très disserts.
Ainsi, nous pourrions presque transposer l’expression de Baudrillard à propos de la guerre du Golfe et dire qu’il n’y a de la maladie que les images. Mais ce n’est pas là l’essentiel et ce serait largement « croquer le portrait » que d’affirmer ceci. En revanche, ce qui compte, c’est que de nos jours la maladie ne se lit plus, ou du moins guère plus, sur nos corps. Elle est en quelque sorte « déréalisée » et, par conséquent, la maladie tend à se séparer du corps du malade (Foucault avait déjà montré qu’ils n’ont pas toujours coïncidé) ; elle n’est réellement présente que virtuellement. Aussi, il n’est pas étonnant de pouvoir entendre les médecins annoncer « faites entrer l’épaule ». Désormais, pour comprendre le mal qui l’habite, l’individu n’interroge plus une vision globale de son corps mais se tourne vers le savoir et la technique médicale qui, pour le renseigner, « fait des examens et examine ensuite ». Dès lors, nous sommes passés progressivement d’une vision globale du corps et collective de la maladie12, à une vision parcellisée dans une compréhension interne du corps et une approche individuelle de la maladie. Ce qui, par ailleurs, montre bien comment le savoir médical a, peu à peu, imposé son approche et sa conception du corps comme de la maladie. Toutefois, ce n’est pas là que réside l’essentiel. En effet, accepter l’idée selon laquelle ce sont les changements survenus dans les théories et les pratiques médicales qui ont changé les perceptions générales de la maladie et du corps, et par là même, modifié les modalités de la relation malade-médecin, ce serait oublier que, les médecins comme leurs patients, sont avant tout des agents sociaux intégrés à un système social dont les valeurs et la structure se modifient et changent dans le temps. Aussi, faut-il tenter d’appréhender les modifications de la relation à la médecine, vues ici à travers les rapports au corps, en les référant à l’idée de changement social et aux usages de l’imagerie médicale.
Cet article, proposé sur le ton de l’esquisse programmatique, plus nourri de lectures que d’observations empiriques, invite donc à une re-considération du questionnement de la pratique médicale et de la place qui occupe l’imagerie. Le détour historique permet d’ouvrir le sujet, de questionner les changements relevés et d’essayer de comprendre ce qui, dans les changements vus, peut être mis en parallèle et éclairé par des changements de type sociaux et qui, finalement, pourrait présider à une investigation plus poussée. « Le malade est amené par le brancardier, enveloppé comme en papillote. On le transfère sur la table, on lui dénude la poitrine et on lui applique des capteurs. On lui lâche mécaniquement trois phrases, toujours les mêmes, sur le mode tout-ira-bien-madame-Lemoine. L’anesthésiste déclenche le pousse seringue, l’œil rivé aux moniteurs qui affiche l’électrocardiogramme et le débit des gaz. La panseuse classe les instruments et compte les compresses. Une infirmière fixe des poignées aux Scialytiques. Tout cela tranquillement, la matinée sera longue. Le chirurgien, lui, se dandine à l’écart sans mot dire. Dès que l’angoisse s’est éteinte dans l’œil du patient, le sien s’allume. “C’est bon !”, dit l’anesthésiste, qui disparaît derrière un champ suspendu tel un drap qui sèche. Le chirurgien s’approche, la papillote s’ouvre presque théâtralement : le cadavre vivant est à lui. Il en prend possession avec une sorte de gourmandise, tourne autour, s’installe, cherche sa position » (Hamon, 1994). On entrevoit assez clairement dans cette courte relation quelques-unes des grandes tendances relevées dans cet article et qui peuvent être réparties selon trois grands registres, à savoir l’avènement de la technologie et de l’imagerie (deux éléments indissociables), une division du travail marquée une relation malade-médecin de plus en plus anonyme.
Ces registres sont constamment présents dans l’histoire de la médecine. La trousse du médecin du XIXe siècle, par exemple, est caractérisée par la présence de quelques outils simples et rudimentaires (souvent fabriqués par l’artisan de la localité dans laquelle réside le médecin) qui ne font que prolonger la main du chirurgien. De façon différente, aujourd’hui, avec l’arrivée de l’électricité et de la machine, la distance entre la main du chirurgien et le corps du patient tend à devenir de plus en plus grande (on peut citer, à titre d’exemple, la microchirurgie). Désormais, entre le corps du patient et le médecin, il y a la machine, c’est-à-dire la technique. Or, on a également vu comment l’entremise de la technique a pu modifier la relation malade-médecin en faisant que celui-ci perçoit de plus en plus le corps, non plus directement au travers du regard, mais au travers d’un média : l’image, les chiffres, les analyses... Ainsi, le corps n’est plus l’objet d’un regard d’Homme de l’art, d’un médecin qui, pour établir son diagnostic, doit faire feu de tout bois, s’intéresser à l’histoire du patient, son milieu de vie... Désormais, le diagnostic passe par une lecture codifiée du corps (chiffre, taux, imagerie médicale etc.) dont la technologie est le seul artisan.
C’est la lecture du corps qui s’en trouve considérablement différente. Il est aujourd’hui lu selon des catégories très précises, tronçonné en diverses spécialités, et enfin, tout semble se passer comme si le contact direct avec le patient n’était maintenant plus qu’une tâche subalterne (ici, c’est l’infirmière qui rassure le patient et le prépare). C’est parfois même la disponibilité et le planning des machines qui imposent rythme et division du travail. Finalement, l’arrivée de techniques de plus en plus avancées semble avoir conduit peu à peu les médecins à abandonner les tâches les plus dévalorisantes, désormais confiées à une catégorie de personnel hiérarchiquement inférieure (ici l’infirmière). En réalité, on pourrait avancer que la « division morale du travail » (Hugues, 1958, Peneff, 1992), qui oppose le « sale boulot » au travail « respectable », se mesure à la distance qui sépare de la technologie et l’imagerie médicale, de la nouveauté. Ainsi, si l’on suit ce raisonnement, on voit bien que, dans la hiérarchie qui se fonde dans cette distance, c’est aussi une distance au passé qui se manifeste puisque ce qui différencie le médecin du siècle dernier de celui d’aujourd’hui est une différence fondamentale dans l’écart qui sépare le patient du médecin, cet écart s’étant creusé à mesure de l’avancée technologique.
Plus profondément, c’est un déplacement du regard médical. Avec l’arrivée des nouvelles technologies et de l’imagerie, c’est un nouvel espace du corps, jusqu’alors invisible, qui s’est ouvert à la médecine ; c’est l’espace interne, fondamentalement invisible et impénétrable, qui s’est offert à la clarté du regard grâce au développement des techniques d’introspection. Ainsi, on l’a vu, ce sont les conditions du diagnostic qui en furent affectées ; les manifestations externes de la maladie sont maintenant placées au second plan. Le regard du médecin, maintenant médiatisé par la technique, est donc plus que jamais un regard sur l’intime. Avec le développement de la technique, la connaissance de l’interne qui n’était jusqu’alors pensable et réalisable que sur les cadavres, les corps morts (à la manière de Bichat), est accessible dans le corps des vivants. Il y a là, nous semble-t-il, un déplacement du regard médical lourd de sens. Le médecin dont la connaissance du corps interne, du fonctionnement intime, s’était établie sur un matériau corporel inerte a maintenant accès à ce même espace dans le vivant. De plus, il est le seul à connaître et à pouvoir voir et lire le fonctionnement du vivant et, par là même, à détenir le savoir sur les secrets du vivant, sur notre « intime ». Or, c’est ce même « intime » ce corps dévoilé dont Foucault nous dit qu’il constitue la base du savoir et du discours médical, qui lui-même s’est fondé dans la mort. Aussi, n’est-il pas étonnant qu’il y ait, chez les médecins, un désir de ne pas penser le corps comme étant habité, de rêver de voir le corps comme un cadavre encore vivant.
Enfin, ce qui s’impose également à l’observateur parmi ces changements, c’est un abandon progressif des mythes et croyances du côté du patient comme du médecin qui rationalise peu à peu ses méthodes. Et même si, comme le montre Luc Boltanski (1971) du côté des patients, il demeure à ce sujet une différence selon les catégories sociales d’appartenance, on voit très clairement s’imposer peu à peu les catégories du savoir médical. Il semble d’ailleurs que l’on puisse, à ce sujet, reprendre la distinction faite par les anthropologues entre perception « endogène » et « exogène ». En effet, comme nous l’avons vu, du côté du médecin comme de celui du patient, la perception du corps passe de plus en plus par un déchiffrement interne du corps et la pathologie n’est plus comprise comme l’effet d’une entité externe au corps (malédiction ou autre), la maladie trouve son explication et sa logique dans le schéma de fonctionnement même du corps. Une autre épistémé s’impose, et avec elle, un nouvel ordre du corps. Il serait intéressant à ce sujet de pousser l’investigation empirique du côté de la formation à l’usage des images médicales, de connaître les représentations des médecins vis-à-vis de ces évolutions. Cette manière de pratiquer la médecine sans toucher les corps apparaît-elle comme un idéal chez les médecins et futurs médecins ? Est-elle critiquée comme ne relevant plus de la pratique de la médecine et si oui, par qui ?
Bien sûr, le progrès technologique et l’imagerie médicale ne sont que des conditions nécessaires, et non suffisantes et directes, pour rendre compte de ces évolutions. Ils ne peuvent être isolés de leur contexte socio-historiques généraux. Mais il reste, qu’à la compréhension de l’organisation médicale et à la réflexion sur ce qu’il est convenu d’appeler le colloque singulier, il faut désormais ajouter au moins deux grands thèmes : les normes et valeurs qui structurent la compréhension du corps du médecin comme du patient et le rôle de la technique et de l’imagerie.
1 Je précise que cet article a été écrit avant la pandémie de la Covid-19 et que c’est un choix de ne l’avoir pas réécrit dans cette perspective, privilégiant ainsi le temps long et espérant que cet épisode reste un élément de conjoncture ; faiblement explicatif et difficile à mobiliser sur le temps long.
2 On s’appuiera essentiellement sur : Léonard, 1977 et Hamon, 1994. Par ailleurs, on puisera de façon assez abondante dans les ouvrages de Claudine Herzlich et Jeanine Pierret, 1984 et François Lebrun, 1995. Ces ouvrages ne sont pas récents. Mais il ne s’agit pas ici de décrire une situation présente mais de dresser le tableau d’une évolution des pratiques qui sont dans ces ouvrages très détaillées C’est là une option en phase avec le principe d’un article programmatique qui est ici notre parti : une économie des sources pour poser des questions, esquisser des hypothèses, ouvrant ainsi un chantier et un espace à la recherche empirique et approfondie et bien sûr à la critique et au dépassement.
3 Jacques Léonard (1977) montre très bien comment les médecins du siècle dernier ont pu abuser de certains remèdes qu’ils tenaient pour efficaces. Il nous montre comment les abus de médications dérivées du mercure ou de l’opium, l’utilisation maniaque de la lancette et d’autres ont provoqué de graves accidents. Mais surtout, il explique qu’avant la victoire de l’antisepsie les médecins « colportent innocemment des maladies contagieuses » (p. 77).
4 On note en effet une étonnante cohabitation de théories : les physiologistes qui tentent d’imposer l’idée que le malade n’est pas une entité particulière et que la pathologie est de la physiologie dérangée ; les néo-hippocratiques qui inspectent les crachats, l’urine... ; les disciples de Brown et Rasori qui prescrivent des stimulants et des sédatifs ; les amis de Raspail qui tiennent le camphre pour un désinfectant préservatif du choléra ; les broussaisistes qui font une utilisation forcenée des sangsues...
5 Michel Foucault dans sa Naissance de la clinique (1963) montre que les conditions de visibilité du regard et du discours médical n’ont pu être possibles que dans la mort. C’est lorsque la mort a pu être intégrée à l’expérience médicale que, dit-il « la maladie a pu se détacher de la contre nature et prendre corps dans les corps vivants des individus », p. 116.
6 Quelques définitions des instruments cités :
- Davier : pince à longs bras et mors très courts pour extraire les dents ;
- Crochet : instrument recourbé de taille variable destiné à l’extraction de corps étrangers ;
- Scarificateur : appareil permettant de réaliser une incision de l’épiderme ;
- Lancette : petit instrument muni d’une lame plate très pointue et acérée servant à réaliser des saignées ;
- Cathéter : tube long et mince destiné à être introduit dans un canal ou un vaisseau pour l’explorer, injecter un liquide ou le vider.
7 Dans les articles et les discours des hygiénistes, la « silhouette repoussoir », c’est la « mauvaise femme », fille de cabaret ou fille soumise parfois alcoolique ou syphilitique, elle infecte d’honnêtes familles et abandonne les enfants qu’elle met au monde. Par ailleurs, Jacques Léonard rapporte que les médecins s’inquiètent également beaucoup des jeunes « campagnardes déracinées », tristes « aventurières clandestines », « grisettes ou nourrices qui colportent le virus » (p. 192).
8 Jacques Léonard (1977) parle, à leur sujet, des « enfants chéris du corps médical ».
9 On peut citer parmi ceux-là : Scoutetten à Metz, Fodéré à Strasbourg, Potton et Hénon à Lyon, Bertulus à Marseille, Lestiboudois et Thouvenin dans le Nord etc.
10 François Lebrun (1984) montre très bien l’idée qui caractérise cette vision de la maladie : Dieu et Satan seraient constamment à l’œuvre dans le monde pour le malheur et le bonheur des Hommes et ils sont les maîtres de la maladie et de la santé, la maladie n’étant rien de plus que l’irruption des forces néfastes d’origines surnaturelles dans le corps.
11 Examen de certaines cavités du corps telles que l’estomac, la vessie etc.
12 Claudine Herzlich (1984) montre très bien comment la maladie était autrefois étendue à l’ensemble du corps social alors qu’aujourd’hui, elle est de plus en plus un sort individuel dont l’individu est responsable seul, comme si la responsabilité et le danger qui, jusque-là étaient rattachés à l’ensemble du corps social, s’étaient aujourd’hui restreints à la seule responsabilité du malade à l’égard de son corps.
« La spécialisation de la médecine, XIXe-XXe siècles », Actes de la Recherche en Sciences Sociales (2005), 156-157.
BOLTANSKI Luc (1971), « Les usages sociaux du corps », Annales, économies, sociétés, civilisations, 26 (1), p. 205-233.
BOURDIEU Pierre (1984), Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit.
CONRAD Peter, SCHNEIDER Joseph W. (1994), Deviance and medicalization. From badness to sickness, in ADAM Philippe, HERZLICH Claudine, Sociologie de la maladie et de la médecine, Paris, Éditions Nathan.
FOUCAULT Michel (1963), Naissance de la clinique, Paris, Presses universitaires de France.
HAMON Hervé (1994), Nos médecins, Paris, Éditions du Seuil.
HUGUES Everett C. (1997), « Men and their work », in Le regard sociologique, Paris, Éditions de l’EHESS.
HERZLICH Claudine, PIERRET Jeanine (1984), Malades d’hier, maladies d’aujourd’hui, Paris, Payot.
LEBRUN François (1995), Se soigner autrefois, Paris, Éditions du Seuil.
LEONARD Jacques (1977), La vie quotidienne du médecin de province au XIXe Siècle, Paris, Hachette.
PENEFF Jean (1992), L’hôpital en urgence, Paris, Métailié.
Olivier Chadoin, « De la confession des impressions subjectives à l’imagerie médicale. Essai pour un programme d’analyse », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 6 | 2022, mis en ligne le 6 juin 2022, consulté le . URL : https://rfmv.fr