

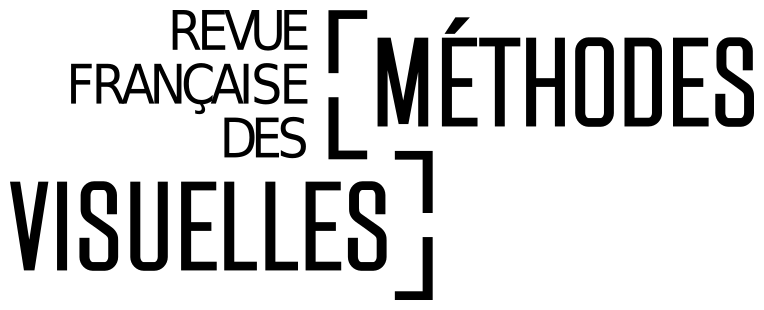
Émilie Balteau, sociologue, Lab’Urba (UPEC), co-administratice du CIREC (Centre de recherche-création sur les mondes sociaux)
Alexandra Tilman, sociologue, Université de Lausanne (SSP-ISSUL), directrice du CIREC (Centre de recherche-création sur les mondes sociaux)
En d’autres termes, et très simplement, le danger qui guette toute investigation menée par le biais de l’image enregistrée tient précisément dans la faculté à pouvoir monter en généralité alors même que le médium audio-visuel s’attache naturellement à personnaliser ses sujets.
Daniel Vander Gucht est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles où il dirige le Groupe de recherche en sociologie de l'art et de la culture et la Revue de l'Institut de sociologie. Il occupe la chaire de sociologie de l'art et celle de sociologie visuelle qui ont été créées à l'ULB sur son initiative et a organisé un colloque international en sociologie visuelle en 2010 dont les actes sont repris dans un volume double de la Revue de l'Institut de sociologie. Il est également à l’origine de la création du Comité de recherche en sociologie de l'art de l'Association internationale des sociologues de langue française ainsi que de la revue Sociologie de l'art avec Nathalie Heinich et André Ducret, publié de nombreux ouvrages scientifiques à titre d'auteur et en tant qu'éditeur aux éditions de La Lettre volée qu'il a fon-dées en 1989. Il est, par ailleurs, membre du comité d'expert du Comité d'art urbain de la ville de Bruxelles et de celui de Bruxelles mobilité pour l'implantation des œuvres d'art dans le métro bruxellois.
ÉMILIE BALTEAU ET ALEXANDRA TILMAN: On vous propose de commencer par nous expliquer ce qui vous a conduit vers la sociologie visuelle, en passant par la sociologie de l’art.
DANIEL VANDER GUCHT: Ma conversion à la sociologie visuelle s’est déroulée en trois temps, dont le premier remonte, et vient effectivement, de la conjonction de mes études en sociologie et de ma passion pour l’histoire de l’art que j’ai également étudiée à l’université après être brièvement passé moi-même par une académie des beaux-arts. Cet intérêt personnel pour les arts plastiques – ce que les Anglo-Saxons appellent les Visual Arts – m’a naturellement conduit à consacrer ma thèse de doctorat en sociologie à l’art contemporain mais aussi à sortir de mon isolement de jeune chercheur en sociologie de l’art à l’Université libre de Bruxelles où j’étais bien seul à travailler dans ce domaine en créant, vers 1985, un groupe de recherche ralliant des chercheurs d’autres sciences humaines qu’une approche sociologique de l’art pouvait fédérer. C’est ainsi que j’ai créé, de manière un peu informelle et sans aucun soutien institutionnel, le GRESAC (Groupe de Recherche en Sociologie de l’Art et de la Culture) où intervenaient tous les 15 jours des collègues qui travaillaient dans ce domaine et, pour diffuser les travaux et les communications présentés dans ce cadre, j’ai commencé à publier un Bulletin du GRESAC qui en était à son troisième numéro lorsque j’ai été contacté par mon collègue André Ducret de l’École d’architecture de l’université de Genève – très impliqué à l’époque dans le fonctionnement du Centre d’art contemporain dirigé par Adelia de Furstenberg qui a placé Genève sur la carte du monde de l’art contemporain. André avait le projet de créer un comité de recherche en sociologie de l’art au sein de l’Association internationale des sociologues de langue française, ce que nous avons fait à trois avec Nathalie Heinich, et le Bulletin du GRESAC est ainsi devenu la revue Sociologie de l’art toujours active aussi – ce qui explique que le premier volume de cette revue commence avec le numéro 4, soit dit en passant puisqu’on me pose régulièrement la question. Et lorsqu’il s’est agi pour moi de vouloir continuer à pratiquer et surtout à enseigner la sociologie de l’art à l’université, mon diplôme en poche, j’ai demandé à créer une chaire de sociologie de l’art et un centre de recherche dédié. Si je me permets de l’évoquer, c’est que cette expérience institutionnelle, qui permet d’exister publiquement et d’assoir la légitimité d’une discipline nouvelle ou marginale, est importante pour sa reconnaissance mais surtout, car c’est le plus important, pour créer un espace de rencontre, de dialogue et de débat entre pairs qui est indispensable à toute vie intellectuelle et qui est propice à son développement. Et la sociologie visuelle et filmique est également tributaire de la possibilité de tels échanges rendus possibles par la création de l’Association interna-tionale de sociologie visuelle par Douglas Harper qui en fut le co-fondateur et le président tout en étant un des précurseurs de l’usage de la photo-elicitation et des inspirateurs de ce qui est devenu un véri-table paradigme sociologique, à l’occasion de colloques internationaux occasionnels mais aussi par l’énergie déployée par certains, comme Joyce Sebag et Jean-Pierre Durand du Centre Pierre Naville de l’université d’Évry pour faire en sorte que la sociologie visuelle et filmique ne soit plus seulement une lubie de quelques chercheurs originaux et isolés mais bien une formation et un pôle universitaire re-connu. Je tenais donc à leur rendre hommage ici. Et pour finir de répondre à votre interpellation sur mon parcours, le second temps de ma conversion à la sociologie filmique aura été causé par mon admiration pour le travail de photographes, de cinéastes et de documentaristes dont les productions me sem-blaient non seulement relever pleinement d’un regard sociologique porté sur le monde social mais constitutives d’une véritable culture sociologique qui restait largement ignorée de mes étudiants comme de mes collègues. Puis, dans un troisième temps, par la conviction – confortée par la lecture d’Howard Becker mais aussi par la découverte des photos réalisées par Pierre Bourdieu en Algérie – que le sociologue ne doit pas se borner à étudier les images produites par les autres, comme peuvent le faire les historiens de l’art et les sémiologues, mais [qu’]il faut l’encourager à produire ses propres images qui répondent non plus à des impératifs commerciaux (comme la publicité), esthétiques (comme l’art), idéologiques (comme la politique), pittoresques ou sensationnalistes (comme les mé-dias) mais à un questionnement sociologique proprement scientifique. Faire ses propres images donc, non seulement comme on prend des notes ou comme on fait des repérages sur le terrain, en constituant des documents ou des archives, mais aussi, pourquoi pas, comme un mode d’enquête, d’analyse et même de restitution de la recherche à travers le médium audiovisuel, y compris pour des thèses doctorales dès lors que le film documentaire, par exemple, n’exclut ni les commentaires savants, ni les données chiffrées ou les références théoriques qu’on peut parfaitement intégrer et expliquer dans ce médium autre que l’écrit. Sans compter toutes les dimensions scopiques et sensorielles que ce médium permet d’ajouter à ces données chiffrées et au logos pur.
EB et AT: La question de l’aptitude de l’image à « véhiculer du sens et de la pensée » (pour reprendre vos termes) figure au centre de votre ouvrage Ce que regarder veut dire. Elle touche notamment à la question de l’esthétique et, c’est lié, à celle de l’accessibilité ou de la « lisibilité » du discours. Pouvez-vous revenir sur cette idée directrice et sur la manière dont y est pris le regard sociolo-gique ?
VDG.: L’indexation de la question de la sociologie visuelle à celle de la pensée visuelle repose sur un constat général : des grottes de Lascaux jusqu’à l’art de propagande en passant par l’art religieux et les codes de l’art académique, l’image a de tout temps démontré qu’elle pouvait se faire édifiante, transmettre des idées, faire ressentir des émotions, bref qu’elle ne se dérobe pas à l’herméneutique et qu’elle peut traduire à peu près le même spectre de connaissance que le verbe et fait ainsi la preuve que ce langage symbolique est parfaitement apte à véhiculer du sens et une pensée articulée. Pour autant, bien sûr, que l’on ait appris à lire les images comme les mots et que l’on maîtrise la grammaire et la syntaxe visuelles (qui découlent pour le langage cinématographique, comme l’ont bien compris Kouletchov, Eisenstein ou Hitchcock et tous les cinéastes maîtres de leur art, de l’art ou de la science du montage, soit de la juxtaposition et de la séquentialité des images qui induisent des idées et des sentiments par leur association même) aussi bien que le langage verbal ou gestuel. En effet, l’image photographique ou en mouvement a, pour le sociologue, valeur de document indexé sur une réalité donnée et non de pure icône ou de symbole, il convient donc de réfuter l’idée que les images parlent d’elles-mêmes, comme le soutient l’esthétique toujours soucieuse de faire une bonne image plutôt qu’une image juste, voire de « faire image ».
Si l’on ajoute à ce constat que la sociologie visuelle ou filmique n’exclut pas le verbe (il ne s’agit en effet pas de s’en tenir à une écriture strictement pictographique et nous n’en sommes quand même plus à l’époque du cinéma muet) ni l’argumentation, la question n’est pas tant de savoir si un film vaut un livre, ni même de questionner le fait qu’une démonstration sociologique ou anthropologique se manifeste à travers une mise en récit (ce fut l’objet du tournant linguistique dans les sciences humaines dont on peut continuer à débattre mais qui outrepasse de loin le seul cas de la sociologie visuelle), mais de s’assurer que le désir de fiction ne l’emporte pas sur la volonté de comprendre. Il s’agit donc moins de « re-présenter » le monde – ce qui reste l’objectif du romancier ou du cinéaste – que de présenter des faits qui répondent à un questionnement sociologique du monde, mais là encore non pas comme un do-cument commenté (que l’on tende à la neutralité axiologique ou au contraire que l’on adopte un point de vue délibérément situé) – ce qu’est en tout état de cause un documentaire – mais comme un film so-ciologique dont les images répondent à la volonté de problématiser une situation et d’en dévoiler les enjeux, les mécanismes et les logiques sous-jacentes. Il ne s’agit donc pas d’ajouter une représentation sociologique du monde aux représentations de sens commun ou aux visions du monde artistique ou philosophique en cours mais précisément de saisir, dans un effort réflexif, ces représentations qui collent à notre saisie spontanée de la réalité pour les indexer à leurs modes et à leurs sphères de production respectives. Je dirai, à la limite, qu’un film sociologique doit être davantage une façon d’amener un questionnement qu’une démonstration – mais on pourrait dire cela de n’importe quelle enquête sociologique, et cela me va bien. Car là où la réalité romanesque ou cinématographique de-meure affaire de convention et de vraisemblance, la réalité du sociologue est celle que lui renvoient les questions qu’il pose au réel et dont la vérité demeure toujours immanente. En effet, pour moi, comme pour Becker, à qui j’ai emprunté cette idée, une théorie n’est pas tant une thèse qui demande à être démontrée ou validée qu’un outil qui permet d’interroger la réalité.
J’ajouterai encore que le recours à la forme ou au support filmique pour rendre compte d’une recherche et la rendre accessible au plus grand nombre au prétexte que le profane sera plus sensible à ce format qu’un épais traité savant – selon ce poncif qui veut qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours – ne me paraît pas de nature à justifier le film sociologique, mais tout juste le documentaire de vulgari-sation, au même titre ceci dit, qu’une conférence par rapport à un livre. Il y a certes des avantages didactiques à recourir au médium audiovisuel pour marquer durablement les esprits – au même titre qu’un tableau Powerpoint peut fixer l’attention des esprits dissipés dans le cours d’une conférence – et, tant qu’à faire, s’agissant de réaliser un film, autant que le réalisateur sache filmer et maîtrise l’art de la narration, mais si l’ambition est de mener une recherche sociologique par le biais de l’image plutôt que d’en rendre compte pour le plus grand nombre, la finalité à ne pas perdre de vue, si j’ose dire, reste toujours de faire comprendre la complexité des choses plutôt et si celle-ci est sacrifiée sur l’autel de la démocratisation du savoir, on aura fait de la mauvaise sociologie et de la mauvaise vulgarisation par la même occasion.
EB et AT: Un des arguments largement répandus pour plaider en faveur de la sociologie visuelle et filmique est celui de sa prétendue plus grande capacité à véhiculer l’émotion. C’est une idée que vous remettez en question dans votre livre. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
VDG: Concernant la place et le rôle de l’émotion en sociologie visuelle et filmique, je ne partage nullement l’idée communément répandue que l’image soit davantage vectrice d'émotion que les mots, ou que la plus-value de l’introduction de l’image en sociologie par rapport au logos tiendrait à cette revalorisation de l’affect dans la sphère scientifique sensément strictement rationnelle. C’est non seulement tout ignorer des ressorts de l’écriture, fut-elle scientifique, et ne rien comprendre à la littérature, mais c’est aussi nier naïvement que toute représentation du monde conjugue nécessairement « affect », « per-cept » et « concept ». L’émotion constitue certes un vecteur de connaissance et de prise de conscience des conditions de vie de nos semblables et je pense d’ailleurs qu’il n’est pas d’intelligence humaine qui ne soit sensible à ce qui nous affecte (si on ne ressent rien, on ne peut rien comprendre). En revanche, si la dimension scopique réhabilitée par la sociologie visuelle ouvre un champ de connaissance et propose des outils d’exploration du social dont le sociologue s’est trop longtemps privé, scotomisant ainsi son expérience de la vie et du monde social, cette même sociologie visuelle, et plus encore la sociologie filmique qui nous restitue non seulement la vision mais aussi les ambiances et surtout la parole, nous oblige sans doute à une plus grande vigilance critique et épistémique encore. C’est que les situations ainsi montrées dans leur réalité supposément naturelle et brute plutôt que décrites – ce qui suppose déjà un filtrage analytique dans cette manière de restituer les choses – posent, en effet, problème au mode d’intellection sociologique du monde, sauf à sauter le pas qui consiste à penser, qu’après tout, le rôle du sociologue consiste simplement à témoigner, comme le ferait un journaliste, et qu’il ne doit donc plus se préoccuper que de la véracité et de l’authenticité des faits collectés et montrés. Mais si l’on pense, ce qui est mon cas, que la sociologie visuelle doit permettre au programme sociologique de s’enrichir de l’apport des dimensions sensibles du réel et non se muer en une forme de reportage que pratiquent déjà nombre de documentaristes et de journalistes, il n’y a pas de raison que cette sociologie visuelle s’affranchisse de sa méthodologie propre et jette aux orties ses précautions qui la préservent d’être un simple commentaire social.
En d’autres termes, et très simplement, le danger qui guette toute investigation menée par le biais de l’image enregistrée tient précisément dans la faculté à pouvoir monter en généralité alors même que le médium audio-visuel s’attache naturellement à personnaliser ses sujets. Ainsi la faiblesse de Chronique d’un été tient-elle à mon sens au fait que, au bout du compte, alors que le film évoque quantité de sujets de société – le bonheur, le travail, les aspirations, la mémoire, la guerre, le racisme, le colonialisme, etc. –, on se retrouve avec une galerie de portraits tellement personnalisés qu’on ne les juge plus – et Morin en premier – que sur leur force de conviction à l’écran, soit en quelque sorte sur leur jeu d’acteur : ont-ils été « bons » et « vrais », alors que la force d’un film comme Nanook l’esquimau, non pas en dépit mais grâce aux « arrangements avec le réel » dans la mise en scène, l’attribution des rôles et son caractère en somme « cinématographique », qui va susciter là aussi la projection des spectateurs dans cette petite famille recomposée à l’écran, tient dans la mise en œuvre d’un processus indispensable de modélisation et de typification corrélatif à la possibilité non seulement de s’identifier à eux – ce qui est évidemment une nécessité purement cinématographique et non scientifique bien sûr – mais aussi à cette montée en généralité sans laquelle la sociologie se dissout dans le récit ou dans le document présenté. Ce n’est pas que le processus analytique du chercheur tient à une forme d’abstraction du réel mais à une problématisation du réel – un cadrage théorique et une conceptualisation du sujet – qui permet soit le passage du « percept » au « concept » plutôt qu’à l’« affect » – qui est, de toute façon, toujours déjà présent dans toute immersion ou confrontation avec des sujets réels. Tout reste une question de distanciation, de bonne distance à adopter afin de ne pas laisser l’émotion ressentie ou véhiculée prendre le pas sur l’analyse sociologique, ne pas laisser la nécessaire compréhension des motifs se transformer en connivence. Ne nous laissons pas abuser ou submerger par notre sujet et rappelons que si l’émotion demeure un argument commercial pour le succès d’un film, et peut-être une finalité cathartique du cinéma populaire, l’objectif du film sociologique conçu comme un film scienti-fique doit rester pour le chercheur la compréhension au sens wéberien du terme et non l’adhésion du spectateur qu’est évidemment toujours, par ailleurs, le cinéaste, premier spectateur et public de son film en train de se faire.
Ainsi est-il piquant de constater que les conventions et les règles de la méthode visuelle ayant cours depuis en ethnologie comme en sociologie auront précisément été inspirées par les errements mé-thodologiques ou les accommodements cinématographiques de ces deux films fondateurs qui auront, du reste, été présentés et plébiscités par un public non scientifique de cinéphiles (voire par le grand public pour Nanook) et projetés dans des salles et des festivals de cinéma alors qu’on est en droit de penser que le modèle du cinéma sociologique est peut-être plutôt à chercher du côté des Comizi d’amore de Pier Paolo Pasolini. Son Enquête sur la sexualité, sorti en 1964, produit à peu près sur le même principe de cinéma-vérité et sur le même registre du documentaire sociologique, a beau être davantage un film idéologiquement orienté, il a cet avantage déterminant sur Chronique d’un été d’être, à la fois, une leçon de cinéma et aussi une leçon de sociologie. Pier Paolo Pasolini est armé d’un questionnement politique peut-être sommaire mais autrement efficace que quelques idées vagues sur le bonheur à l’occasion d’un micro-trottoir improvisé, les états d’âme de quelques psychés torturées et des considérations politiques et économiques intempestives de tel ou tel acteur de terrain choisi on ne sait comment. Il a aussi une déontologie de journalisme d’investigation mais surtout, il part d’une vraie question sociologique construite – comment est vécue et représentée la sexualité dans une Italie clivée entre ville et campagne, nord industriel et sud rural, prolétaires, paysans et bourgeois, jeunes et vieux, et bien sûr garçons et filles, hommes et femmes –, et finalement les règles de la méthode sociologique y sont relativement bien respectées pour un réalisateur certes davantage cinéaste que sociologue : la construction du sujet y est irréprochable, l’enseignement du film est très clair grâce à un tournage méticuleusement préparé et un montage astucieux, grâce également au souci de réflexivité assurée à chaque étape du film par les réflexions acérées d’experts, mais surtout par le souci constant de Pasolini de solliciter, non pas l’émotion ni le pittoresque, mais bien la vérité sociologique de son sujet.
EB et AT: La question de la discipline est une autre question qui structure votre livre (Ce que regarder veut dire). Elle recouvre deux choses (au moins) : la question de la méthode et de la nécessité de se doter d’« un protocole de recherche scientifique fondé sur une épistémologie sociologique » (et ici on vous cite, p. 118) ; et la question de la communauté scientifique et de la validation par les pairs qui fait la science. Pouvez-vous revenir sur la place que tient cette dimension disciplinaire dans votre réflexion ?
VDG: La question qui est posée est celle du statut de la sociologie visuelle et filmique : est-ce une discipline, un paradigme ou un simple arsenal technique ? Il faut bien entendu inlassablement rappeler que la sociologie par l’image ne nous dispense ni ne nous libère de toute obligation de conceptualisation et de probléma-tisation toujours aussi cruciale en sociologie, qu’elle soit visuelle ou non, pour la construction d’un objet et l’identification d’une question de recherche, comme pour la conduite de cette investigation et sa restitution aux principaux intéressés comme à la communauté scientifique, et plus largement au grand public. C’est en ce sens, il est vrai, que j’ai plaidé pour que nos protocoles de recherche restent indexés sur une épistémologie sociologique. Et si j’ai insisté sur la nécessité de s’entendre sur ce que recouvre la pratique de la sociologie visuelle et si j’ai distingué entre un programme fort (la sociologie en image) et un pro-gramme faible (la sociologie de l’image), et qu’il nous manque toujours des « règles de la méthode » pour la sociologie visuelle – même si je pense personnellement qu’il est heureux qu’on n’ait toujours pas formalisé ces règles –, c’est que la sociologie continue à s’inventer, à s’éprouver et à s’expérimenter sur le terrain. Ne nous emballons pas et n’oublions pas que nous ne sommes toujours qu’une poignée de praticiens et d’enseignants adeptes de la sociologie visuelle, dans le monde francophone en tout cas, et que les toutes premières thèses produites sous forme de films sont toutes récentes et restent encore exceptionnelles. J’aurais donc tendance à penser, au vu de la profusion et de la diversité des acceptions et des usages sociologiques comme de ses dispositifs et protocoles de recherche, que la sociologie visuelle loin d’être encore « balbutiante » ou « tâtonnante », ne démérite pas de la sociologie théorique la plus rigoureuse tout en élargissant à la fois son spectre émotionnel et sensible, son registre expressif, sa dimension narrative et par la même occasion son public potentiel. Nous n’avons pas encore pour autant épuisé toutes les questions méthodologiques, exploré toutes les expérimentations possibles, ni réfléchi à toutes les possibilités narratives et discursives que nous offre le langage audiovisuel ou même verbal que les artistes, les cinéastes, les écrivains maîtrisent infiniment mieux que nous sans pour autant prétendre faire œuvre sociologique, bien sûr. Continuons donc à nous montrer imaginatifs et audacieux, à apprendre d’eux sans rien céder de notre rigueur et de nos exigences épistémologiques propres ni perdre le cap de nos intérêts et de nos questionnements scientifiques, quitte à nous tromper, à nous fourvoyer, à nous perdre tant que nous pouvons apprendre de nos erreurs, et patientons encore un peu avant de prétendre codifier, légiférer et promulguer des nouvelles règles et des protocoles définitifs. Quant à savoir si la sociologie visuelle consiste en un simple élargissement de notre arsenal technique, si elle inaugure un nouveau paradigme ou si elle s’apparente à une discipline spécifique, le débat ne fait que commencer au sein même de notre communauté scientifique et je n’aurai pas l’outrecuidance de trancher péremptoi-rement et prématurément.
EB et AT: Dans votre ouvrage Art et politique, pour une redéfinition de l’art engagé, vous parlez du rôle de l’artiste engagé qui tendrait vers une « réappropriation de la vie » (p. 24). Cette idée nous semble rejoindre un ensemble de concepts comme celui d’empowerment qui se trouvent au cœur de la sociologie participative ou encore de la recherche-action ou collaborative, auxquelles se rattache souvent la pratique de l’image en sciences sociales. Est-ce une dimension qui fonde votre usage des images en sociologie ?
VDG: La sociologie visuelle est en tout cas incontestablement parente et compatible avec l’ethnométhodologie et diverses pratiques d’enquête de terrain participatives. Ce qui est certain et qu’il faut reconnaître, c’est que lorsque les conditions de validité épistémologiques et méthodologiques sont respectées, que les enquêteurs sont eux-mêmes dotés de ce tact et de ce talent maïeutique particulier, la pratique de la sociologie visuelle recèle des qualités heuristiques indéniables en termes d’expression et d’interprétation d’affects, de percepts et de concepts liés à des expériences ancrées dans la vie sociale. C’est aussi ce qui fait que ces images, qu’elles soient prises par le chercheur ou par les interviewés eux-mêmes sur le mode de la « caméra indigène », sont moins des constats que des témoignages, moins des documents photographiques (comme pouvaient en produire Walker Evans, ou même Pierre Bourdieu) que des ins-truments heuristiques et maïeutiques. Bref, ces images constituent peut-être moins un corpus sociolo-gique (dont on a pu souligner du reste le caractère d’incomplétude) que des outils transactionnels de négociation de la parole. C’est-à-dire que ce sont essentiellement des catalyseurs ou des analyseurs institutionnels qui permettent aux enquêtés comme aux enquêteurs de définir ensemble les situations en même temps qu’ils en fournissent les clés d’interprétation et parfois d’action les enquêtés pouvant contester les analyses de l’enquêteur et l’enquête permettant de faire surgir autant les dissensus que les consensus. Et cela ne me semble pas négligeable même s’il serait illusoire de croire que ces dispositifs visuels pallient la dissymétrie de la situation d’enquête et mettent enquêteurs et enquêtés sur un pied d’égalité.
Une manière d’engager mes étudiants en sociologie à explorer les voies de la sociologie visuelle entendue ici comme une sociologie par et en images consiste à s’appuyer sur leur propre pratique et maîtrise des outils technologiques domestiques qu’ils utilisent eux-mêmes au quotidien pour photographier, filmer, faire du montage et finalement bricoler eux-mêmes des films sans attendre l’assistance de techniciens du cinéma ni viser une qualité cinématographique professionnelle. Le résultat peut sembler « amateur » au plan de la prise de son ou de la netteté des images et certains ne manqueront pas d’évoquer, abusivement il va sans dire, une « école belge » qui ne trahit en réalité que l’absence de moyens pédagogiques, techniques et financiers pour l’encadrement de ce cours optionnel et la formation de ces étudiants durant à peine un quadrimestre. Je peux néanmoins, et non sans fierté, montrer ces travaux de recherche et d’investigation sociologique qui reposent exclusivement sur les reportages photographiques ou filmiques réalisés et montés par mes étudiants sur des thèmes très divers allant des albums de photos de famille à la sociologie des espaces publics dans la ville comme à la plage en passant par des questions d’urbanisme, de typologie sociale, ou cette année encore de budgets-temps en images. Certains sont, depuis, passés à la réalisation et à la production professionnelles de film documentaires mais, même pour le tout-venant des étudiants qui choisissent de suivre, ce cours, conçu à la fois comme un ciné-club où ils peuvent se constituer une culture de la photo et du cinéma documentaire et de fiction et comme un séminaire de travaux pratiques, se frotter activement à la sociologie visuelle, leur ouvre des horizons et des perspectives inédites sur leur manière d’appréhender les mondes sociaux et de pratiquer le métier de sociologue.
VANDER GUCHT Daniel (1998), L’Art contemporain au miroir du musée, Bruxelles, La Lettre volée, « Essais ».
VANDER GUCHT Daniel (2004), Art et Politique. Pour une redéfinition de l’art engagé, Bruxelles, Labor, « Quartier libre ».
VANDER GUCHT Daniel (2005), La Jalousie débarbouillée. Éloge de l’incertitude amoureuse, Bruxelles, La Lettre volée.
VANDER GUCHT Daniel (2006), Ecce homo touristicus. Identité, culture et patrimoine à l’ère de la muséalisation du monde, Bruxelles, Labor, « Quartier libre ».
VANDER GUCHT Daniel (2014), L’Expérience politique de l’art. Retour sur l’engagement artistique, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
VANDER GUCHT Daniel (2017), Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions nouvelles.
Émilie Balteau, Alexandra Tilman, « Vous voyez ce que je veux dire. Entretien avec Daniel Vander Gucht », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 6 | 2022, mis en ligne le 6 juin 2022, consulté le . URL : https://rfmv.fr