

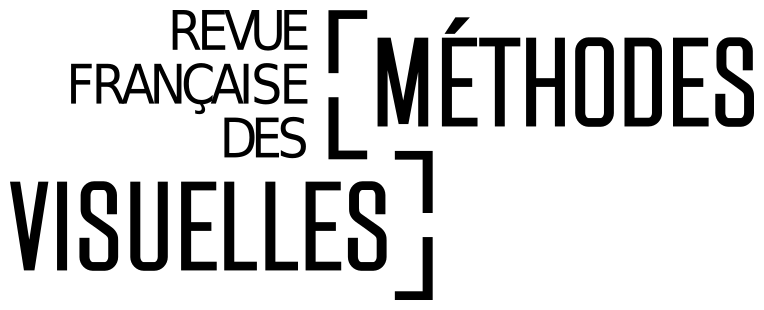
Alain Bouldoires, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université Bordeaux Montaigne, MICA
Notre propos consiste à discuter des outils de visualisation de l’activité savante et au-delà, du regard qui fait sens dans ce domaine. En explorant les techniques visuelles mises en œuvre par le monde scientifique, cette étude s’inscrit dans une écologie du savoir qui considère la culture savante dans sa matérialité, c’est-à-dire dans le milieu propre depuis lequel les acteurs agissent. L’évolution épistémologique des méthodes visuelles nous apprend ainsi à mieux comprendre le rapport des scientifiques au concept d’objectivité. Cette histoire n’est ni linéaire, ni simple. Elle a connu divers régimes de visualisation de la connaissance qui sont autant de témoignages de la relativité du regard scientifique.
Mots-clés : Image, Objectivité, Rationalité, Représentation, Histoire
Our purpose is to discuss the tools for visualizing scholarly activity and beyond, the gaze that makes sense in this area. By exploring the visual techniques implemented by the scientific world, this study is part of an ecology of knowledge that considers scholarly culture in its materiality, that is to say in the specific environment from which the actors act. The epistemological evolution of visual methods thus teaches us to better understand the relationship of scientists to the concept of objectivity. This story is neither linear nor simple. It has known various modes of visualization of knowledge which are as many testimonies of the relativity of the scientific gaze.
Keywords : Image, Objectivity, Rationality, Representation, History
De multiples exemples de ce que Françoise Waquet nomme l’« ordre matériel du savoir » (Waquet, 2015) témoignent de leurs succès dans la représentation des données : l’arbre botanique d’Augustin Augier (Essai d’une nouvelle classification des végétaux, 1801), tout comme le célèbre diagramme de Charles Darwin (L’origine des espèces, 1859) s’imposent comme moyens visuels efficaces. Depuis des siècles, une quantité considérable d’outils composites ont produit des images savantes. Textes, images et figures ont cohabité en se complétant. L’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, modèle révolutionnaire d’un savoir universel, en est un exemple remarquable : sur 28 volumes, 11 sont composés de recueils de planches. Pourtant, l’articulation entre image et discours n’est pas véritablement pensée dans ce monument encyclopédique. Il faut attendre Jacques Bertin pour que se déploie une sémiologie graphique qui donne toute sa place à l’image tout en travaillant la liaison texte-image : « le discours doit figurer en face de l’image : l’image sur une page, le discours sur la page vis-à-vis. […] Si le discours ne couvre pas toute la page, il faut laisser en blanc le bas de la page. […] encercler sur l’image les groupes que l’on cite et les désigner par une lettre. » (Bertin, 1977, p. 184-185).
Mais par-delà ces enjeux éditoriaux, c’est la légitimité des « organes artificiels » de la vision qui a fait longtemps débat. Jugé inapte à voir juste dans un premier temps, le télescope a montré son aptitude à dépasser les limites de l’œil humain. Galilée voulait convaincre ses détracteurs qu’il pouvait, non pas déformer, mais augmenter la puissance de la vue et donc notre capacité de perception. Cependant, les taches du soleil qu’il met en évidence ne s’inscrivent pas dans l’univers de pertinence de son époque. Autrement dit, face aux représentations pures et idéales de la croyance, ces images suscitent la controverse en dévoilant ce que l’on ne veut pas voir. Cet épisode marquant de l’histoire des sciences révèle la nécessité de contextualiser la construction du regard scientifique. C’est tout l’objet de cet article qui interroge les conditions de la production des images dans la construction du savoir au cours des siècles.
Avant Galilée, les Hommes cherchaient déjà à représenter les origines et les mécanismes du monde. Pendant des millénaires, ils ont inventé des images de l’univers. Entre cosmogonies et cosmologies, d’Inde, de Chine, de la Grèce antique ou du Moyen Âge juif, chrétien ou musulman, de multiples visions poétiques, mystiques et rationnelles se sont affirmées. Pour prendre un exemple, la Théogonie d’Hésiode, poète grec du VIIIe siècle avant J.-C., raconte la généalogie des dieux et la naissance du monde à partir du Chaos : « Racontez-moi cela, Muses qui habitez l’Olympe et remontant au commencement, dites-moi ce qui, de tout cela, fut dès les origines » (Hésiode, 1995), renvoyant à une représentation des éléments et de l’infini au sein de l’Univers : « La Terre est un globe occupant le centre d’une sphère formée au-dessus par le Ciel dont le sommet est rempli d’un éther, en dessous par le Chaos, sous lequel coule le Tartare » (Huyghe, 1999, p. 113). Ainsi, la Terre d’Hésiode serait un disque plat. Le monde vu par Platon semble bien différent : « Platon semble se représenter le monde avec une Atlantide submergée et un Océan entourant l’ensemble des terres en un seul continent » (Huyghe, 1999, p. 142). Le système d’Aristote « ajoute à la théorie des sphères d’Eudoxe les notions d’éther, d’impossibilité du vide, de sphères matérielles animées d’un mouvement giratoire, de Moteur immobile, etc. » (Huyghe, 1999, p. 166). La mécanique aristotélicienne est basée sur l’observation des phénomènes de surface : les tremblements de terre et les volcans, la circulation des eaux internes, les problèmes d’atterrissements et d’érosion, les fossiles et les mouvements de la mer ou du sol.
Saint-Augustin, pour sa part, s’oppose aux manichéens et dénonce ce qu’il qualifie d’imposture : « Mais qui demandait à ce Manès d’écrire sur des matières dont la connaissance n’est point nécessaire à la piété ? […] Aussi lorsqu’on le prenait à mentir au sujet du ciel et des étoiles, des mouvements du soleil, de la lune, bien que ces questions ne concernassent pas la doctrine religieuse, ses audaces n’en revêtaient pas moins un caractère sacrilège » (Saint-Augustin, 2008, p. 98-99). Leur science leur permet de « connaître l’ordre du monde, quoiqu’ils n’en aient point découvert le Maître » (Saint Augustin, 2008, p. 95). Entre unité divine et unité cosmique, c’est une véritable guerre des représentations qui se jouent alors. Fondées, le plus souvent, sur des considérations théologiques ou philosophiques, ces tentatives interrogent, au-delà du mystère de la création et de l’organisation du monde, la place de l’homme dans le cosmos. Très éloignées de nos conceptions actuelles, ces systèmes de pensée postulaient, le plus souvent, l’Homme au centre du monde.
Loin de ces considérations, Kircher publie, en 1665, Mundus subterraneus. Précurseur tout autant que Descartes, il s’intéresse à l’intérieur de la Terre : « La figure de la Terre s’inspire directement de celle du Soleil avec la même représentation des volcans en surface » (Deparis et Legros, 2000, p. 110).
Ainsi, l’absence de techniques modernes permettant de produire des images n’a pas empêché nombre de savants de vouloir représenter le mystère de la Terre et de ses entrailles ou de développer une vision générale du cosmos. La confrontation de ces conceptions avec le développement des techniques de visualisation permet de mesurer l’évolution des idées, l’affirmation de la rationalité et des différents régimes de représentation depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
L’émergence de la rationalité en Grèce antique nous renvoie à Platon et Aristote comme références philosophiques majeures. La raison grecque est, en effet, une étape capitale dans l’histoire de la pensée. Cependant, on ne peut ignorer un certain paradoxe : à savoir, la cohabitation de l’objectivité avec l’irrationnel. Dans ce contexte culturel, la magie intervient autant que l’exercice de la raison, le tout côtoyant l’universel. La présence du rite et des croyances qui l’induisent, met en œuvre une causalité qui n’a rien à voir avec le hasard. La philosophie vient combler peut-être une impossibilité de la pensée magico-religieuse à appliquer une lecture critique à ses propres présupposés. L’exploration des techniques d’argumentation, par exemple, confère un pouvoir de développement de la réflexion qu’elle soit philosophique ou politique. Juger avec sa raison revient à exercer l’art de la dialectique ou de la rhétorique en se déprenant sans cesse des usages convenus, c’est-à-dire de la doxa. Ce qui semble donc le mieux qualifier la rationalité, c’est la continuité opposée à l’immobilité de la norme. On pourrait dire que l’observateur optimise son objet en y décelant des cohérences, le cas échéant, il ne parviendrait qu’à restituer des banalités. Afin d’objectiver ses propres procédures, il doit avoir recours à des techniques, faire trace. Ce que nous disent les philosophes grecs, le sens de leurs énoncés, ce qu’ils peuvent dire se structure en une « raison graphique » (Goody, 1979) qui traduit la pensée intérieure en éléments extérieurs reproductibles, l’écriture. Ainsi, pour rejoindre le courant médiologique, tout moyen matériel de communication a des effets décisifs sur les contenus. Une simple liste implique un certain agencement, une certaine logique, un sens de lecture, une disposition spatiale. Selon Jack Goody, l’écriture fut l’instrument de domestication de la « pensée sauvage » (Goody, 1979). La différence essentielle qu’introduisent les « technologies intellectuelles » (Goody, 1979), se situe dans leur capacité à transmettre, dans le temps et dans l’espace, le scepticisme que l’on peut exercer ensuite que ce soit en privé ou en public. Si l’on perd la part d’immédiateté de la relation humaine en revanche, la forme écrite favorise l’entrée dans la logique du raisonnement, ordonné par des concepts mais aussi par sa capacité de produire des savoirs.
Cependant, l’écriture n’est pas le moyen exclusif du déploiement de la rationalité. Les pratiques de l’image peuvent tout aussi bien y concourir. L’outil ne détermine pas l’intention première mais contribue à l’organisation de sa diffusion. Son usage peut être au service de la connaissance ou de l’obscurantisme. Il convient donc de distinguer les différentes pratiques. Un des principes de la science est de faire de ses méthodes un problème. Avec la dialectique, Platon donne précisément l’ambition ultime des sciences. Toute la question est de savoir comment. Comment atteindre le connaissable ? Comment parvenir jusqu’au réel ? Par le discours intelligible ou par la simulation des images ? En réalité, ces moyens sont complémentaires et contribuent au fondement de la rationalité. Pour le scientifique, au fond, ce qui est à savoir et ce qui est à faire se rejoignent en une même volonté. L’ordre pratique, souvent indéterminé, contraint la raison à exercer son art avec plus de rigueur. La rationalité technique (écrite ou visuelle) n’est pas nécessairement imitatrice. Son œuvre est jalonnée de choix aux horizons multiples pour atteindre une fin, sans que le sensible soit nécessairement en discordance avec elle. On ne saurait donc affirmer que la rationalité pratique s’oppose à l’analyse mais bien au contraire, en constitue un des éléments fondamentaux. Elle ne peut être optimale sans l’instrumentation.
L’ordre technique est parfois perçu comme portant un risque de restriction ou d’appauvrissement. Or, une rationalité immatérielle serait une rationalité anarchique sans principes ou, au contraire, trop normative. L’instrument favorise la cohérence de la pensée aux prises avec des valeurs et des finalités. Il n’est donc pas souhaitable de dissocier deux ordres de rationalité mais bien au contraire de leur attribuer une nature commune. La recherche empirique nous rappelle qu’il ne peut y avoir d’action scientifique sans règles cohérentes. Le fameux adage « la fin justifie les moyens » appliqué à la science serait un fourvoiement injustifiable de ses principes. La rationalité des fins va donc de pair avec la rationalité des moyens. La recherche des résultats immédiats par tous les moyens est absolument inacceptable. Il en résulte que les conditions temporelles de la rationalité semblent déterminantes.
Philosophie, science et technique ont en commun une rationalité effective devenue une norme implicite. Mais, perdant sa spontanéité et sa capacité d’innovation, elle se dégrade lorsqu’elle prend corps et fait tradition. La pérennisation au prix de la perte du sens critique, aux dépens de ceux qui l’incarnent et des œuvres qui la portent est un écueil dévastateur. La vitalité de la rationalité se trouve bien dans l’exercice du sens critique qui met à l’épreuve les croyances.
Lorsque la rationalité s’exerce sur un objet, on parlera d’une exigence d’objectivité, à distinguer de la voie de l’opinion, car elle institue et maintient le doute en éveil. La pensée s’approprie l’objet en quelque sorte, jusqu’à l’épuisement de la raison. La conduite d’une réflexion rationnelle consiste en des choix de questions selon des fins qui ne se définissent pas comme exhaustives mais optimales. Il faut en effet bien dissocier ces deux ambitions : l’une est utopique, l’autre est impérative. Épuiser l’objet revient à optimiser sa quête selon des formes différentes. L’écriture graphique ou visuelle s’efforce alors de traiter les données dans toute leur diversité en tentant de dégager des types d’entités ou de processus.
Ce qu’une discipline donne à voir à travers une représentation visuelle lui confère, en quelque sorte, son « originalité épistémologique ». C’est le cas de l’usage de la carte en géographie selon Hervé Regnauld : « La géographie mobilise des objets graphiques qui ne sont pas tous exprimables par des mots. Elle construit sinon des théories du moins des modèles théoriques partiels qui mobilisent du “vu” et du “manque de vu” » (Regnauld, 2015, p. 11). Cartographier notre monde dans ses moindres détails fut l’une des obsessions des Hommes. Ces productions témoignent de l’évolution du regard. Un magnifique album l’illustre bien avec l’exemple des Alpes (L’Alpe, n° 7, printemps 2000). On y trouve des gravures allégoriques (figurant le massif montagneux alpin comme une île ou les montagnes comme des toits pointus), des topoguides militaires ou tout simplement pour les randonneurs. C’est au début du XIXe siècle que le statut de la cartographie prend un nouvel essor : « Humboldt quant à lui cartographie des isothermes, objets qui matériellement n’existent […] mais qui sont conceptuellement indispensables pour expliquer un fait visible […] » (Regnauld, 2015, p. 4). Tout comme le langage conceptuel ou les équations, le tracé, les croquis peuvent exprimer une théorie : « Dire qu’une théorie peut s’exprimer et se transmettre sans mots (en dehors des seuls concepts), c’est dire que les débats sur la logique des types de discours et les tentatives de réduction du langage scientifique à une logique univoque ne sont pas les éléments les plus fondamentaux de l’épistémologie actuelle. Dire qu’une théorie peut s’exprimer par des graphismes, c’est affirmer qu’à la logique numérique, à la logique linguistique doit s’ajouter une forme de logique graphique. La science devient donc infiniment plus complexe et, surtout, plus difficile à réduire à des procédures archétypiques rassemblées dans une épistémologie surplombante, commune à toutes les sciences et de ce fait normative » (Regnauld, 2015, p. 10). Pour l’auteur, c’est l’une des raisons qui peut expliquer que les philosophes ignorent la géographie. Les cartes, courbes ou autres graphes se veulent scientifiques avant tout : c’est une pensée qui se dessine sur le papier ou l’écran, à la genèse même de la recherche, dans un langage qui se donne à voir. Françoise Vergneault-Belmont, cartographe de formation, est parvenue à « remonter la pente, avec patience et détermination tranquille, pour [se] retrouver aux côtés du chercheur, à l‘amont de sa démarche, au moment où il met à plat ses données et trace les premières lignes de sa problématique » (Vergneault-Belmont, 1998, p. 14). La carte ou le graphique sont communément rencontrés dans le but d’illustrer un propos ou une question. Mais, par-delà cette pratique réductrice, la cartographie dynamique (ou cartographie expérimentale) s’inscrit, selon Françoise Vergneault-Belmont, dans un parcours de recherche, une procédure d’énonciation et d’expérimentation à part entière qui n’a rien de statique ou d’isolée. Dans cette perspective, la voie graphique est bien une activité langagière de conception.
Mais définir ce qu’est une carte aujourd’hui n’a rien d’évident. Avec l’arrivée du GPS, elle n’est plus le signe distinctif de la science géographique, elle est devenue un outil de localisation plus qu’un outil d’analyse. Perplexe, Jean-Paul Bord pointe le risque d’une pensée spatiale affaiblie par manque de réflexion (Bord, 2012). Pour cet auteur, une « vraie » carte rend accessible une pensée de l’espace. Face à cette conception, Google Maps et Google Earth, notamment, dominent l’information mondiale en proposant une cartographie de l’ensemble du globe. Cette domination capitaliste du monde par la carte est d’autant plus inquiétante qu’elle est systématique. Elle traduit pour le moins, un état du monde où la géolocalisation à une place de choix mais provoque une perte de sens.
Le lien entre vision et intelligibilité répond à la nécessité de faire voir ce que l’on ne peut pas voir habituellement. Les tableaux chiffrés, les diagrammes ont contribué à la figuration des données dès le XVIIe siècle. Le géographe Gilles Palsky (Palsky, 2003), rappelle que cette tradition s’accompagne d’une réflexion théorique de personnalités comme Emmanuel de Martonne ou Maximilian Eckert. Les tableaux statistiques « n’accordent pas d’autonomie véritable à l’observation » (Relieu, 1999, p. 49), il s’agit de dispositifs de représentation. Au-delà de la justesse et de l’exhaustivité, c’est la lisibilité et la pertinence qui sont recherchées pour que ces données ne deviennent pas trop abstraites. La sémiologie graphique s’attelle alors à l’élaboration d’une grammaire graphique appuyée par des expérimentations et qui vont se traduire par une succession d’innovations graphiques. Aujourd’hui, l’infographie, la datavisualisation parviennent à rendre intelligible les statistiques les plus complexes.
Autre exemple de l’usage scientifique des techniques de visualisation, les préhistoriens ont tenté, pour leur part, de rendre visible l’Homme préhistorique par des images à partir de restes fossilisés. Une construction d’images qui fait parfois appel à l’imaginaire pour proposer un reflet de la réalité. Ce paradoxe, sans doute problématique, permet de confronter les diverses hypothèses même si ces représentations ne sont pas sans drainer quelques stéréotypes dont il convient de se méfier. La « déconstruction » de ces travaux reste une nécessité pour ne pas risquer des interprétations subjectives car la connaissance des origines de l’humanité fait appel à une reconstitution de cet inconnu qui est notre ancêtre commun. Mais nous savons aussi l’importance, dans le lien entre les études savantes et les images qui les illustrent, des contextes socioculturel, historique et politique qui conditionnent trop souvent la création et l’interprétation. Les représentations peuvent jouer un rôle essentiel dans le débat scientifique mais le « pouvoir des images » n’est pas sans danger lorsqu’il sert d’autres causes que la science. Parfois, une idéologie, un dogme ou une philosophie peut influencer la manière de percevoir nos origines (n’oublions pas l’opposition encore très vive aux États-Unis entre créationnisme et évolutionnisme). Le Néandertal que l’on représentait au début du XXe siècle ou celui des années 50 est très différent des productions des années 2000. La reconstitution du pithécanthrope (l’homme-singe) présentée à l’Exposition universelle de Paris, en 1900, est alors considérée comme le « chaînon manquant ». Au nom de la vulgarisation, elle est destinée aux spectateurs de l’événement, plus à même d’apprécier une sculpture plutôt qu’un tas de fossiles, même si elle ne fut « imaginée » qu’à partir d’un fémur et d’une calotte crânienne.
Depuis, iconiser l’Homme-fossile en chair et en poils semble être devenu une nécessité. Et, en effet, une figure fait plus qu’une description pour répandre une connaissance même si les biais d’interprétation existent. Ainsi, il apparaît que les illustrations « jouent un rôle essentiel dans l’élaboration d’arguments anthropologiques » (Ducros, 2000).
À partir de ces deux exemples de la cartographie et de la représentation de l’Homme préhistorique, il nous semble opportun de prendre un peu de recul pour tenter de situer cet « œil qui pense ». Les images des sciences et des sciences humaines et sociales forment, au fil du temps, ce que l’on pourrait appeler l’« œil scientifique » mais qui est aussi celui d’une époque qui a laissé son empreinte dans les pratiques scientifiques. La fabrication concrète des images témoigne d’un remaniement constant de la manière de penser et de l’évolution des idées. Dans l’éternel duel entre les « anciens » et les « modernes », se jouent aussi des oppositions de pratiques de visualisation. Dans cette perspective, Steven Shapin nous invite à pratiquer une historisisation et une contextualisation du savoir scientifique : « Je tiens pour établi que la science est une activité sociale, historiquement située, et qu’elle doit être comprise en relation avec les contextes dans lesquels elle apparaît » (Shapin, 1998, p. 20). Autrement dit, la manière d’obtenir la connaissance est tout aussi importante que la connaissance elle-même si l’on veut comprendre les processus sociaux qui produisent l’activité scientifique.
L’histoire, la philosophie et la sociologie des sciences nous invitent à penser les images scientifiques mais surtout, nous révèlent que les images ont toujours été mobilisées par les communautés scientifiques. Leur prétendue iconophobie opposerait le « vrai » aux visions erronées véhiculées par les images. Le lieu commun d’un divorce entre l’image et la science est tenace. Mais de nombreux exemples témoignent des multiples usages fructueux qui en ont été faits. Le savoir a souvent eu besoin de voir pour comprendre. Croquis, gravures, photographies, radiologies ont jalonné la recherche dites « empirique » sous divers statuts : outil, preuve, concept, vulgarisation… D’abord dans une démarche de compilation pour des inventaires à visée exhaustives, les pratiques ont évolué autour du concept d’objectivité. Lorraine Daston et Peter Galison ont proposé une histoire de l’objectivité en se basant sur des livres d’images scientifiques appelés « atlas » au XVIIIe siècle. Les « savants » y donnent à voir les connaissances accumulées grâce à l’observation de la nature. En effet, Les atlas jouent un rôle central dans le développement de la recherche empirique. Pour Daston et Galison, « Sans atlas, celui qui aurait voulu étudier la nature n’aurait pas pu faire autrement que de repartir de zéro et de réapprendre à voir, à sélectionner et à classer » (Daston et Galison, 2007, p. 33). Les auteurs ajoutent que « la fonction de telles images n’était pas seulement décorative, loin de là. Elles ont permis à un empirisme collectif de voir le jour dans les sciences » (Daston et Galison, 2007, p. 33). Outil d’identification, de classification, de démonstration et de découverte, l’image naturaliste contribue à faire progresser la connaissance : d’un atlas à l’autre, les scientifiques complètent, affinent et corrigent leurs objets d’études. « Outre leur principale fonction – normaliser la forme visuelle de certains objets –, les images d’atlas remplissaient d’autres rôles pour les sciences de la nature. Elles œuvraient à la diffusion publique des données auprès de la communauté scientifique, en préservant ce qui était éphémère et en diffusant ce qui était rare ou inaccessible » (Daston et Galison, 2007, p. 80).
Toute approche historique doit nécessairement opérer une sélection. Loin de toute généralisation et sans prétendre à l’exhaustivité, nous souhaitons nous référer aux pratiques concrètes de « mécanisation » de la connaissance comme autant d’invitations à la nuance. Nous entendons être attentif à la mise en place des techniques de fabrication du regard scientifique et au développement des méthodes. Cette démarche revendique une sensibilité à la fabrication des images qui accompagnent la construction de la connaissance scientifique et constituent une ressource pour penser les évolutions. Ainsi, nous reprenons les différents régimes de représentation analysés pas Daston et Galison qui vont articuler notre présentation :
- La vérité d’après nature : « illustre le caractéristique, l’essentiel, l’universel et le typique » (Daston et Galison, 2007, p. 28). Pour notre part, nous parlerons d’image raisonnée ou d’image-outil.
Image 4 - Gravure d’un dessin de Charles-Alexandre Lesueur.
© François Peron et Louis Freycinet, Voyage de découverte aux Terres australes, Imprimerie impériale, Paris, 1807-1816, Bibliothèque Nationale de France.
LégendeCes « casoars de l’Île Kangourou » sont en fait des émeus. Les images d’atlas pouvaient témoigner de l’existence d’espèces exotiques inconnues et, en tant que telles, servaient d’objets de travail. Sur cette gravure sur cuivre d’un dessin de l’illustrateur Charles-Alexandre Lesueur, effectué lors d’un voyage en terres australes en 1800, sont représentés le mâle, la femelle adulte et les petits. À partir de l’observation de plusieurs animaux, les artistes-naturalistes ont voulu représenter l’espèce.
- L’objectivité mécanique : « Ce type d’image tente de saisir la nature en réduisant au maximum toute forme d’intervention humaine » (Daston et Galison, 2007, p. 28). Nous qualifierons cette catégorie d’image mécanique ou d’image preuve.
- Le jugement exercé : image « réalisée par association d’un rendu objectif et d’un lissage ‘subjectif’des données » (Daston et Galison, 2007, p. 28). Nous adopterons les termes d’image interprétée ou d’image-concept.
Image 6 - A. de Montméja, « Syphilide vésiculeuse », 1868.
© Clinique photographique de l’hôpital Saint-Louis, Paris, Librairie Chamerot et Lauwereyns, 1868, Musée de l’Hôpital Saint-Louis.
LégendePour compléter les travaux des médecins dermatologues, A. de Montméja isole les parties du corps humain qui présentent des maladies de la peau. Les lésions cutanées ont ensuite été soulignées en couleur (points rouges) pour permettre une lecture plus facile des symptômes.
Les innovations et transformations refaçonnèrent les images scientifiques qui ont en commun d’être des tentatives de représentation c’est-à-dire des présentations de ce qui existe déjà. Les premiers atlas visaient ainsi une certaine fidélité à la nature. Cependant, ces images ne représentent pas le réel à un instant T ; elles sont le produit d’une argumentation à la charnière de la théorie et de l’expérience. Elles cultivent l’œil de la discipline c’est-à-dire qu’elles contribuent à définir les objets de travail scientifiques.
Au XVIIIe siècle, avant l’image preuve, la science a façonné des images raisonnées c’est-à-dire consacrées à la « vérité d’après nature » (Daston et Galison, 2007). Cette attitude épistémique consiste notamment à élaborer des typologies, à diviser en classes et sous-classes afin d’extraire l’essence des espèces. La figure d’une plante représente une espèce entière. Elle est là pour pallier une inquiétude épistémologique : la variabilité de la nature dans toute sa singularité accidentelle submerge les sens et l’intellect humain. Pour le savant du XVIIIe siècle, la raison est universelle, tout comme la nature.
Rendre visible l’observation n’allait pas sans poser la question de l’interprétation car dans les faits, les pratiques d’uniformisation pouvaient traduire ce qui apparaissait comme archétypique, idéal, caractéristique ou moyen. C’est pourquoi « les observations menées dans le cadre de la recherche du typique devaient toujours être menées en séries, car les observations effectuées isolément par un seul individu pouvaient être extrêmement trompeuses » (Daston et Galison, 2007, p. 88). Autrement dit, le risque d’idéalisation n’était pas ignoré. La conception « naturaliste », art mimétique, s’opposait ainsi à la représentation « en imagination », basée sur l’élégance et l’harmonie de l’objet. La figure réalisée d’après nature montrait un résumé de ce que l’on pouvait voir dans plusieurs objets, en une seule vue.
L’illustrateur se charge de dessiner, graver et colorier les observations scientifiques. Cet exercice devait rendre compte précisément des attentes du chercheur, coller à ses exigences et suivre les multiples corrections qu’il ne manquait pas d’annoter sur les études préparatoires. L’illustrateur devait se conformer aux normes exigeantes de l’image raisonnée. L’anatomiste Albinus explique ainsi son choix pour un squelette humain conforme : « Mon choix s’est porté sur un squelette qui présente des signes à la fois de force et d’agilité ; qui dans l’ensemble est élégant, mais non trop délicat […], toutes ses parties sont belles et agréables à l’œil. Car comme je voulais représenter un exemple de la nature, j’ai choisi d’en retenir la plus belle image » (cité par Daston et Galison, 2007, p. 91). Dessiner d’après nature signifie, non pas de retranscrire à l’identique ce qui est vu, mais de forger un modèle typique épuré de ses imperfections ou de ses particularismes. Ces images sont donc constituées de différentes strates, artifices et conventions qui s’arrangent avec la réalité pour obtenir un modèle typique, « Voir – et surtout dessiner – était tout à la fois un acte d’appréciation esthétique, de sélection et d’accentuation. Ces images étaient créées pour servir un idéal de vérité – et souvent aussi de beauté – et non un idéal d’objectivité, qui n’existait pas encore » (Daston et Galison, 2007, p. 130).
Image 8 - Anatomie du corps entier, vue postérieure, eau-forte parue dans les Tabulae sceleti et musculorum corporis humani de Bernhard Siegfried Albinus (1747).
© Bernhard Siegfried Albinus, Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, J. et H. Verbeek, Leyden, 1747, table 8, Bibliothèque de Genève.
LégendeAlbinus voulait restituer « la meilleure image de la nature » qu’on puisse donner. Cela justifiait l’ajout d’ornements, autorisés pour servir l’esthétique des planches. Ce squelette idéalisé avec rhinocéros donne une idée de cette pratique d’embellissement par un animal à valeur exotique et rare.
Le naturaliste n’hésite pas à intervenir auprès des artistes pour les convaincre de réaliser des figures les plus exactes possible, y compris grâce à l’utilisation de la camera obscura. Toujours dans cette même logique de recherche de la perfection, d’autres procédés de fabrication d’images existaient comme l’impression mécanique où « la nature s’imprimant elle-même » (procédé d’impression mécanique). Cependant, certaines images, dites « caractéristiques », soulignent des spécificités et peuvent être considérées comme hybrides. Elles nécessitent l’adoption de nouveaux modèles de représentation tout en conservant le caractère idéal.
Entre l’artiste et le naturaliste, les relations fluctuaient de la sympathie à la servilité. Instrument du scientifique, l’artiste devait le plus souvent se soumettre à sa volonté. Pour lui, il n’était pas question de « voir » mais de « voir comme », à savoir produire une image raisonnée. Cette vision à quatre yeux, ce tandem improbable est plus complexe qu’il n’en a l’air : il est le fruit d’une juxtaposition de la raison et de la sensibilité. Chacune des images raisonnées contient le processus de fabrication du soi scientifique. Voir, c’est être pour représenter.
Plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la suppression de soi dans la fabrication des images était devenue la nouvelle vertu de l’objectivité scientifique, celle-ci étant comprise comme une réalité en soi. Les dictionnaires commencèrent à distinguer le sujet et l’objet, c’est-à-dire l’individuel et tout ce qui est indépendant de la connaissance. Un nouveau type d’intellectuel vit ainsi le jour dans cette période. Intégré dans la haute société, le scientifique fréquente désormais les salons aussi bien que les laboratoires. Afin de combattre les tentations d’un « soi scientifique », les pratiques étaient imprégnées de morale. Celle-ci échappait au contrôle du sujet, ce dernier n’étant pas le maître de son imagination,. La volonté n’y suffisait pas. Il fallait convoquer la raison et le jugement pour dompter les sensations. Un ensemble d’observations de faits particuliers capricieux étaient synthétisés en un fait général comme, par exemple, le type d’une espèce botanique. Dans cette vision, les « idées », pourrait-on dire, étaient contenues dans les images.
Fabriquer des images « améliorées » commence à poser des questions au XIXe siècle. Une autre époque s’ouvre, il s’agit désormais de se prémunir de toute vision subjective grâce à des procédés automatiques (microscope, télescope, appareil photographique) et en suivant un protocole strict. C’est notamment le cas avec l’invention de la photographie, événement anthropologique majeur : les choses du monde deviennent visibles « telles qu’elles sont », dans un rapport de similitude d’une représentation analogique.
Voir clairement, dans la perspective de « l’objectivité mécanique », visait à laisser parler la nature en réduisant l’observateur au silence. Ce nouveau modèle épistémologique induit une autre fabrication d’images, « On entend par objectivité mécanique le désir impérieux de réprimer toute intervention volontaire de l’artiste-auteur en mettant en place des méthodes capables d’imprimer la nature sur la page suivant un protocole strict, voire automatique » (Daston et Galison, 2007, p. 144). Pour mettre un frein aux interprétations fantaisistes, le scientifique avait recours à un usage procédural de la lithographie, de la chambre claire ou de la photomicrographie. Dès le départ, la photographie scientifique participa de cette volonté de produire des images mais aussi d’explorer les propriétés de la lumière. On espérait ainsi que la photographie permettrait de donner quantité de détails que ne permettaient pas de rendre la gravure ou la lithographie. D’abord conçue comme un substitut au dessin et à la gravure, elle épargnait le travail de détails de l’artiste. Mais, pour Baudelaire, l’artiste « doit être réellement fidèle à sa propre nature » (Baudelaire, 1962). « Copier la nature », c’était renoncer à la valeur artistique de la photographie mais aussi à l’essence même de l’art, à savoir l’imagination et l’individualité. Ces divergences s’affirmaient, par exemple, par le refus de la photographie mécanique, de procéder à des retouches. Ainsi, les scientifiques se mettaient eux-mêmes au pas, s’appuyant sur l’exemple d’un instrument plus performant incarnant un nouvel idéal d’observation. Les artistes, eux, valorisaient l’intervention interprétative. Chez le scientifique, on était fier de la justesse des images de la camera obscura qui éliminait toute idéalisation. La photomicrographie soulignait les écarts entre les détails présents dans la nature et les formes idéales, symétriques, régulières, parfaites des observateurs de l’image raisonnée. Avec l’appareil photo, pas question d’améliorer les contours. On s’empare d’un spécimen individuel avec ses défauts que l’on s’abstient d’idéaliser. Le scientifique savait que ces défauts étaient des artefacts qui devaient, eux aussi, être observés. Tous aspiraient à une objectivité exigeante sans rien omettre et sans retouche. Les procédures concrètes de l’image mécanique permettaient de voir des résultats sur une base objective et d’écarter l’erreur de la subjectivité. Cette morale de l’autocontrainte visait à se dispenser de toute interprétation au profit d’une juste représentation de la nature, abandonnant la quête du typique.
Image 9 - Ferdinand Quenisset (1872-1951), Arborescences de la gelée sur une vitre, 23 décembre 1906.
© Fonds Camille Flammarion - Société astronomique de France.
Légende« On sait que pendant les grand-froids lorsque l’humidité de l’intérieur d’une chambre non chauffée arrive à se déposer sur les vitres, elle s’y congèle en prenant les formes les plus capricieuses. Tout le monde a pu admirer presque chaque hiver ces magnifiques arborescences de la glace […]. Pour mieux faire ressortir ces fines et transparentes cristallisations, il faudra opérer de la façon suivante. On disposera derrière le carreau, en dehors de l’appartement, et à une certaine distance, une grande étoffe noire. On se placera alors dans l’intérieur de la chambre, et on photographiera, en opérant suffisamment de près, afin d’avoir une assez grande image. On obtiendra alors un phototype sur lequel les arborescences éclairées par une lumière latérale se détacheront nettement sur le fond sombre formé par l’étoffe noir extérieure » (Fernand Quenisset, Applications de la photographie à la physique et à la météorologie, Paris, Charles Mendel, p. 63-64).
Un retour sur le rapport à l’objectivité scientifique est nécessaire ici. Entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, le terme d’objectif connu un virage à 180 degrés : initialement concept ou représentation de l’esprit, il est ensuite défini comme une réalité en soi, indépendante de la connaissance. De cette évolution découle la distinction entre le sujet et l’objet, à savoir tout ce qui est sans lui. Progressivement, le scientifique apparaît ainsi comme un nouveau type d’intellectuel qui opère une distinction stricte entre vérité et beauté. On considère alors que l’esthétique des images ne porte aucune idée, elles sont.
Image 10 - Auguste. Bertsch, Charbon de bois de noisetier, photomicrographie, 1853-1857.
© Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
LégendeLéon Foucault (1819-1868), passionné de physique, offrit ses services de préparateur au cours de microscopie du professeur Alfred Donné. Il réalisa des daguerréotypes de l’infiniment petit grossis 400 fois.
Ainsi, l’image mécanique prétend désigner un ennemi : la subjectivité. Il s’agit moins de promouvoir l’enquête empirique que de supprimer la volonté, dans un idéal de raison commune. Pourtant, derrière l’illusion d’une réalité qu’elle donnerait à voir, la photographie n’est qu’une représentation, voire une fiction si elle n’est pas décodée dans sa temporalité.
À la fin du XIXe siècle, la vision aveugle de l’image mécanique, à savoir l’ambition de produire mécaniquement une image objective, est en crise. L’image preuve est devenue inadéquate notamment pour la saisie des relations, irréductibles aux procédures mécaniques. On assiste alors au rejet des images empiriques censées faire parler la nature. La photographie ne résolvait en rien le problème des apparences changeantes de l’objet que les procédures automatiques ne pouvaient saisir. Le réalisme était devenu l’ennemi du naturel, telle était la leçon de cette crise épistémologique. À ces interrogations s’ajoutaient d’autres questions : avec quelles exigences méthodologiques pouvait-on conduire les représentations photographiques de la réalité1 ? Comment considérer une représentation photographique historiquement et culturellement déterminée en tant que source scientifique2 ?
Contenir le multiple dans l’un par la reproduction mécanique apparaissait de plus en plus impossible à l’aube du XXe siècle. L’image mécanique était en crise. Progressivement, les scientifiques se tournèrent vers une image interprétée, c’est-à-dire qui nécessite l’intervention d’un œil interprétatif. La nature ne s’offre pas au regard ; pour la voir, il faut donc entraîner son regard. Le recours au jugement devint donc la nouvelle ambition pour voir scientifiquement : « À la vision à quatre yeux de la vérité d’après nature et à la vision aveugle de l’objectivité mécanique se substitua une sorte de vision physionomique » (Daston et Galison, 2007, p. 362). Il s’agit alors d’engager la capacité à synthétiser, souligner et mettre en relation, en complément de l’usage des instruments de prise de vue. Il n’est pas question, en effet, d’abandonner la production mécanique des images mais plutôt de considérer qu’elle ne se suffit pas à elle-même. L’avènement de l’image interprétée produira progressivement un changement de paradigme : on pouvait, dès lors, chercher à identifier des familles, apprendre à reconnaitre et à rassembler des groupes d’objets. Le livre scientifique est écrit afin d’aider le lecteur à exercer son œil, y compris en faisant appel à des critères subjectifs. Ce qui était l’exception au XIXe siècle, à savoir intégrer la subjectivité comme une composante essentielle du jugement scientifique, devient possible au nom de la recherche de l’exactitude. Au-delà des images, l’expert pouvait être maître de son diagnostic grâce à un œil exercé sans rejeter les instruments de vision. Dans un contexte d’omniprésence des images, l’écueil à éviter était de s’en remettre exclusivement à une vision aveugle ou à une quantification assistée par ordinateur. L’estimation de l’objet « à l’œil », l’établissement d’une première approximation était largement répandus Malgré une nette rupture dans le fondement de l’objectivité, il faut souligner une continuité dans l’utilisation des images. Contrairement aux classifications froides et impartiales du milieu du XIXe siècle, l’appel explicite à la subjectivité n’était plus un tabou : elle était même requise en tant que reconnaissance de l’expérience personnelle du scientifique car « identifier les frontières de la normalité exigeait une grande finesse de jugement et un long entraînement clinique » (Daston et Galison, 2007, p. 396). Les techniques visuelles devaient donc faire appel à la stratégie du jugement. Mais aux prises avec des observations parfois divergentes, que ce soit dans l’infiniment petit ou l’infiniment grand, les scientifiques devaient décider de la lecture de ces images construites du monde. Il ne s’agissait plus seulement de classifier l’image mais de la modifier : le regard actif et subjectif décidait de ce qui pouvait être pris pour réel.
Image 11 - Jules Janssen, Passage de Vénus devant le soleil, 1874.
© Musée Marey de Beaune.
Légende« Fac-similé d’une plaque photographique obtenue avec le revolver pour le passage de la planète Vénus sur le soleil, le 8 décembre 1874. » Jules Janssen.
« Sur chaque image de la plaque daguerréotype en forme de couronne – ici redessinée –, le petit disque de Vénus figuré en blanc se superpose au disque solaire figuré en noir » (Sicard, 1998, p. 154)
Pour Jules Janssen, « la photographie est la rétine du savant ». Faire confiance à l’information visuelle fournie par l’instrument n’interdisait pas pour autant les débats au XIXe siècle sur la trop grande fidélité de la photographie. Dans un contexte scientifique, les images photographiques seraient subordonnées à l’acquisition de savoirs, sortes d’auxiliaires visuels permettant de percevoir des phénomènes non accessibles à la vision naturelle. Le procédé consiste à partir de la photographie comme médium.
Ces manières de voir témoignent de l’avènement d’un nouveau régime de vision scientifique qui est le fait du développement d’un empirisme collectif. Le fossé qui sépare ce paradigme des précédents tient à la distinction entre l’objectif et le subjectif : le jugement est dorénavant personnel, quand il était universel depuis le XVIIIe siècle pour tous les jugements de raison. Toutes les déterminations individuelles interviennent ainsi dans la connaissance qui rassemble diverses théories et conjectures. Cette innovation épistémique refaçonna autant la science que les images scientifiques c’est-à-dire les tentatives de représentation.
Les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle ou d’électrophysiologie humaine, par exemple, sont des outils précieux qui permettent de voir le cerveau en action mais qui ne peuvent se passer des sciences cognitives en tant que théories et méthodes d’analyse. Ces images donnent, en particulier, une vue du fonctionnement de l’esprit grâce à une analyse des différentes fonctions de l’attention (orientation vers un objet, détection d’un objet et maintien de l’attention). Michael Posner et Marcus Raichle montrent le rapport entre certaines expériences subjectives et l’activation de zones du cerveau (Posner et Raichle, 1998). Ce champ du savoir recourt nécessairement au jugement afin d’interpréter les aires d’activation obtenues durant une expérience et visibles sur les images anatomiques du cerveau car la question essentielle reste de savoir quelles interprétations autorisent réellement les imageries cérébrales ? Cette réflexion très pointue sur la représentation et l’interprétation est abordée par les Annales d’histoire et de philosophie du vivant en 2000 dans un numéro sur « Le cerveau et les images ». Pour Philippe Gallois et Gérard Forzy, « les images cérébrales posent le problème de leur interprétation » et « les images mentales, quant à elles, posent le problème de la représentation » (Annales d’histoire et de philosophie du vivant, 2000, p. 16). Selon ces mêmes auteurs, ces images doivent être confrontées à l’expérience phénoménologique du corps propre car leur explication n’a rien d’évident.
Bien que s’étant constituées en tant que disciplines de l’écrit, les sciences humaines et sociales, elles aussi, ont questionné le rôle de l’image. Pour Margaret Mead et Gregory Bateson, la photographie ou le cinéma peut devenir un « microscope social ». Cependant, la part de mise en scène de la réalité sera rapidement appréhendée ainsi que les interactions nécessaires entre enquêteurs et enquêtés. Cet effet de latéralité fait toute l’originalité des méthodes visuelles. Le chercheur compose avec l’accidentel, les résistances ou l’imprévu. De plus, l’objet de la recherche n’est pas directement visible la plupart du temps. Il émerge du dialogue entre le chercheur et les participants car « les images ne parlent pas d’elles-mêmes, elles ne font sens que par rapport aux questions qu’elles veulent aider à clarifier » (Sorin, 1999, p. 14). Une description ethnographique en image peut effectivement construire des anachronismes et tromper le sens du regard. Il y a donc lieu de construire en image l’objet en tenant compte des représentations des enquêtés mais aussi en assumant la nécessité d’un récit et d’une forme. Nous n’ouvrirons pas plus loin les multiples débats que suscitent les pratiques de l’image et du son qui sont, par ailleurs, longuement discutées dans des revues scientifiques comme la Revue Française des Méthodes Visuelles qui leurs sont consacrées.
Si représenter consiste à présenter ce qui existe déjà, les nanotechnologies transforment en profondeur ce qui caractérise la fabrication d’images. Avec l’image hybride de simulation, de mimèsis et de manipulation, voir, c’est faire. Les images fonctionnent comme des outils pour fabriquer et modifier les objets. Les images numériques interactives peuvent être utilisées, transformées, coupées, corrélées, colorées… Cette véritable « nanomanipulation » confère aux images le statut d’outils. Les images tactiles autorisent la navigation dans l’image dans un ensemble de données virtuelles. L’image hybride a pour fonction de présenter plutôt que de représenter car la fonction de reproduction n’est plus centrale. Il s’agit d’un processus de création où l’objet, affranchi des régimes précédents, autorise le glissement artistique. Ce statut présentationnel des images manipulées perturbe le régime de représentation habituel3. L’image qui s’autoproduit relève plus de l’intervention que de la représentation. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Le scientifique ne se pose plus la question d’une image conforme à la nature ou d’une image vraie ou fausse. Leurs galeries d’images contiennent des images-outils sans présupposés théoriques. Ces dispositifs ne posent pas la question de savoir s’ils existent ou s’ils sont réels, ils constituent une approche présentationnelle du réel. Ils modifient considérablement la relation avec ce réel au point de se substituer à l’œil au profit des techniques de simulacre telle que la réalité augmentée ou l’image 3D au plus près de la réalité. Véritables pièges à regard, ces images éblouissent, fascinent voire sidèrent le spectateur. Le scientifique, quant à lui, en fait un outil puissant de révélation où le doute, voire l’erreur, ne sont plus permis. Pour François Dagognet, cette prétention à représenter le réel comporte une ambivalence certaine (Dagognet, 2009). L’image externalise et rend compréhensible le monde. Cependant cette mise à distance a ses limites : elle désincarne le monde d’une certaine manière, d’où l’importance de cultiver une éthique de ces représentations et une conscience de l’irreprésentable. Plus inattendu, la simulation visuelle rend également possible une construction qui laisse place à de nouvelles relations entre art et science, certes soumise à des contraintes mais ouverte à la dimension artistique et à l’exploration des frontières entre créativité et scientificité. Ce « merveilleux scientifique » (Canguilhem, 2004) est susceptible d’être exposé dans des galeries d’art ou des musées.
Aujourd’hui, de multiples instruments augmentent le regard de l’astrophysicien ou du chirurgien bien au-delà des limites humaines. Pour ce dernier, le maniement à distance de ces systèmes technologiques opératoires donne naissance à une main oculaire, une fusion inédite entre main et regard dans l’image. Le geste est assuré d’un coup d’œil en un instant et traduit l’acuité des sens. L’objectivité du regard scientifique est ainsi augmentée par l’outil qui prolonge la capacité physique au service du savoir. Dans un autre domaine, les techniques géophysiques modernes permettent de produire des images et des modélisations des couches profondes de la Terre à jamais inaccessibles. L’invisible est désormais à notre portée. Mais cette visibilité nouvelle rend-elle le monde plus intelligible pour le regard scientifique ? Le rapport entre notre instrumentation et notre compréhension semble pourtant toujours étroit au regard de l’ambition rationnelle du savant.
Cet article nous invite à prendre au sérieux les images scientifiques, d’en saisir l’importance et la valeur à la fois conceptuelle et singulière, voire transgressive. La fabrication des images « objectives » a été analysée comme une tentative de « domestication », voire de réification du processus de visualisation. Nous avons souligné le caractère évolutif et innovant des différents régimes de représentation qui ont fait progresser le débat scientifique. Nous pourrions dire, finalement, que les images s’inscrivent dans la science parce que la science s’inscrit dans les images. Mais ces dernières changent la nature de l’objet étudié, elles le « traduisent » (Latour, 2006) selon la conception de l’objectivité adoptée. Il n’y a donc pas de regard purement rationnel mais une négociation entre rationalité et subjectivité qui en constitue la valeur.
L’approche sous-jacente proposée est résolument constructiviste pour penser les émergences, les dynamiques et les reconfigurations du regard scientifique. Les techniques, mais aussi les acteurs, ne cessent de recomposer ou déplacer les manières de voir et donc de définir le geste scientifique. En abordant le rapport voir-savoir c’est-à-dire comment le regard scientifique se matérialise en images, c’est la nature de ce regard que nous avons interrogé en le contextualisant. Cette historisisation nous renvoie aux concepts d’objectivité mais aussi de rationalité, de subjectivité et de valeur.
Steven Shapin affirme que « la révolution scientifique n’a jamais existé » (Shapin, 1998, p. 11). Avec le microscope d’Anton Leeuwenhoek et bien d’autres innovations, le XVIIe siècle pourrait apparaitre comme la période d’émergence de la science moderne. Cependant, les évolutions que nous avons décrites confirment l’affirmation de Shapin : le développement d’une pratique de l’image raisonnée, le dépassement des limites de la perception ordinaire grâce au télescope et au microscope ne sont que des étapes d’une longue histoire du rapport entre voir et savoir.
Cette succession de transformations pose, au bout du compte, la question de l’unité des méthodes et des pratiques scientifiques. De l’image raisonnée à l’image hybride, en passant par l’image mécanique et l’image interprétée, nous avons essayé de comprendre cette sédimentation des images qui révèle des processus d’inscription à travers lesquels se négocie de la crédibilité. Les contemporains ont désormais à leur disposition une infinie variété de formes visuelles pour accompagner leurs investigations. De plus, avec le troisième millénaire, de nouvelles technologies suscitent des manières de voir inédites qui ouvrent des expérimentations méthodologiques originales.
1 Sur l’histoire du regard photographique, Emmanuel Garrigues a posé les premiers jalons en montrant toute sa spécificité dans L’écriture photographique : Essai de sociologie visuelle (Paris, L’Harmattan, 2000).
2 Ces questions ont longuement donné lieu à débats sur les usages ethnographique de la photographie depuis son invention, comme le souligne Jean-Noël Pelen et Gilbert Beaugé dans Photographie, ethnographie, histoire (Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie, n° 23-2-4, p. 14, 1995) : « Ne semble-t-il donc pas “naturel”, alors, que l'ethnologue “photographie”, et que ses clichés “illustrent” comme d'évidence les méandres de sa description, sans avoir à être légitimés par aucun commentaire spécifique sur la représentation, forcément d'un autre ordre, qu'ils donnent à voir ? ».
3 Signalons un dossier spécial consacré aux « images interactives et nouvelles écritures » et dirigé par les chercheurs de l’université Savoie Mont Blanc, Jacques Ibanes Bueno et Alba Marin. Il fait le point sur ces questions dans la Revue Française des Méthodes Visuelles, n° 5 (2020) : https://rfmv.fr/
Annales d’histoire et de philosophie du vivant (2000), « Le cerveau et les images », vol. III.
L’Alpe, « Cartographier la montagne », n°7, printemps 2000.
BAUDELAIRE Charles (1962), « Salon de 1859 », Curiosités esthétiques : L’Art romantique, et autres œuvres critiques, Paris, éd. Henri Lemaître, Garnier, p. 319.
BERTIN Jacques (1977), La graphique et le traitement graphique de l’information, Paris, Flammarion.
BORD Jean-Paul (2012), L’univers des cartes : la carte et le cartographe, Paris, Belin.
CANGUILHEM Denis (2004), Le merveilleux scientifique, Paris, Gallimard.
DAGOGNET François (2009), « L’imagerie médicale, une ambivalence certaine, quoique relative », Recherches en Psychanalyse, 8, [en ligne] https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse1-2009-2-page-170.html
DASTON Lorraine, GALISSON Peter (2012), Objectivité, Les presses du réel.
DEPARIS Vincent, LEGROS Hilaire (2000), Voyage à l’intérieur de la Terre : De la géographie antique à la géophysique moderne. Une histoire des idées, Paris, CNRS Éditions.
DUCROS Albert et Jacqueline (dir.) (2000), L’Homme préhistorique : images et imaginaires, Paris, L’Harmattan.
GARRIGUES Emmanuel (2000), L’écriture photographique : Essai de sociologie visuelle, Paris, L’Harmattan.
GOODY Jack (1979), La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit.
HESIODE (1995), Théogonie, Paris, Arléa.
HUYGHE Édith, HUYGHE François-Bernard (1999), Images du monde : Les mille et une façons de représenter l’Univers avant Galilée, Paris, Éditions Lattès.
IBANEZ BUENO Jacques, MARIN Alba (2021), « Images interactives et nouvelles écritures. Un mouvement émergent pour de nouvelles écritures interactives », Revue française des méthodes visuelles, 5, [en ligne] https://rfmv.fr.
LATOUR Bruno (2006), Sociologie de la traduction, Paris, Presses des Mines.
LEVI-STRAUSS Claude (1994), Saudades do Brasil, Paris, Plon.
PALSKY Gilles (2003), « Éléments pour une histoire de la sémiologie graphique avant Jacques Bertin (Elements for an history of cartosemiotics before Jacques Bertin) », in Bulletin de l'Association de géographes français, 80e année, 2 p. 183-194.
PELEN Jean-Noël, BEAUGE Gilbert (dir.) (1995), Photographie, ethnographie, histoire, Grenoble, Centre alpin et rhodanien d’ethnologie.
POSNER Michael, RAICHLE Marcus (1998), L’esprit en images, Paris, De Boeck.
REGNAULD Hervé (2015), « Introduction. L'image et la géographie : la progressive élaboration d'un nouveau régime épistémique », L'Information géographique, 4 (79), p. 8-12.
RELIEU Marc (1999), « Du tableau statistique à l'image audiovisuelle. Lieux et pratiques de la représentation en sciences sociales », in Réseaux, 17 (94), p. 49-86.
Saint-Augustin (2008), Les confessions, Paris, Flammarion.
SHAPIN Steven (1998), La révolution scientifique, Flammarion.
SICARD Monique (1998), La fabrique du regard, Paris, éditions Odile Jacob.
SORLIN Pierre (1999), « Présentation », in Réseaux, 17 (94), p. 9-16.
VIGNEAULT-BELMONT Françoise (1998), L’œil qui pense : Méthodes graphiques pour la recherche en sciences de l’homme, Paris, L’Harmattan.
WAQUET Françoise (2015), L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent. XVIe-XXIe siècles, Paris, CNRS Éditions.
Alain Bouldoires, « Voir-savoir. Ou les tribulations du regard scientifique », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 6 | 2022, mis en ligne le 6 juin 2022, consulté le . URL : https://rfmv.fr