

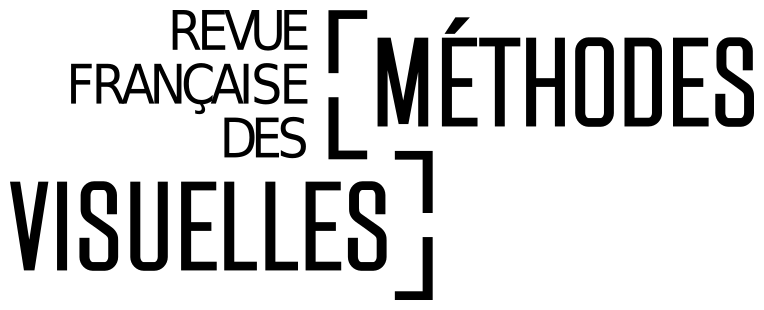
Constance Perrin-Joly, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Sorbonne Paris-Nord/IRIS, Chercheure associée au Centre français des études éthiopiennes (CNRS)
La co-construction des données dans les enquêtes en sociologie visuelle repose sur une multiplicité d’acteurs ou d’actrices. Cet article rend compte d’une réflexion à partir de la visite d’une exposition de photographies du travail réalisée par l’auteure auprès d’un public profane d’enfants de la bourgeoisie internationale éthiopienne. Il expose le dispositif pédagogique mis en œuvre, prenant appui sur l’expérience des enfants du travail scolaire. Cet exercice de mise en visibilité du travail fait cependant émerger des données nouvelles à partir de l’analyse de la réception des photographies par le public enfantin. Leurs réactions informent sur la perception du travail, horizon de projection construit au croisement de l’appartenance sociale, du contexte éthiopien (incertitude des parcours de vie), de l’expérience sociale des enfants comme de l’imaginaire que véhicule la photographie.
Mots-clés : Photographie, Invisibilisation, Travail, Sociologie visuelle, Éthiopie, Réception, Enfants
The co-construction of data in visual sociology relies on a multiplicity of actors. This article reports on a reflection based on a visit to an exhibition of photographs of work, carried out by the author with a lay public, Ethiopian children from the international bourgeoisie. It explains the pedagogical system implemented, based on the experience of the children of the schoolwork. However, this exercise of making the work visible brings out new data from the analysis of the reception of the photographs by the children. Their reactions inform the perception of the work, a projection horizon constructed at the crossroads of social belonging, the Ethiopian context (uncertainty of life courses), the children's social experience and the imaginary that photography conveys.
Keywords : Photography, Invisibility, Work, Visual sociology, Ethiopia, Reception, Children
La démarche de la sociologie visuelle rassemble trois types d’acteurs en interaction. Premièrement, celui·elle qui mène l’enquête : ce peut être le·a photographe comme une personne moins impliquée dans la prise de vue. C’est le cas lorsque le·a chercheur·euse utilise des images qu’il·elle n’a pas produites, comme Flora Bajard lorsqu’elle construit des portraits de céramistes d’art à partir des images qu’il·elle·s ont réalisées de leur travail (Bajard, 2016). Le·a deuxième acteur·trice est le sujet ou le·a modèle, ce (celui ou celle) qui est représenté sur la photographie. Certes, le sujet n’est pas toujours une personne, un objet ou un lieu peut renvoyer à un groupe de personnes qui l’utilise ou l’habite, c’est le cas par exemple des outils de travail qui constituent selon Charles Gadéa autant d’idiomes figuratifs des groupes professionnels (Gadea, 2015). Enfin, les images peuvent être montrées à un public. Même s’il arrive souvent qu’il n’y ait pas de public quand les photographies disparaissent des publications finales (Maresca, 2007), ce dernier peut, lui aussi, être multiple : une même photographie peut être utilisée dans une présentation orale lors d’un colloque (à destination des pairs) ou comme couverture d’un ouvrage (pour un public plus large voire à visée marketing).
Selon la méthodologie utilisée, ces rôles peuvent se superposer. La photo-elicitation invite des enquêté·e·s, directement ou indirectement objet des images, à parler à partir de photographies (Collier et Collier, 1986 ; Harper, 2002). Par exemple, Christian Papinot (Papinot, 2007) interroge les chauffeurs de taxi brousse en tant que représentants de leur groupe professionnel, à partir des photographies qu’il a lui-même prises de différents véhicules. Le professionnel peut plus généralement être considéré comme celui qui est sollicité au nom de sa connaissance, y compris subjective, du sujet, de son appartenance à un groupe directement concerné par l'enquête, comme par exemple les riverains d’un quartier enquêté (Guinchard, 2016). Si, dans la photo-elicitation, le sujet et le public sont confondus, la sociologie participative, elle, fait se superposer photographe et sujet.
Quelle que soit la démarche adoptée, la co-construction des données dans les enquêtes en sociologie visuelle repose sur une configuration particulière d’acteurs·trices. Nous proposons ici une configuration singulière où les collaborateurs·trices de l’enquête sont des enfants visitant une exposition. Cet article s’inscrit ainsi dans une réflexion non seulement sur la recherche collaborative en sociologie visuelle (Conord, 2017), mais aussi sur l’usage pédagogique de la photographie, d’autres travaux ayant pu souligner sa capacité à interroger la mise en visibilité de travailleurs invisibles aux yeux d’étudiants internationaux de milieu favorisé (Chauvin, 2017). Or, dans ces processus de co-construction, la démarche d’exposition1 a été moins interrogée. Exposer ses photos conduit non seulement à s’interroger sur la manière de les montrer au public, afin dans notre cas, de rendre visible l'activité sociale et économique « travail » auprès d’un public profane, mais prolonge aussi le processus d’enquête si l’on prête attention à la réception des photographies. Par profanes, nous désignons des individus sans expérience du sujet exposé. Ils·elles n’ont ni pris part au projet photographique, ni ne sont directement concerné·e·s par son thème. Cette définition profane ne se limite donc pas au non-professionnel (un malade a par exemple une connaissance du travail des professionnels du soin, il en a l’expérience (Baszanger, 1986 ; Strauss, 1992). Cette absence d’expérience directe n’empêche pas les profanes de mobiliser un savoir spécifique qui viendra en retour enrichir la démarche de recherche (Callon et al., 2014).
Cet article analyse le travail d’exposition de photographies et sa réception à partir de visites conduites par la photographe-chercheuse elle-même. Les visites s’adressaient à un public scolaire de fin de primaire dont la position sur le cycle de vie et l’expérience sociale nécessitent de rendre intelligible le discours sur le travail. L’article se concentre tout d’abord sur le dispositif pédagogique mis en œuvre. La deuxième partie montre que cette tentative de mise en visibilité du travail a fait émerger des données nouvelles tant sur les représentations du travail que sur le rapport à l’image à partir de la réception des photographies par les enfants éthiopiens de la bourgeoisie internationale.
Le travail photographique s’inscrit dans une enquête ethnographique sur l’engagement moral des entrepreneur·se·s s en Éthiopie, débutée en 2015 puis approfondie entre 2017 et 2021, période durant laquelle je m’installe à Addis-Abeba avec ma famille. L’enquête rassemble notamment une cinquantaine d’entretiens avec des entrepreneur·se·s étranger·e·s ou de la diaspora éthiopienne et des monographies d’entreprises. Ces dernières sont fondées sur plus de 80 entretiens avec les salarié·e·s et les bénéficiaires de dispositifs sociaux dans six entreprises, chacune de ces entreprises ayant fait l’objet de sessions de photographies de ses salarié·e·s au travail. Cette démarche m’a permis de photographier principalement un travail peu qualifié que ce soit dans des activités annexes de l’entreprise (comme l’entretien ou la manutention) ou au cœur de la production dans des usines, dans le secteur du textile, dans l’agro-industrie ou la floriculture, secteurs prioritaires dans les politiques industrielles du gouvernement. Les activités de contrôle, de planification et de direction dans les bureaux ont aussi fait l’objet de photographies, quoiqu’elles soient moins nombreuses.
Les femmes occupent une place privilégiée dans ma prise de vue car elles sont nombreuses dans les secteurs d’activités étudiés comme le textile ou la floriculture, et appréciées des employeurs car mieux acculturées à la discipline du travail industriel (sur la floriculture : Perrin-Joy, 2020). Les femmes acceptent aussi plus facilement les salaires réduits que proposent ces emplois subalternes, en particulier celles issues de zones rurales du fait de la précarité de leurs conditions de vie. Enfin, pour les plus jeunes et les plus qualifiées, l’emploi salarié peut parfois constituer un moyen d’acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de leur famille.
Le travail photographique a cependant dépassé le seul cadre des entreprises enquêtées. Les transformations rapides d’un pays en pleine industrialisation se prêtaient particulièrement à l’approche visuelle du fait des contrastes des activités de travail qu’elles donnaient à voir : un chantier de construction d’éoliennes considéré comme un projet d’avant-garde où cohabitent équipements modernes et outillage rudimentaire, parcs industriels modernes entourés par des activités agricoles plus traditionnelles, etc. Comme le secteur privé reste un employeur minoritaire de la population urbaine, le travail dans la rue a également été pris comme point de comparaison photographique des activités faiblement qualifiées2. Il regroupe à la fois des activités artisanales (jusqu’à 14 % de l’emploi urbain selon le Labor Force Survey de 2013), commerciales (par exemple la vente de fruits et légumes réalisée par des femmes [Bulty et Tulu, 2016 ; Legesse et al., 2016] ou de produits cuisinés [près d’un tiers de l’emploi urbain]) et une partie de ce que les statistiques nomment « occupations élémentaires » (21 %) regroupant notamment les activités d’entretien (cireur de chaussures…). Ces activités sont régies par une stricte division du travail, certaines étant uniquement exercées par des hommes (comme la cordonnerie, la couture…) alors que d’autres moins qualifiées, et moins rémunératrices (la vente de produits cuisinés, de fruits et de légumes [gullit], le service du café) sont le domaine réservé des femmes. Les photographies du travail dans la rue se sont concentrées dans deux zones du centre-ville d’Addis-Abeba, dans un quartier passant à proximité d’une artère centrale offrant de nombreuses occasions de prise de vue (artisanat textile, du cuir et cireurs de chaussure). La seconde zone, socialement plus mixte et plus résidentielle, donnait à voir les activités de vente de produits frais et cuisinés.
Toutes les personnes photographiées ont donné leur accord oral. Dans les entreprises, les photos ont été prises avec l’autorisation de la direction. L’accord du modèle était également donné mais davantage contraint par sa situation de subordination. Néanmoins, certain·e·s enquêté·e·s ont refusé la prise de vue, laissant à penser que le refus était possible sans considérer qu’il était facile à formuler.
Dans un contexte de surveillance et de délation (Perrin-Joly, 2020) qui caractérise le régime autoritaire mis en œuvre par le parti au pouvoir en Éthiopie, le fait même de signer un document perçu comme officiel crée au mieux la suspicion, au pire l’angoisse des enquêté·e·s les plus collaboratif·ve·s. N’ayant donc pas d’accord signé, et selon les normes légales qui encadrent la publication en France, les visages ont été floutés.
Cette photographie indiquant une signalétique uniquement au masculin, perçue comme « neutre » (Maruani, 2001) a été choisie pour illustrer l’exposition, elle a été prise sur un chantier de construction d’éoliennes au nord du pays en 2011. Elle évoquait la forte division genrée du travail. C’était particulièrement visible sur ce chantier où les femmes étaient cantonnées à des activités secondaires d’aide et de soutien quasi-domestique. Pour le titre de l’exposition, j’avais ajouté un WO au marqueur noir devant le « men at work » pour signifier l’invisibilisation des rapports de genre (WOmen at work).
Au même titre que d’autres matériaux de terrain, les photographies que je prenais avaient pour vocation d’alimenter l’analyse ou d’être montrées lors de congrès scientifiques. L’exposition dont il s’agit ici est venue bouleverser cet usage intimiste. Quand la responsable culturelle de l’Alliance éthio-française, à qui j’avais présenté mon travail, me propose de prendre part à un événement du Centre et d’y exposer mes photographies, le public visé change. La seule contrainte qui m’est alors donnée est de m’inscrire dans le thème du « travail des femmes », thème décidé par l’Alliance et l’Ambassade de France associée à l’événement3. Le second défi a été de penser une visite de cette même exposition pour un public enfantin.
L’exposition a été pensée en prenant au sens propre le concept d’invisibilisation du travail féminin (Friedan, 1963 ; Krinsky et Simonet, 2012) autour d’une trentaine de clichés sur plus de 700 photographies que mon projet réunissait alors à la fin de 2017. La contrainte du nombre était imposée d’une part par le nombre de cadres disponibles, d’autre part par le lieu, l’exposition étant accompagnée de nombreux panneaux explicatifs, il s’agissait de ne pas surcharger l’espace. Pour la sélection, que j’effectue seule, je m’impose, outre la notion d’invisibilité, de donner à voir la diversité des contextes de travail observés et d’essayer chaque fois que cela est possible de replacer le travail des femmes dans un rapport social de sexe (Maruani, 2005 ; Pfefferkorn, 2016) juxtaposant des photographies de travaux effectués par des hommes ou par des femmes, réputés féminins ou masculins (cf. schéma ci-dessous).
L’espace d’exposition a été séparé en trois : à gauche et à droite de l’entrée, deux murs permettent de disposer les photographies en nuage, alors que le mur qui fait face à l’entrée est percé de nombreuses portes permettant d’accéder à un second hall d’exposition. On atteint ce dernier par quelques marches et des piliers disposés en parallèle du mur participent à dessiner une sorte de couloir ajouré séparant dans la longueur les deux halls. Ce « couloir » a été utilisé pour disposer deux rangées de photos se faisant face, en utilisant les piliers d’un côté et les espaces entre chaque porte de l’autre.
Les photographies ayant trait à la division sexuée du travail constituaient le premier ensemble des photos sur le mur de gauche montrant la répartition genrée des tâches qui conduit à la naturalisation de compétences (Kergoat, 2005). Le « couloir » mettait en vis-à-vis des photos qui permettaient de penser la mise en scène du travail dans l’interaction entre le·a travailleur·se pris·e en photo et le·a photographe. Enfin, le mur de droite donnait à voir les changements du travail en Éthiopie, comparant des activités traditionnelles artisanales avec des photographies prises en usines, introduisant une réflexion sur l’articulation de la féminisation et de l’industrialisation (Omnès, 2003).
Chaque photographie était titrée et chaque espace (division du travail, interaction et industrialisation) était accompagné de deux ou trois panneaux explicatifs (en français et amharique4) permettant de saisir l’intention de la photographe, facilitant ainsi une visite autonome de l’exposition. Ces explications avaient été pensées pour un public adulte éduqué (celui qui fréquente l’Alliance éthio-française). Lorsqu’il a fallu organiser des visites d’élèves, il a paru nécessaire de prendre en compte l’expérience sociale spécifique d’un jeune public.
L’exposition a en effet donné lieu à différentes visites guidées, dont des classes de primaire du lycée éthio-français Guebré Mariam d’Addis-Abeba (CM1-CM2, au total environs 125 enfants de 8 à 10 ans, en grande majorité éthiopiens5). Le parti a été pris de prendre au sérieux l’expérience des enfants, de considérer « l’enfant-acteur social » (Danic, Delalande et Rayou, 2006, p. 27 ; voir aussi : Qvortrup, Corsaro et Honig, 2009 ; Sirota, 2012). L’univers infantile a un rapport distant au travail adulte (même s’il en est souvent l’objet6). L’expérience professionnelle ne se construit que peu dans la continuité avec l’expérience scolaire. Néanmoins, l’école en tant que lieu où interagissent des individus (professeurs, élèves, autres professionnels de l’éducation) amenés à collaborer pour atteindre un objectif (a minima celui de passer/faire passer dans la classe supérieure) peut être analysée avec les outils usuels de la sociologie du travail, au même titre qu’une entreprise ou tout groupe humain au travail, comme les travaux de Becker sur différents mondes professionnels y invitent (Perrenoud, 2013). Dans un premier temps et quelques jours avant la visite de l’exposition par les élèves, je me suis rendue dans les classes pour les photographier en train de travailler. Au fur et à mesure que je passais dans les classes, mes observations renvoyaient à des concepts classiques de l’analyse du travail (la division du travail par exemple), faisant également écho aux photographies de l’exposition. Ces concepts ont permis d’organiser ensuite la projection des photographies prises en classe de manière cohérente. Dans un second temps, lors de la visite à l’Alliance éthio-française, les enfants ont été invités à commenter les photographies d’eux·elles-mêmes et de leurs camarades en train de travailler. Ces photographies réalisées dans leur classe permettaient d’initier un travail reliant analyse verbalisée et en image. Dans un dernier temps, le même jour, les enfants prenaient part à la visite de l’exposition proprement dite.
Une première difficulté de ces visites tenait dans la réduction de la distance entre l’adulte et les enfants : dans l’interaction d’une part, et dans l’expérience sociale d’autre part, puisque le travail rémunéré leur est relativement étranger comme j’ai pu le constater dans les discussions que j’ai eues avec eux·elles au début de la journée de visite. Pourtant, le travail des enfants n’est pas rare en Éthiopie, le pays est régulièrement rappelé à l’ordre par l’ILO sur ce sujet, en dépit de la signature de différentes conventions internationales, transcrites dans les proclamations 10/1992 et 283/2002. Il n’y a pas d’âge de fin de scolarité obligatoire, mais l’emploi d’enfants de moins de 14 ans est prohibé et soumis à restrictions entre 14 et 18 ans, âge de la majorité légale. Dans les faits, nombre d’enfants ont des activités informelles rémunérées que ce soit en milieu rural (Haile et Haile, 2012 ; Pankhurst et al., 2015) ou pour les classes populaires des milieux urbains (Poluha, 2005). Les enfants du lycée français sont toutefois préservés de toute nécessité de travailler. En effet, ils appartiennent majoritairement aux classes supérieures éthiopiennes. L’établissement scolaire regroupe plus de 70 % d’Éthiopien·ne ·s, les 30 % restant se partageant entre Français.es, enfants des pays d’Afrique francophone et quelques autres européens. École payante (environ 40 000 ETB annuels [1 250 euros en 2018]7, alors que le revenu moyen éthiopien, selon la Banque mondiale, est inférieur à 1 000 ETB par mois [32 euros]), elle n’est censée être accessible qu’aux enfants francophones. Le lycée français est ainsi l’héritier d’une tradition impériale de formation de l’élite éthiopienne à l’étranger (Bahru Zewde, 2002). C’est pourquoi ses élèves sont en grande majorité connectés à la bourgeoisie internationale (Wagner, 2003), soit parce que toute ou une partie de leur famille réside à l’étranger soit parce que leurs parents y ont étudié, y compris dans des pays anglophones comme les États-Unis qui accueillent la majeure partie de la diaspora éthiopienne. Inscrire ses enfants au lycée français est aussi une stratégie de développement des compétences linguistiques d’enfants déjà pour partie anglophones selon les codes valorisés par la bourgeoisie internationale (Wagner, 1998), certains parents y envoyant leurs enfants dès la maternelle pour qu’ils·elles apprennent le français, arguant d’un lien souvent lointain avec la France8 9.
De prime abord, faire participer ces enfants a été facilité par leur appartenance à la classe supérieure, donc à l’aise dans l’interaction avec un adulte dans une situation d’apprentissage (Octobre, 2004 ; Lignier, 2008). Étant moi-même alors expatriée en Éthiopie, donc partageant certaines caractéristiques de cette bourgeoisie internationale, j’étais également familière pour ces enfants en tant que « maman d’élève » (trois de mes enfants étaient scolarisé·e·s en primaire dans cette école). J’avais donc une position d’adulte référent et bienveillant. Nous verrons cependant dans la dernière partie que si la position sociale des élèves a facilité la visite, elle a eu des effets spécifiques sur leur réception des photographies.
Après une présentation introductive et interactive pour définir le travail, les enfants assistaient à une projection des photographies d’eux·elles que j’avais réalisées en classe. Durant l’ensemble de ce travail, les maîtres et les maîtresses étaient présents mais discrets, intervenant essentiellement en cas de brouhaha trop important. Il s’agissait de préparer les élèves à comprendre des images pour lesquels ils·elles n’avaient pas l’ensemble de ces informations. Se faisant, les enfants accédaient à une approche abstraite (plus généralisable) du travail et pouvaient relier les concepts aux photographies10. L’invisibilité sociale du travail et ce que l’interaction photographique révèle du rapport au travail ont été les deux principales thématiques abordées avec les enfants.
Les premières photos présentées avaient été choisies parce que la position de l’élève ne permettait pas de savoir ce qu’il·elle faisait. C’était l’occasion de leur montrer que parfois le travail n’a rien de spectaculaire, voire sur certaines photographies, qu’on peut être en train de travailler alors que l’on n’est pas actif (par exemple, un·e élève qui attend une consigne). Ce cas de figure permettait de faire le lien avec des photos de l’exposition qui montraient des cireurs de chaussures, des vendeuses de rue qui sont apparemment oisif·ve·s car ils·elles attendent leurs clients. Or, l’attente peut être partie prenante de l’activité professionnelle (elle nécessite de l’attention pour préparer la suite ou réagir rapidement) et, visuellement, elle peut être difficile à distinguer d’autres activités comme le contrôle, par exemple.
La photographie a été prise dans une usine textile, en banlieue d’Addis-Abeba. J’y ai rencontré le directeur mais n’ai pas eu l’autorisation de faire des entretiens avec les salarié·e·s. Les clichés ont été pris lors d’une visite, accompagnée par le même directeur qui en avait informé au préalable les salarié·e·s. Si l’on efface la machine, il est difficile de deviner quelle activité pratique la travailleuse.
À l’inverse, parfois le corps du·de la travailleur·se nous donne à voir l’activité. Les photos suivantes montraient des élèves qui adoptaient des postures valorisées de l’activité de l’écolier·e : un.e élève penché·e sur son cahier ouvert, la tête tout près de la feuille, les doigts serrés sur son stylo, pouvait être montré·e comme l’idéal-type de l’écolier·ère au travail, de même que l’élève dont le doigt se dresse, le bras tendu, espérant être interrogé·e. Ce type d’attitude ne se retrouve pas dans les photos du travail exposées mais permettait de montrer que chaque activité professionnelle peut avoir des attitudes (un tour de main particulier, par exemple) et des outils spécifiques (les machines, un mètre ruban pour un·e couturier·ère, un ordinateur… voire un uniforme) qui participent à rendre visible son professionnalisme. À l’inverse, l’absence de ces spécificités visuelles valorisantes (par exemple : avoir des outils qui ne sont pas spécifiques à une activité professionnelle en particulier ou qui ne présupposent pas un savoir technique reconnu, comme un balai) peut être un indice d’une position plus basse dans la hiérarchie des métiers, et de manière corrélée, d’une expertise moins reconnue.
La plupart des observateurs adultes avec lesquels j’ai discuté lors du vernissage de l’exposition peinaient à identifier ce que fait exactement cette femme. J’ai eu l’occasion de la prendre en photo également lorsqu’elle passait le balai. Elle avait toujours un rapport ambivalent à ces photos, elle se laissait photographier mais de mauvaise grâce. Ce rapport ambivalent tient sans doute au fait que j’étais accompagnée du directeur de l’entreprise dont la présence rappelait sa situation de subordination, accentuée par le statut qu’elle devait m’attribuer (femme blanche accompagnant un cadre dans une entreprise étrangère, donc potentiellement représentante elle aussi de la direction). Cependant, comme Cornelia Hummel le mentionnait à propos d’une intendante en train de passer le balai, ces photos suggéraient aussi le « sale boulot » (Hummel, 2017).
L’interaction photographique constituait une seconde thématique d’échange avec les élèves. L’attitude des enfants face à la photographie pouvait être conditionnée par les instructions données par leur maître ou leur maîtresse et le rapport que l’élève entretient avec lui·elle ou plus généralement avec l’institution scolaire. Ainsi lorsque je m’étais rendue dans les classes, j’avais noté que quand un·e professeur·e dit à ses élèves de ne pas tenir compte de la photographe, il est difficile de capter le regard des écolier·e·s attentif·ve·s à respecter la consigne. Dans ce contexte, ceux·elles qui regardent l’appareil ou font un petit signe, pourraient être plutôt des élèves qui ont une certaine distance avec les normes de l’institution scolaire, soit ils·elles appartiennent à une minorité d’élèves de classe plus populaire et ont développé une culture anti-école qui leur permet d’assumer une position déviante par rapport aux normes scolaires (ce que Willis montre pour les enfants d’ouvriers dans les années 1970 [Willis, 2011]). Plus certainement, ils jouissent d’un pouvoir et d’une reconnaissance les autorisant à négliger le respect de certaines normes (ceux que Dubet et Martucelli décrivent comme les « vrais lycéens, nouveaux héritiers », issus de familles de classe supérieure [Dubet, 1991 ; Dubet et Martuccelli, 1996]11 ).
Toutes ces configurations permettaient de faire prendre conscience aux élèves de l’importance de l’analyse de l’interaction que crée la photographie, et ce qu’elle révèle du contexte du.de la travailleur·se et de son rapport à son métier, mais aussi de son rapport au·à la photographe. Les images 5 et 6 en donnent deux illustrations.
Photo prise dans la rue, près de mon domicile à Addis-Abeba. Cet homme ramassant les poubelles avait de lui-même posé fièrement devant sa benne. L’intérêt porté par une femme blanche, donc supposée issue de classe supérieure, dans une ville qui compte de nombreux·se·s expatrié·e·s, n’est sans doute pas étranger à cette mise en scène. Néanmoins, poser devant sa benne n’est pas équivalent à poser tout court. Cette présentation de soi ne peut donc être comprise en dehors du contexte professionnel, les activités d’embellissement (i.e. de gestion des déchets) de la capitale éthiopienne font d’ailleurs l’objet d’une valorisation récente12.
Je rencontre cet ingénieur lors de la visite du chantier d’éoliennes. Lorsque je lui propose de le prendre en photographie, il décide spontanément de venir se placer à son bureau. Il a un casque à la main et pas d’ordinateur sur son bureau relativement dépouillé… tout laisse à penser qu’il passe davantage de temps sur le chantier. Pourtant, c’est au bureau qu’il a souhaité poser et mettre en scène un travail plus intellectuel que manuel.
Prendre puis commenter les photographies des enfants avait permis de faire dialoguer regard « professionnel » (des enfants, « professionnels » de l’activité scolaire) et regard sociologique durant la première partie de la visite. Faire parler des enfants sur des images du travail introduisait « un troisième terme », le « regard profane » (Hummel, 2017). Ce dernier permet d’apporter de nouvelles données à la démarche de recherche en enrichissant la réflexion sur la multitude de processus qui participent à rendre visible ou invisible le travail.
Un travail, c’est d’abord un salaire. La discussion avec les élèves lors de l’introduction de la visite a été l’occasion de constater la prégnance d’une définition instrumentale du travail fondée sur sa dimension pécuniaire : ce dernier était d’abord associé à sa rémunération. L’exemple du travail domestique (« un parent qui passe le balai, est-ce vraiment différent comme activité d’un employé de maison qui balaye ? ») permettait de montrer aux élèves combien cette définition peut être restrictive et contribuer à invisibiliser certaines activités, en particulier celles qui sont peu rémunératrices. Lors de la visite de l’exposition (troisième temps de ma démarche) que j’effectuais par demi-groupe de classe, cette appréciation perdurait néanmoins dans leur réception des photographies.
Ainsi, les enfants qui observaient les photos de travail de rue commentaient peu l’activité des personnes photographiées. Ils commençaient le plus souvent par qualifier ces travailleur·se·s de « pauvres » car exerçant des petits métiers dans la rue et ne donnant pas l’apparence de la prospérité. La prégnance du rapport instrumental faisait donc écran au regard sur l’activité, donc à sa mise en visibilité : les élèves voyaient la pauvreté là où je voyais (et souhaitais montrer) le travail. C’était particulièrement le cas concernant l’image 7.
Cette photographie avait été choisie pour montrer les frontières labiles de l’espace professionnel : la vendeuse installe son étal dans la rue, mais devant chez elle (entre espace public et privé, entre espace domestique et professionnel), entourée de l’ensemble de sa famille (ses enfants ?). J’ai saisi cette image parce que je m’intéressais aux frontières et à l’organisation spatiale, mais en choisissant une photographie qui interroge les limites, j’avais pris le risque de ne pas donner à voir des signes de la professionnalité de cette activité.
Ce rapport instrumental est associé en Europe à la catégorie socio-professionnelle des répondant·e·s : les ouvrier·e·s ont davantage un rapport instrumental au travail par exemple, l’envisageant prioritairement comme un gagne-pain (Goldthorpe et al., 1972). Différentes études tendent également à montrer que la dimension instrumentale est moins importante chez les jeunes européen·ne·s dans leur rapport au travail que dans d’autres tranches d’âge (Davoine et Méda, 2009 ; Méda et Vendramin, 2013). Le rapport au travail a été peu investigué en Afrique ou en Éthiopie, les sciences sociales ayant d’abord abordé le travail sous un angle politique, notamment celui des dominations (de la classe ouvrière, des peuples colonisé·e·s), les chercheur·se·s s’intéressant moins au travail en tant qu’activité professionnelle (Copans, 2014). Actuellement l’approche du travail peine encore à sortir du paradigme développementiste, en particulier en Éthiopie (Perrin-Joly, 2020). Les résultats de l’enquête ethnographique menée avec des adultes dans les entreprises ont conforté l’hypothèse que ces visites m’avaient amenée à formuler : le rapport instrumental au travail est corrélé avec l’insécurité qui caractérise les parcours de vie éthiopiens, y compris des classes supérieures (même si, pour ces dernières, cette insécurité est moindre).
Le quotidien de ces enfants explique aussi l’étrangeté pour eux de certaines activités, leur difficulté à les « voir » en tant que telles et leur tendance à les assimiler à une représentation globalisante de la pauvreté. À la fin de la visite, je demandais aux élèves de me désigner leur photographie préférée en m’expliquant leur choix. Ils·elles ne répondaient pas de manière systématique à cette question, parfois trop empressé·e·s de sortir jouer13. Les photos du panneau « division du travail » (travail de rue, travail domestique et naturalisation des compétences en étaient les sous-thèmes) n’étaient presque jamais désignées, moins familières à ce public enfantin. Les enfants de classe moyenne à supérieure, à Addis-Abeba, perçus par leurs parents comme moins en sécurité dans la rue, ont davantage l’habitude (voire exclusivement) de se déplacer en voiture. Ce mode de déplacement leur permet moins d’observer les activités professionnelles qui se déroulent dans la rue.
Montrer des photographies du travail à des enfants, c’est également les confronter à un éventail de possibles. Certes, les adultes comme les enfants peuvent s’identifier aux modèles, en particulier puisqu’il s’agit de photographies représentant des personnes « ordinaires ». Mais les enfants s’y projettent aussi en tant que futur.e.s adultes et considèrent les photographies non seulement selon leur « aire du photographiable » (Bourdieu et al., 1965) mais aussi selon leur aire du probable. Dit autrement, ils entretiennent un rapport de familiarité avec les activités non seulement visibles dans leur sphère sociale, mais aussi désirables dans leur parcours futur. Si l’aire du photographiable désigne selon Bourdieu et son équipe « la promotion ontologique d’un objet perçu en objet digne d’être photographié, c’est-à-dire fixé, conservé, communiqué, montré et admiré » (p. 24), le concept doit être réévalué à l’aune de la banalisation de la photographie, devenue notamment avec le téléphone portable, un média aux usages plus divers et potentiellement plus éphémères. Il reste que l’aire du photographiable nous renseigne sur ce qui est identifié, ce qui est vu et pourrait être partagé, mais sous réserve d’analyser la diversité des usages et des projections associées à la photographie, l’aire du probable en constituant une de ses formes spécifiques.
Les origines sociales privilégiées des élèves ont ainsi facilité la projection par certaines filles dans des modèles de réussite féminins dans des métiers masculins qualifiés (une femme laborantine, image 8) comme plus traditionnels (une femme tisserande, image 9), positions qui remettent en question les normes genrées du travail davantage prégnantes chez les enfants des familles populaires éthiopiennes que ceux·elles des classes supérieures (Poluha, 2005).
Cette photo a été prise lors de la visite d’une brasserie qui a ensuite fait l’objet d’une enquête approfondie (plus de 25 entretiens), l’usine est située dans le sud du pays. La photo a été prise environ un an avant que je débute les entretiens avec les salarié·e·s, lors d’une visite que j’ai effectuée avec le directeur de la brasserie.
La familiarité se définit aussi à l’aune de l’expérience sociale des enfants au sens large. Ainsi, certains environnements pouvaient être visuellement évocateurs pour eux·elles, de manière différente des adultes. J’ai été ainsi d’abord étonnée du choix de certaines filles qui me désignaient comme image favorite une photo de femmes travaillant dans le textile dans les conditions contraignantes d’une organisation tayloriste, particulièrement visibles pour un œil adulte et/ou occidental.
Cette photographie a été prise dans une usine textile de la banlieue d’Addis-Abeba (différente des photos précédentes). Elle se caractérise par une organisation en travail posté dans de grands hangars, employant sur les activités de couture quasi uniquement des femmes. J’ai réalisé ces photographies lors d’une visite organisée par un informaticien que j’avais rencontré par ailleurs. J’avais pu faire un entretien avec le directeur de l’usine mais je n’ai pas pu poursuivre par des entretiens avec les salarié·e·s.
Au-delà des perceptions enfantines de l’ordre social (Lignier et Pagis, 2012), et plutôt que d’y voir l’acceptation de la domination (genrée), on peut poser l’hypothèse que les élèves voyaient une proximité de cette organisation du travail avec leur expérience scolaire. Ce parallèle était en effet encouragé par l’exercice préliminaire à la visite de commentaire des photographies de classe. Les femmes étaient en rang sur des petites tables, semblables à des bureaux. Le collectif uniquement féminin pouvait renvoyer au groupe de copines de classe. Cette hypothèse est étayée par l’intérêt que suscitait la photographie de sortie d’usine des ouvrières, image que le public enfantin me disait associer explicitement aux sorties d’école.
Cette image a été prise dans le parc industriel d’Hawassa, dans le sud du pays. Des hangars identiques accueillent différentes usines textiles dans une zone entièrement close où il n’est pas possible de pénétrer sans autorisation. À 17h partent les premiers bus des entreprises qui ramènent chez eux·elles les salarié·e·s (20 000), majoritairement des femmes.
Ainsi, le choix des photos par les enfants ne recoupe pas toujours la hiérarchie des métiers puisque dans les photos appréciées, l’ingénieur, le directeur d’usine, le travailleur du sel et les cireurs de chaussures avaient un succès équivalent. Au-delà de la familiarité et de l’aire du probable, c’est aussi l’exceptionnalité de la situation qui a attiré l’œil des enfants.
La photographie peut davantage s’adresser à l’imaginaire qu’évoquer une représentation d’un réel actuel ou futur. Ce qui crée l’intérêt du public n’est pas alors la familiarité de l’image mais à l’inverse son caractère spectaculaire, s’ancrant dans les représentations iconographiques héritées et les normes des belles images (Meyer et al., 2019). Un jeune afar (peuple du nord-est éthiopien) dans le désert de sel, pris sur le vif dans un ample mouvement de pioche était toujours l’objet d’admiration du public lors des visites que j’ai conduites.
Photo prise lors d’un voyage guidé dans le désert du Danakil. Notre guide n’était pas lui-même afar (peuple d’éleveurs majoritaires dans cette région), il a commenté le processus d’extraction et de commerce du sel auquel participent les travailleurs, la présence des touristes ne semblant pas modifier leur activité. Le groupe se composait d’une dizaine de personnes, exclusivement blanches, majoritairement de moins de 35 ans.
C’est l’esthétique du mouvement qui est appréciée tout comme l’exotisme du sujet, à la fois étrange mais d’une étrangeté mesurée et attirante, telle qu’elle est construite par le secteur du tourisme (Staszak, 2008 ; Bridonneau, 2014). Pourtant ce jeune afar travaille sous un soleil de plomb et ses habits déchirés comme ses chaussures en plastique laissent percevoir les difficultés économiques de sa condition. Ce n’est donc ni l’activité en tant que telle qui est valorisée, ni le prestige économique ou social qui peut y être associé, mais l’image telle qu’elle est construite et ce qu’elle évoque. Son caractère spectaculaire, qui prend le dessus sur son aspect documentaire, participe à invisibiliser le travail à deux niveaux. Tout d’abord, dans l’œil de celui·celle qui la regarde : le travail est ici d’autant plus spectaculairement visible qu’il est socialement moins reconnu (Renault, 2009). Ce n’est pas l’activité elle-même qu’on admire, mais bien son exotisme.
D’autre part, le travail est invisibilisé par la mise en scène de celui·celle qui le montre : braquer les projecteurs sur un travailleur de sel, c’est mettre dans l’ombre tous·tes ceux·elles qui, autour, participent également à cette activité. Il en va ainsi des femmes qui accompagnent ces travailleurs. Dans les visites proposées par les agences du désert du Danakil, l’accès à cette région étant interdit sans guide, l’observation des travailleurs de sel est un passage obligé. Ces derniers, quoique peu loquaces, se laissent photographier par les groupes de touristes blanc·he·s à qui on laisse à cet endroit un court moment d’observation entre de longs trajets véhiculés (les photographies sont encouragées). Une autre photographie du travail des Afars, prise dans ces mêmes conditions, était présente dans l’exposition, mais a peu retenu l’attention des enfants (ni celle des adultes d’ailleurs). Elle avait été prise en dehors des scènes présentées, hors de ce que les guides considèrent comme l’aire du photographiable des visiteur·se·s, au sens originel du terme d’un objet digne d’être montré, conservé, admiré : une femme tournant le dos, dans un espace en retrait, servait le thé aux hommes affectés à casser la couche de sel sur le sol pour en extraire le précieux minéral.
Si cette photographie permettait de rendre visible ce qui avait été, si ce n’est dissimulé, au moins éloigné du regard des touristes, elle était à nouveau éclipsée par le regard du public enfantin peu intéressé par cette activité domestique. Pour ces enfants ayant rarement sillonné leur pays, habitué·e·s à la vie urbaine, le travailleur afar exerçait une fascination semblable, tout aussi exotique, que pour les touristes étranger·ère·s.
Si la « qualité heuristique de base [de la photographie est] : montrer, faire voir, attirer l’attention » (Piette, 2007, p. 23), elle peut être un outil adéquat pour montrer le travail invisible. Cependant, encore faut-il s’interroger sur la manière dont elle est montrée puis reçue par le public, en particulier un public « profane », ici enfantin. En Afrique, le cadre développementiste qui s’applique à nombre de recherches tend à réduire les enfants à leur vulnérabilité et à privilégier une visée normative aux usages pédagogiques des images. Il s’agit soit d’en identifier le potentiel éducatif dans le cadre de politiques de prévention, soit de dénoncer les risques de photographies porteuses de stéréotypes. Si ces recherches revendiquent une reconnaissance de l’enfant en tant qu’acteur, elles se penchent assez peu sur la manière dont les images sont interprétées par un tel public (voir par ex. : Nguyen et Mitchell, 2012). L’expérience décrite dans cet article donne ainsi à voir un autre dispositif possible de co-construction avec les enfants. L’accompagnement pédagogique fondé sur l’expérience sociale a été pensé dans ce sens, pour faciliter leur lecture de photographies d’activités professionnelles.
Mais l’exposition peut aussi être considérée comme une manière de penser autrement un matériau photographique construit au départ dans une démarche de recherche. La visite de cette exposition photographique sur le travail, croisant le genre de l’activité professionnelle et sa reconnaissance a permis de souligner combien visibilité et invisibilité du travail étaient, non seulement, construites par les normes sociales, professionnelles et organisationnelles qui régissent l’activité, mais aussi par le regard de ceux·elles qui l’observent (le·a photographe comme le public).
L’analyse de la réception des images, l’importance de la prise en compte du « caractère socialement construit du document photographique » (Papinot, 2007, p. 84) permet de saisir différents facteurs qui jouent sur la réception par un public « profane ». Cette dernière est d’une part corrélée à un processus d’identification/projection selon l’environnement social spécifique des élèves, d’autre part tributaire de la prégnance des représentations iconographiques, des normes esthétiques, du spectaculaire et de l’exotisme. Cette analyse de la réception des photographies offre ainsi « un matériau empirique à part entière » (Bajard, 2016, p. 14), les réactions des élèves sur les photos informant de la perception du travail, horizon de projection construit au croisement de l’appartenance sociale (bourgeoisie internationale), du contexte éthiopien (incertitude des parcours de vie), de l’expérience sociale des enfants comme de l’imaginaire que véhicule la photographie.
Si le message adressé par le·a photographe et l’interprétation des photographies par des enfants ne concordent pas toujours, l’exposition permet de remettre l’ouvrage sur le métier en donnant à voir la manière dont les images sont réappropriées, réinterprétées. L’exposition peut ainsi devenir une étape à part entière de la recherche articulant mise en visibilité et analyse de la réception.
1 La démarche d’exposition a fait l’objet d’une importante réflexion en muséographie. Toutefois, ces débats n’ont pas systématiquement articulé la réflexion scénographique avec l’analyse empirique de la réception par les visiteurs·euses. Pendant longtemps, ces derniers ont été considéré·e·s comme des entités abstraites, des visiteurs passifs (Rasse, 1999).
2 Aucun chiffre précis ne permet d’évaluer le travail dans la rue, même si ce dernier est visiblement très présent dans les villes éthiopiennes. Une évaluation à partir de la répartition des activités urbaines permet d’estimer que plus d’un tiers de celles-ci s’exercent potentiellement dans la rue. Cette estimation a été réalisée par l’auteure à partir du Labor Force Survey, une enquête périodique réalisée par l’Agence éthiopienne de statistiques (CSA). https://www.statsethiopia.gov.et/
3 L’exposition était une des facettes de la Nuit des idées. Crée en 2016 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Institut français, se déroulant simultanément dans les instituts et alliances françaises de par le monde à la fin du mois de janvier, la Nuit des idées de 2019 avait pour thème « Face au présent ». Le thème des femmes et du genre avait été choisi par l’équipe en charge de l’événement en Éthiopie.
4 La lingua franca de l’Éthiopie.
5 Les élèves éthiopien·ne·s de cette école française représentent selon les promotions 70 à 80 % de l’effectif.
6 S’ils ne portent pas sur des photographies mais sur des cartes à classer, les études de Bernard Zarca (1999) puis de Julie Pagis et Wilfried Lignier (2012) interrogent le « sens social » d’enfants parisiens, autrement dit leurs connaissances des hiérarchies sociales entre les métiers. Si leurs conclusions diffèrent sur les modalités d’acquisition de ce sens social et le processus de classement des enfants (individuel ou collectif), leurs résultats montrent en creux la connaissance limitée que les enfants ont de l’activité quotidienne concrète de travail des différents métiers évoqués.
7 Hors frais supplémentaires (première inscription, frais d’examens, de fournitures scolaires…)
8 L’attrait du lycée français a cependant diminué pour les éthiopien·ne·s à mesure que s’affirmaient leur relation privilégiée avec les États-Unis. Le choix de ce lycée peut ainsi aussi être motivé par des raisons économiques, s’agissant d’une école jouissant à la fois d’une bonne réputation parmi la population éthiopienne tout en étant un établissement international parmi les moins chers de la ville.
9 Il existe peu d’études sur les élèves du lycée, institution difficile d’accès pour les enquêtes de terrain. On pourra utilement consulter le mémoire de master de Maxime Cochelin qui a justement observé la construction d’une identité internationale par les jeunes du lycée Guebre Maryam (Cochelin, 2021).
10 Aucune photographie des enfants ne sera montrée ici. En effet, elles ont été prises pour un exercice pédagogique et présentées ainsi aux enfants et aux adultes référents.
11 La comparaison avec des recherches réalisées aux États-Unis ou en France tient sa pertinence du fait de l’inscription de ces élèves dans l’espace de la mondialisation et leur cursus depuis le plus jeune âge dans une école française.
12 Sur la gestion des déchets à Addis-Abeba : Pierrat, 2014 ; Tamru, 2019.
13 Les réactions des enfants ont été notées après la visite dans un journal de terrain mais n’ont pas fait l’objet ni d’enregistrement, ni d’une comptabilisation systématique.
BAHRU Zewde (2002), Pioneers of change in Ethiopia: the Reformist Intellectuals of the Early Twentieth Century, Oxford, Royaume-Uni, J. Currey.
BASZANGER Isabelle (1986), « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », Revue française de sociologie, 27 (1), p. 3-27.
BECKER Howard (1974), « Photography and Sociology », Studies in Visual Communication, 1 (1), p. 3-26.
BOURDIEU Pierre (1965), Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditions de Minuit.
BRIDONNEAU Marie (2014), « S’ancrer dans le monde « pour une vie meilleure ». Les rencontres entre habitants et touristes à Lalibela (Éthiopie), petite ville du patrimoine mondial », Via Tourism Review, 4 5.
BULTY Bedanie Gemetchu, TULU Daniel Tadesse (2016), « The Impacts of Petty Trade on Household Livelihood: A Study of Women Petty Traders in Oromia Regional State, West Shoa Zone », American Journal of Business and Management, 5 (3), p. 113-117.
CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE Yannick (2014), Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Éditions Points.
CHAUVIN Pierre-Marie (2017), « Mussafah Shots. Une expérience pédagogique de sociologie visuelle dans une petite ville industrielle des Émirats », Revue Française des Méthodes Visuelles, 1, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/1/articles/une-experience-de-sociologie-visuelle-dans-une-petite-ville-industrielle-des-emirats/
COCHELIN Maxime (2021), Ici, ailleurs et nulle part ? Essai sociologique sur le parcours d’une jeune élite africaine extravertie, mémoire de master, EHESS.
COLLIER John, COLLIER Malcom (1986), Visual anthropology: Photography as a research method, Albuquerque, University of New Mexico Press.
CONORD Sylvaine (2007), « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française, 37 (1), p. 11-22.
CONORD Sylvaine (2017), « Lorsque les enquêtés deviennent guides du chercheur-photographe. Une approche 'collaborative' en sociologie visuelle », Revue française des méthodes visuelles, 1, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/1/articles/une-approche-collaborative-en-sociologie-visuelle-lorsque-les-enquetes-deviennent-guides-du-chercheur-photographe/
COPANS Jean (2014), « Pourquoi travail et travailleurs africains ne sont plus à la mode en 2014 dans les sciences sociales », Politique africaine, 133 (1), p. 25-43.
DAVOINE Lucie, MÉDA Dominique (2009), « Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie des Français par rapport aux Européens ? », Informations sociales, 153 (3), p. 48-55.
DUBET François (1991), Les lycéens, Paris, Éditions du Seuil.
DUBET François, MARTUCCELLI Daniello (1996), À l’école : Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Éditions du Seuil.
FRIEDAN Betty (1963), The Feminine Mystique, London, Penguin Books.
GADEA Charles (2015), « L’idiome figuratif des groupes professionnels », Images du travail, travail des images, 1, [en ligne] https://journals.openedition.org/itti/1278#quotation
GOLDTHORPE John Harry, LOCKWOOD David, BECHHFER Franck (1972), L’ouvrier de l’abondance, Paris, Éditions du Seuil.
GUINCHARD Christian (2016), « Observation photographique : Disqualification et requalification de l’espace et des personnes », Espaces et sociétés, 164-165 (1), p. 67-84.
HAILE Getinet, HAILE Beliyou (2012), « Child labour and child schooling in rural Ethiopia: Nature and trade-off », Education Economics, 20 (4), p. 365-385.
HARPER Douglas (1988), « Visual sociology: Expanding sociological vision », The American Sociologist, 19 (1), p. 54-70.
HARPER Douglas (1998), Les vagabonds du nord-ouest américain, Paris, L’Harmattan.
HARPER Douglas (2002), « Talking about pictures: A case for photo elicitation », Visual Studies, 17 (1), p. 13-26
HUMMEL Cornelia (2017), « Porter un regard photographique sur le vieillissement en couvent. Que disent les frontières mouvantes du “photographiable” ? » ethnographiques.org, 35, [en ligne] https://www.ethnographiques.org/2017/Hummel
KERGOAT Daniel (2005), « Penser la différence des sexes : Rapports sociaux et division du travail entre les sexes », in MARUANI Margaret, Femmes, genre et sociétés. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, p. 94-101.
KRINSKY John, SIMONET Maud (2012), « Déni de travail. L’invisibilisation du travail aujourd’hui – Introduction », Sociétés contemporaines, 87 (3), p. 5-23.
LEGESSE Fitsum Meseret, MEKONEN Kassahun Desyalew, GENETU Yared Paulos (2016), « The Implementation of Community Policing in Slum Neighborhoods of Addis Ababa, Ethiopia », International Journal of Current Research, 8 (7), p. 35358-35366.
LIGNIER Wilfried, PAGIS Julie (2012), « Quand les enfants parlent de l’ordre social », Politix, 99 (3), p. 23-49.
MARESCA Sylvain (2007), « Photographes et ethnologues », Ethnologie française, 37 (1), p. 61-67
MARUANI Margaret (2001), « L’emploi féminin dans la sociologie du travail : Une longue marche à petits pas », in MARUANI Margaret, Masculin-Féminin questions pour les sciences de l’homme, Paris, Presses universitaires de France, p. 43-56.
MARUANI Margaret (2005), Femmes, genre et sociétés. L’état des savoirs, Paris, La Découverte.
MÉDA Dominique, VENDRAMIN Patricia (2013), Réinventer le travail, Paris, Presses universitaires de France.
MEYER Michaël (2013), « Éléments pour une ethnographie visuelle des organisations », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, HS (Supplément), p. 131 153
MEYER Michaël, GOUILHERS Solène, HUMMEL Cornelia, KIMBER Line Rachel, RADU Irina, RIOM Loïc (2019), « Six sociologues sur un (beau) bateau : L'esthétique comme passager clandestin dans un corpus photographique », Revue française des méthodes visuelles, 3, [en ligne] https://rfmv.fr/numeros/3/articles/10-six-sociologues-sur-un-bateau/
NGUYEN Xuan Thuy, MITCHELL Claudia (2012), « On the use of visual methodologies in educational policy research », South African Journal of Education, 32 (4), p. 479-493
OMNES Catherine (2003), « Les trois temps de l’emploi féminin : Réalités et représentations », L’Année sociologique, 53 (2), p. 373-398
PANKHURST Alula (1999), « “Caste” in Africa : The Evidence from South-Western Ethiopia Reconsidered », Africa: Journal of the International African Institute, 69 (4), p. 485-509
PANKHURST Alula, CRIVELLO Gina, TIUMELISSAN Agazi (2015), « Work in children’s lives in Ethiopia: Examples from Young Lives communities », in PANKHURST Alula, BOURDILLON Mickael , CRIVELLO Gina, Children’s Work and Labour in East Africa: Social Context and Implications for Policy, Addis Ababa, OSSREA, p. 34.
PAPINOT Christian (2007), « Le “malentendu productif” : réflexion sur la photographie comme support d’entretien », Ethnologie française, 37 (1), p. 79-86
PERRENOUD Marc (2013), Les mondes pluriels de Howard S. Becker, Paris, La Découverte.
PERRIN-JOLY Constance (2020), « Le travail en Éthiopie : du paradigme développementiste à l’analyse des travailleurs et travailleuses », Annales d’Éthiopie, 33, p. 11-28
PFEFFERKORN Roland (2016), Genre et rapports sociaux de sexe, Lausanne, Empreinte.
PIERRAT Adeline (2014), Les lieux de l’ordure de Dakar et d’Addis Abäba : Territoires urbains et valorisation non institutionnelle des déchets dans deux capitales africaines, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
POLUHA Eva (2005), « The power of continuity: Ethiopia through the eyes of its children », Choice Reviews Online, 43 (3).
QVORTRUP Jens, CORSARO William A., HONIG Michael-Sebastian (dir.) (2009), The Palgrave handbook of childhood studies, Houndmills, Palgrave Macmillan.
REMY Jean (1994), « L’implication paradoxale dans l’expérience touristique », Recherches Sociologiques, 2, p. 61-78
SIROTA Régine (2012), « L’enfance au regard des Sciences sociales », AnthropoChildren, 1.
STASZAK Jean-François (2008), « Qu’est-ce que l’exotisme ? », Le Globe. Revue genevoise de géographie, 148 (1), p. 7-30
STRAUSS Anselm (1992), La trame de la négociation : Sociologie qualitative et interactionnisme, Paris, L’Harmattan.
TAMRU Bezunesh (2018), « La catastrophe de la décharge de Räpi à Addis-Abeba . Éléments de compréhension par l’analyse des politiques publiques et des recompositions socio-spatiales », Annales d’Éthiopie, 32, p. 149-178
WAGNER Anne-Catherine (1998), Les nouvelles élites de la mondialisation, Paris, Presses Universitaires de France.
WAGNER Anne-Catherine (2003), « La bourgeoisie face à la mondialisation », Mouvements, 26 (2), p. 33-39
WILLIS Paul (2011), L’école des ouvriers : Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des boulots d’ouvriers, Marseille, Agone.
ZARCA Bernard (1999), « Le sens social des enfants », Sociétés contemporaines, 36 (4), p. 67-101
Constance Perrin-Joly, « Exposer les photographies du travail, interroger leur réception», Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 6 | 2022, mis en ligne le 6 juin 2022, consulté le . URL : https://rfmv.fr