

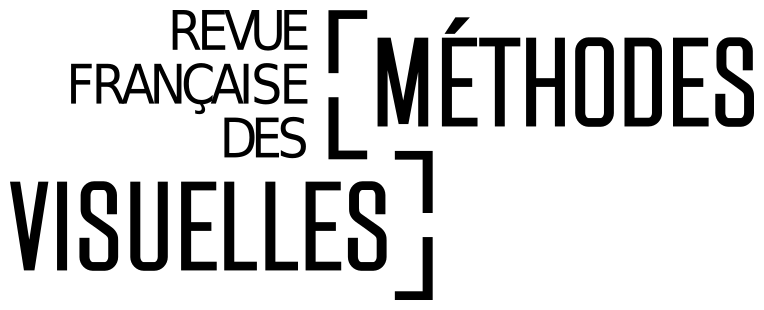
Julie Leblanc, Doctorante en anthropologie, Université Lumière Lyon II, LADEC
Cet article s’appuie sur une recherche doctorale en anthropologie menée avec des femmes immigrées âgées de 60 à 80 ans d’origine maghrébine habitant la zone urbaine des Minguettes dans l’agglomération lyonnaise. Il retrace la mise en place au sein de cette recherche d’un dispositif de recherche partagée utilisant l’image photographique sous plusieurs formes (photographies d’archives personnelles, officielles, prises dans le quartier, portraits). Ce dispositif questionne le paradoxe entre l’ancrage historique de ces femmes dans leur quartier (et plus largement en France) et le fait que leur mémoire soit peu exprimée, transmise, visible, au sein des familles, des jeunes générations et du territoire. Plusieurs réflexions et questions ont émergé. Comment transmettre les objectifs de ma recherche et ses résultats dans le milieu académique et à un public plus large ? Mais aussi aux femmes concernées elles-mêmes en prenant en compte le fait qu’elles ne lisent pas toutes le français ? Comment questionner l’invisibilité sociale de ces femmes sans la reproduire en faisant de la recherche avec elles, et non pas sur elles ?
Mots-clés : Immigration, Femmes, Mémoire, Photographies, Recherche partagée
This article is based on a doctorate anthropological research with Maghrebian immigrant women aged 60 to 80 years old residing in the Minguettes neighborhood of Lyon. It shows the implementation in this research of a shared research structure using several forms photographic images (personal photographic archives, official photographic archives, images taken in the neighborhood, portraits).This structure puts into question the paradox between the historical roots these women have in their neighborhood (and more broadly in France) and the fact that their memories are seldom expressed, transmitted, or visible in their families, the younger generations and the territory. Several thoughts and questions have emerged. How can I share my research objectives and its results in the academic setting as well as with a larger audience? How can I share it with the women themselves knowing that not all of them read French? How can I question the social invisibility of these women without recreating it by doing research with them and not about them?
Keywords : Immigration, Women, Memory, Photography, Shared research
Lors des premières rencontres avec des habitant.es ou professionnel.les du territoire, lorsque j’évoquais ma recherche au sujet des femmes immigrées âgées dans la zone urbaine des Minguettes à Vénissieux1 certain.es me répondirent : « Il n’y en a pas ! », « Elles sont restées au pays », « On ne les voit pas2 ». D’autres attestaient de leur présence mais dans des lieux spécifiques. Un imam m’avait répondu : « La mosquée est un lieu important dans leurs circuits de tous les jours après le marché et le médecin généraliste3 ». Une médiatrice santé, très active dans le réseau associatif de Vénissieux, avait évoqué le centre social et m’avait notamment indiqué un groupe de femmes se retrouvant tous les quinze jours auquel participaient quelques femmes âgées de plus de soixante ans. Ces premiers éléments recueillis sur le terrain rejoignaient celui des rares chercheur.euses travaillant sur la question des femmes immigrées vieillissant en France. Que ce soit, C. Attias-Donfut (2006), F. Ait Ben Lmadani (2007), A. Chaouite (2011), S. Laacher (2014) ou R. Gallou (2016), tou.tes se rejoignent sur le fait que si les travaux pionniers sur la question du vieillissement en immigration ont porté la focale sur les hommes isolés vivant dans les foyers, les femmes sont restées « en arrière-plan » (Laacher, 2014). Par ailleurs le recensement de la population montre à l’échelle de la commune la pertinence d’interroger le vieillissement des femmes immigrées qui représentaient en 2009 une part non négligeable (3,6 % de la population vénissiane totale) au sein desquelles les femmes d’origine algérienne étaient majoritaires. Le nombre de femmes immigrées d’origine maghrébine de 55 ans et plus s’élevait à 1 082 sur la commune de Vénissieux – pour un total de 6 911 femmes immigrées recensées tous âges et origines confondus4. En 2016, ce chiffre s’élève à 1 655 – pour un total de 8 6935. Ces chiffres attestent donc de leur présence, même croissante, mais comment rencontrer ces femmes d’autant plus pour les inviter à raconter leurs parcours de vie ?
La thèse sur laquelle revient cet article s’appuie sur un terrain de recherche se déroulant depuis 2013 au sein de la zone urbaine des Minguettes6. Cette recherche s’intéresse en particulier aux processus d’invisibilité sociale à l’œuvre au sujet des femmes immigrées et âgées vieillissant en France. L’invisibilité sociale est entendue comme « une privation de l’attention publique » (Voirol, 2005) envers certaines activités sociales, certain.es individu.es ou groupes d’individu.es. L’invisibilité sociale des femmes immigrées âgées d’origine maghrébine en France n’est pas un état mais un processus à la fois dynamique et paradoxal. Un groupe social peut être invisibilisé dans une situation donnée et a contrario visibilisé, voire survisibilisé dans un autre contexte. Ainsi, l’immigration féminine en France restée invisible jusque dans les années 1980 au sein des recherches, notamment anthropologiques, s’est vue ensuite visibilisée en tant que problème social (Kuczynski et Razy, 2009 ; Morokvasic, 2011). Au sujet des femmes immigrées âgées, souvent figures centrales au sein de leur famille, leur vécu est peu connu à l’échelle du quartier, de la ville et encore moins au niveau national. Cette invisibilité constitue un paradoxe au regard de l’ancrage historique et de la mobilité quotidienne de ces femmes dans l’espace urbain local mais aussi national et transnational qu’elles habitent souvent depuis les années soixante. Cet article entend décrire le dispositif de recherche partagée ayant mis en lien une anthropologue, des femmes immigrées âgées, des associations socio-culturelles et des artistes. Nous reviendrons d’abord sur l’émergence de ce dispositif et le contexte de recherche dans lequel il a été mis en place, ensuite nous nous attarderons sur la collaboration entre chercheuse, habitantes et artistes en détaillant la mise en place des ateliers et les matériaux qu’ils ont permis de recueillir. Enfin, nous tenterons de comprendre en quoi et comment ce dispositif de recherche partagée agit sur les différentes postures et engagements des participantes et comment celles-ci peuvent concrètement s’en emparer, tout en identifiant les apports méthodologiques et heuristiques d’une telle modalité de recherche.
Dès ses débuts, l’enquête ethnographique a été menée en collaboration avec une association d’habitantes des Minguettes réalisant des actions autour des liens intergénérationnels et de la valorisation des « aînées du quartier7 », et les centres sociaux du territoire. Ce choix relevait de la prise en compte de plusieurs faits : mon extériorité au quartier et donc la nécessité d’y avoir des relais, la dispersion des femmes qui ne constituent pas un groupe institué, mon souhait de travailler en réseau du fait de ma formation initiale d’infirmière, le but de mettre en place une réelle observation participante en plus des entretiens de récits de vie.
Le terrain n’est pas une chose, ce n’est pas un lieu, ni une catégorie sociale, un groupe ethnique ou une institution. C’est tout cela peut-être selon les cas, mais c’est d’abord un ensemble de relations personnelles où « on apprend des choses ». « Faire du terrain », c’est établir des relations personnelles avec des gens qu’on ne connaît pas par avance, chez qui l’on arrive un peu par effraction
(Agier, 2004, p. 35)
Plusieurs éléments sont ici importants. D’une part, les femmes immigrées âgées d’origines maghrébines ne sont effectivement pas un groupe constitué, se définissant comme tel et encore moins homogène. D’autre part, la notion d’« effraction » est ici cruciale ayant pu expérimenter cette sensation réciproque à plusieurs reprises. Elle s’est exprimée de la façon la plus explicite lors de mes premiers contacts au sein des mosquées du quartier. Ma présence en tant qu’étudiante-chercheuse et en tant que personne extérieure au culte musulman, à une origine commune et au quartier, a parfois été perçue comme un risque d’effraction dans le sanctuaire que constitue l’espace cultuel. Sanctuaire au sens également d’un lieu protégé et protecteur, d’un refuge. Des femmes ont pu me répondre : « On ne veut pas, avec tout ce qu’on raconte sur nous dans les médias… » ou me demander un « laissez-passer8 » de la part des hommes responsables du lieu de culte. A. Aggoune exprime la difficulté qu’il a pu rencontrer pour entrer et surtout pour accéder à des liens de proximité avec les familles algériennes au sein de leurs domiciles lors d’une enquête menée sur l’aménagement des habitats dans un quartier populaire de la région parisienne. Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’« il est trompeur de croire que la difficulté principale est de réussir à pénétrer dans le logement des familles immigrées algériennes, car on n’est jamais certain d’y être véritablement “entré” une fois la porte franchie » (Aggoune 2009, p. 138). Les liens d’interconnaissance et de confiance restent à établir y compris une fois le seuil des appartements passés. Dans un souci d’accès mais surtout pour atténuer ce sentiment d’ « effraction », les partenaires associatifs locaux ont constitué les premières « clés d’entrée » sur mon terrain de recherche pour rencontrer les femmes dont les parcours de vie m’intéressaient.
Les temps d’observation ethnographique ont connu plusieurs étapes : des entretiens au domicile des femmes fréquentant l’association d’habitantes, des ateliers de français en tant que bénévole au sein des centres sociaux, des cours d’arabe pris en tant qu’apprenante dans une mosquée de quartier. C’est finalement par le biais de liens de confiance établis lors de mon bénévolat au sein du centre social avec une femme fréquentant également des cours d’arabe dispensés par une association de culte que j’ai pu participer, en tant qu’apprenante cette fois, à ces cours une fois par semaine. Les liens établis avec et au sein de ces associations socio-culturelles, ont été possibles et fructueux car ma problématique de recherche rejoint les préoccupations de ces structures au sujet de ce public dit « invisible ». Particulièrement du fait du paradoxe déjà évoqué entre l’ancrage historique de ces femmes et le fait que cette « mémoire vivante des lieux » soit peu exprimée, transmise, visible, au sein des familles, des jeunes générations et du territoire. Âgées de 60 à 80 ans, les femmes participant à cette recherche vivent en France et dans la zone urbaine des Minguettes parfois depuis sa construction à la fin des années 1960 – et parfois toujours dans le même appartement.
L’expérimentation que j’ai pu faire au sein de ma recherche doctorale de cette mise en lien et en réseau par la médiation artistique de plusieurs segments tels que des associations sociales et culturelles, des femmes immigrées âgées habitantes d’un quartier populaire de Vénissieux, des artistes, des habitant.es et acteur/trices du territoire et le monde académique, avait pour but de questionner en actes ce paradoxe. Les liens entre l’anthropologue, les personnes, acteur/trices impliqué.es, ont été mis en œuvre à tous les stades de la recherche : à la fois pour collecter et analyser les données, pour en co-construire les productions scientifiques et pour les transmettre, en laisser des traces différentes de celles uniquement académiques (expositions, film) et dans des lieux autres que ceux qui y sont habituellement dédiés (médiathèque, cinéma, centres sociaux). L’« anthropologie partagée » que J. Rouch appelait de ses vœux et mettait en œuvre par le biais de ses films, possède comme étape essentielle celle du « feed-back ». Cette étape a été mise en exergue dans le cadre de mon travail par le biais d’expositions médiées par les femmes elles-mêmes dans des lieux culturels du territoire concerné et tout au long des ateliers artistiques et de recherche. Le feed-back m’a permis en tant qu’anthropologue d’être « jugé[e] sur pièce, non par un jury de thèse mais par les personnes » enquêtées elles-mêmes (Rouch, 1979, p. 69). J. Rouch ajoute qu’ainsi « l’anthropologue n’est plus l’entomologiste observant l’Autre comme un insecte (donc le niant) mais un stimulateur de connaissance mutuelle (donc de dignité) » (p. 69). Ce projet éthique et scientifique interroge nécessairement les impacts produits sur et par la posture même du/de la chercheur.euse « engagé.e » ethnographiquement (Cefaï, 2010). De plus, pour ne pas rester à l’étape de l’ambition, le partage de la recherche doit se concrétiser par un dispositif. Cette notion est définie par M. Boukala toujours au sujet du cinéma et de l’anthropologie comme « des manières de voir des manières de faire » (Boukala, 2009, p. 45). Au fil de l’ethnographie, plusieurs réflexions et questions ont émergé. Les observations-participantes et entretiens menés, l’intérêt pour mon travail exprimé par les animatrices et responsables des centres sociaux et mes réflexions relatives à ma posture et à ce qui me motive en tant que chercheuse m’ont amenée à mettre en place ce que je nomme un dispositif de recherche partagée avec les femmes rencontrées, des artistes et les acteur/trices du territoire.
Les dispositifs de recherche sont compris en tant que « processus d’investigation à hauteur d’homme [ou de femme] qui par énonciation, mise en relation, différenciation ou actualisation nous renseignent sur le façonnement de nos comportements et la construction de nos réflexions. Ils ne reflètent pas le réel, ils ne le reproduisent pas, ils le questionnent » (Boukala, 2009, p. 127). Le dispositif revient donc à un ensemble de règles, de protocoles, de stratégies, mais qui selon G. Deleuze, cité par M. Boukala, peuvent et doivent nécessairement conduire à la subjectivation car le « dispositif laisse ou rend possible […] la créativité » (Boukala, 2009, p. 45). Cette notion de dispositif permet d’assumer pleinement le caractère construit du fameux terrain de recherche qui n’existe pas par lui-même mais se constitue souvent, comme j’ai pu le montrer plus haut, à partir de la volonté première du/de la chercheur.euse et toujours dans la rencontre et confrontation entre différent.es acteur/trices à un moment et dans un temps donnés. Le terrain comme le dispositif ne sont pas le réel mais sont des manières de le questionner. Ce dispositif a donc été pensé à la fois pour permettre mon recueil de matériaux ethnographiques, pour situer ma recherche du point de vue de son utilité sociale et pour l’ancrer sur les territoires concernés. D’un point de vue éthique, il me permet d’interroger ma posture de recherche notamment vis-à-vis du processus de mise en visibilité. Que rendons-nous visible par la recherche ? Comment ? Pourquoi ? Pour qui ?
Plusieurs éléments et cheminements m’ont amenée à vouloir conduire ma recherche différemment de mes terrains antérieurs, à m’« engager ethnographiquement » (Cefaï, 2010). Issue d’une formation médico-sociale, la dimension collective du regard me semble primordiale à toute réflexion, y compris dans les recherches en sciences sociales menées encore trop souvent seul.e dans le « colloque singulier » constitué cette fois par le.la chercheur.euse et « son terrain ». Ce faisant, deux grandes questions se sont distinguées concernant la méthodologie que je souhaitais adopter pour ma recherche : comment laisser une place et inclure les femmes rencontrées dans la production de ma recherche pour que cette dernière ne serve pas qu’au cercle académique mais ait aussi du sens, voire un quelque intérêt pour elles ? Comment utiliser l’image au sein de mon travail, étant entendu que je ne suis pas moi-même photographe ?
Le recours à l’image d’une part me semblait intéressant dans cette volonté de partage, de « circularité » de la recherche au sens de J. Rouch (1979) notamment en travaillant avec des femmes qui parlent mais ne lisent pas toutes le français. Dans cette optique, au-delà de simplement réfléchir à la phase de rendu de ma recherche et du feed-back final, l’usage de l’image et de la photographie permettait de questionner en actes la construction du visible et du non visible au sujet de ces femmes. De plus, le recours à leurs photographies d’archives personnelles au sein des ateliers avec des clichés remontant à leur jeunesse a permis d’échanger, de confronter les points de vue et les parcours de vie de chacune à partir de ce qu’elles voyaient et décrivaient – les récits des unes faisant écho et stimulant ceux des autres. La richesse heuristique de ces images d’archives individuelles a permis une approche diachronique des « mises en scène » de soi (Goffman, 1973) et d’accéder aux discours produits a posteriori sur celles-ci. D’autre part, en utilisant l’image photographique et la vidéo, je craignais la reproduction des clichés – au sens propre comme figuré – cette fois « survisibles » au sujet des personnes et notamment des femmes maghrébines (Conord, 2000 ; 2007). Cela mettait concrètement en question les modes de production de l’image et les personnes qui en seraient en charge (les femmes, un.e photographe, moi-même), l’idée étant de me confronter en actes aux questions éthiques et épistémologiques que la production, la co-production, l’analyse et la diffusion d’images impliquent, de manière d’autant plus prégnante au sein d’un territoire et avec une population stigmatisé.es (Lepoutre, 2001). Ce cheminement m’a conduite à travailler avec une photographe, Bénédicte Bailly et une artiste plasticienne, Julie Martin-Cabetisch pour créer et co-animer une série d’ateliers au sein des centres sociaux des Minguettes. Là encore, le choix de travailler avec ces deux artistes en particulier, n’est pas anodin. Lorsque l’on choisit d’ouvrir « la cuisine » de sa recherche au regard d’autrui, tout comme les femmes m’ont ouvert la leur, il s’agit d’avoir confiance. Aussi, je connaissais ces deux artistes, l’une par le biais d’une formation animée en commun sur l’image dans les sciences sociales, l’autre étant une amie de longue date qui par ailleurs connaissait mon travail. Il était important pour moi, de travailler avec des artistes qui avaient une posture éthique respectueuse des personnes et étaient compétentes dans la médiation artistique avec des publics n’ayant pas forcément l’habitude de ce médium. D’autant que l’objectif n’était pas de créer une œuvre ou une installation mais bien d’accompagner le groupe de femmes dans leur propre cheminement mémoriel et créatif.
Les objectifs de ces ateliers étaient multiples : créer un espace d’expression et de création pour un groupe d’une dizaine de femmes à partir de 60 ans, recueillir leurs mémoires, leurs vécus du quartier, leur permettre de participer activement et de manière reconnue à mon travail de recherche en co-construisant les ateliers avec elles et, si elles en étaient d’accord, exposer les productions au sein du quartier. Cette dernière étape – posée au départ comme possibilité et acceptée par le groupe de femmes– avait pour objectif à la fois de transmettre cette mémoire sur le territoire, d’être un moyen de restituer le travail effectué ensemble et d’analyser la mise en œuvre et la réception de cette exposition par les femmes et leurs proches, les habitant.es et les acteur/trices du territoire (acteur/trices culturel.les, sociaux.les et politiques). Pour mener à bien ces objectifs, le dispositif de recherche partagée mis en œuvre a abouti à la co-création et co-animation de quinze ateliers de deux heures chacun de janvier à juin 2018 avec quatorze femmes d’origines principalement algérienne mais aussi marocaine et tunisienne, âgées de 55 à 80 ans. Leur familiarité avec la participation à des projets de ce type était différente au sein du groupe. Toutes les femmes faisaient ou avaient fait partie du centre social, certaines venant des ateliers d’alphabétisation, d’autres d’un groupe de parole déjà constitué depuis des années et ayant participé à des projets théâtraux par exemple. Ce que je leur proposais était un peu différent : se remémorer collectivement la vie, l’évolution, les souvenirs de leur arrivée et de leur quotidien aux Minguettes. Les premières réactions, lors de notre rencontre le 17 octobre 2017 avaient été : « Moi ma vie n’est pas intéressante. Je suis venue ici rejoindre mon mari, j’ai élevé mes enfants. C’est tout » ou encore « Nous n’avons pas des vies intéressantes, aucune ici n’a fait la guerre ». La guerre d’Algérie était évoquée par les femmes car elles avaient été sollicitées peu de temps avant par un collectif portant un projet culturel et mémoriel à ce sujet. Elles avaient refusé d’y participer. D’autre part, la date de notre rencontre n’était pas anodine en soi dans l’évocation de la guerre, le 17 octobre renvoyant au funeste soir de répression de la manifestation organisée par la Fédération de France du F.L.N.10 en 1961 sur les bords de la Seine. Date commémorée depuis plusieurs années à Vénissieux (Abdallah, 2000). Puis vint cette question toute légitime de la part du groupe de femmes : « On a compris, toi, c’est pour écrire ton livre. Mais, nous, faire une exposition, ça va nous servir à quoi ?11 ».
Au sein des ateliers centrés sur la photographie, nous avons travaillé dans un premier temps à partir de photos d’archives personnelles appartenant aux femmes. La proposition qui leur a été faite était d’amener une photographie d’un souvenir ancien de leur choix (sans leur donner de consigne précise de date ou de lieu), une prise au sein du quartier des Minguettes en extérieur et un dernier cliché cette fois dans leur domicile. Un premier temps de « photo-elicitation » (Papinot, 2007 et 2016 ; Meyer, 2017) a permis la mise en récit des photos apportées. Cette première phase des ateliers a constitué une accroche pour les femmes : « Moi j’ai aimé fouiller dans mes albums, revoir mes enfants petits », « J’ai aimé présenter mes photos aux autres », « J’ai aimé écouter les autres femmes, les plus anciennes12 ». Les tirages en noir et blanc ont chaque fois été retravaillés par elles en les re-colorisant à l’aide de peinture, perles, tissus ou encore broderie selon leurs souvenirs, chaque fois extrêmement précis. Les clichés les montraient : l’une à l’école primaire en France, l’autre à 17 ou 20 ans en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, la veille de leurs fiançailles chez le photographe, à bicyclette… Leurs tenues variaient entre jupe courte, tailleur, pantalons pattes d’éph, manteau de fourrure, « coupe de cheveux de Brigitte Bardot » ou plus tard de « Lady Diana13 ». Tout ceci m’a permis de rejoindre les conclusions de M. André au sujet des femmes algériennes à Lyon au moment de la décolonisation à partir de l’analyse des photographies dans la presse de cette époque notamment.
L’examen de leur « façade personnelle » ne laisse en rien transparaître une algérianité pittoresque […] En fait, si les femmes algériennes restèrent si longtemps invisibles, peut-être est-ce aussi, tout simplement, parce que peu de choses, dans l’apparence, les distinguaient des Françaises métropolitaines
(André, 2016, p. 47-48)
Image 1 - « Je l’ai appelée “La rencontre” car c’est le jour où j’ai rencontré mon mari14 ». Photographie prise sur la place du Pont à Lyon par un photographe professionnel en 1957.
© Les Minguettoises
Des portraits studio de certaines femmes du groupe ont également été pris par Bénédicte Bailly au cours d’une séance d’atelier, ce qui, comme pour les photos d’archives personnelles, a montré leur habitude ancienne du rituel du portrait studio chez un.e photographe, y compris dans leurs pays d’origine. Bien que longtemps occulté, cet usage du studio photographique fut très tôt répandu en Afrique. J.-F. Werner s’intéresse depuis les années 1990 en contexte sénégalais aux photographies de famille réalisées par les africain.es, notamment au sein de studios professionnels et en montre l’usage répandu bien avant les indépendances. Il insiste d’ailleurs sur la valeur heuristique de l’usage en tant qu’ethnographe de ces portraits et albums de photographies comme matériaux de recherche (Werner, 1997, 2001).
Ensuite, nous avons préparé avec elles une balade commentée dans le quartier. Elles ont cette fois choisi des lieux importants pour chacune aux Minguettes et nous avons décidé ensemble de l’itinéraire à emprunter pour rejoindre à pied chacun d’eux. À chaque point d’étape, elles ont pris des photos elles-mêmes avec l’appareil professionnel de la photographe. Les ateliers durant lesquels elles ont choisi collectivement les prises de vues à conserver pour l’exposition ainsi que leur mise en récit ont été enregistrés. Les écoles de leurs enfants qui constituaient leurs trajets quotidiens dans le quartier, où certaines ont été pendant plusieurs années représentantes des parents d’élèves, ont constitué des marqueurs récurrents dans le parcours. De même, les premiers immeubles dans lesquels elles ont habité avec leur famille ou époux à leur arrivée dans la zup ou encore le centre social qui a souvent constitué un point d’ancrage pour elles-mêmes, parfois tardivement, au décès de leurs maris notamment. Des repères partagés au sein de leur mémoire collective donnaient lieu à des remémorations d’anecdotes et de souvenirs : la chaufferie municipale et sa grande cheminée qui fume en permanence, le château d’eau que l’on voit depuis Fourvière15 ou encore la barre d’immeuble des employés de la SNCF du quartier Monmousseau16 sur le point d’être détruite.
Image 9 - « La 102, c’était la tour des amoureux. Les jeunes se cachaient ici pour s’embrasser tranquillement17 ». Photographies prises par Les Minguettoises, quartier Monmousseau, Les Minguettes, 20 mars 2018.
© Les Minguettoises
En parallèle, des cartes mentales ont été réalisées collectivement à partir de grandes feuilles blanches et d’une légende commune. Ces cartes au nombre de cinq représentaient l’évolution du quartier en 50 ans. Les femmes du groupe sont arrivées à des périodes différentes au sein des Minguettes. Les décalages chronologiques ont donné lieu à des échanges entre les plus anciennes et les plus nouvellement arrivées sur le quartier, les amenant à détailler et préciser davantage leurs souvenirs. Ces dessins collectifs de leurs mémoires, au départ individuels, des lieux ont fait émerger des interactions soit du fait de désaccords entre elles, par exemple sur les emplacements ou itinéraires, sur les lieux retenus par les unes et pas par les autres, et sur la remémoration collective d’un nom de lieu qui devenait alors important – comme cet ancien café du centre commercial aujourd’hui détruit, Le Marco Polo. Nous avons complété ce travail de recherche par un temps collectif aux archives municipales de la ville de Vénissieux pour trouver et sélectionner des photos d’archives officielles du quartier. Au sein des clichés exposés, nous avons mêlé « petite et grande histoires », photos d’archives intimes, personnelles et photos officielles. Dans une expérience de recherche assez similaire au sein du quartier de La Duchère toujours dans l’agglomération lyonnaise, B. Botea parle de « grand » et « petit » patrimoine :
À la différence de ce « grand » patrimoine [entendu ici comme le patrimoine bâti, architectural], il en existe un « petit », du quotidien, lié à des expériences de vie, à des mémoires et attachements. C’est celui des petits squares en bas des immeubles, des « murettes », et des petits commerces de la galerie marchande, appelée par les Duchérois le « centre commercial
(Botea, 2014)
Image 13 - Vue aérienne de la zone urbaine des Minguettes au début de sa construction dans les années 196018.
© Archives de la mairie de Vénissieux
Évidemment j’aurais pu accéder à une partie de ce matériau sans forcément avoir recours aux ateliers collectifs. En me cantonnant à des entretiens ou des récits de vie uniquement individuels, puis en tentant de reconstituer seule, in vitro, cette mémoire collective et les liens qui tissent ces récits entre eux. Ce faisant, nous pouvons nous demander ce que ce dispositif apporte en plus vis-à-vis d’une observation plus individualisée et donc moins partagée. D’abord, les temps d’ateliers m’ont permis d’accéder à une mémoire collective en train de se retracer, me donnant du même coup accès aux points de jonctions et disjonctions entre mémoires intimes, privées et mémoires collectives et officielles, dans des échanges autour de l’évolution des codes vestimentaires ou de l’image de soi selon les époques et l’avancée en âge. Il en a été de même au cours de la sélection des photographies qu’elles ont menée pour savoir ce qu’elles souhaitaient montrer et ne pas montrer dans l’exposition. Les portraits, qui lors de la prise de vue ont suscité l’enthousiasme, ont créé du débat au sein du collectif de femmes pour savoir s’ils feraient partie ou non de l’exposition. L’argument d’être reconnues dans le quartier, les « on-dit » ont été abordés, les réprimandes présumées de la part de leurs enfants ou époux pour celles qui en ont encore un. Certaines voyaient dans l’affichage de leurs portraits une occasion de fierté quand pour d’autres cette mise en visibilité pouvait susciter un sentiment de gêne, voire de « honte ». Finalement, elles ont décidé qu’ils feraient partie de l’exposition en se disant que la succession de clichés exposée sous forme de galerie de portraits les identifiait en tant que groupe et non pas uniquement individuellement. Avec le recul, plusieurs parmi les réfractaires initiales, me dirent leur fierté à la vue de leur image dans la médiathèque et au cinéma de la ville : « D’habitude je n’aime pas ma tête en photo, mais là, je ne me suis jamais trouvée aussi belle », « Quand j’ai vu Touria écrit avec un grand T. dans le journal, j’étais tellement fière, je l’ai montré à tous mes enfants !19 » . La mise en exposition et leur médiation que ce soit à la médiathèque ou au cinéma de Vénissieux20 m’ont donné accès à la réception par les habitant.es et acteur/trices du territoire et à la manière dont les femmes présentaient leur travail aux différent.es visiteur.teuses. Beaucoup de visiteur.teuses, jeunes et moins jeunes ont été ému.es par l’exposition qui leur remémorait de nombreux souvenirs « du quartier ». Pour elles.eux, voir les images d’archives de leur quartier et écouter la parole de ces femmes que beaucoup nommaient « les mamans du quartier » était très valorisant. Un des personnels de la médiathèque m’expliquait par exemple son émotion face à ces photographies et au dialogue qui en avait émergé avec ses propres collègues qui n’étaient pas issu.es des Minguettes.
Cet engouement majoritaire n’a bien sûr pas été sans paradoxe. Le fait que le projet ait été financé par le grand projet de ville et que les expositions aient été faites sur le territoire m’a permis d’accéder aux discours des acteur/trices associatif.ves, institutionnel.les et politiques quant à la mise en visibilité des femmes et de leur mémoire dans l’espace public. Une interaction intéressante a eu lieu face au choix des femmes de nommer leur groupe et l’exposition : « Les Minguettoises ». Ce nom a été inventé par une des femmes du groupe lors de nos déambulations photographiques dans le quartier. Lorsqu’elles ont dit vouloir nommer l’exposition ainsi, un agent en lien avec la municipalité m’a interpellée m’expliquant que ce titre était trop stigmatisant car justement la mairie était dans une dynamique de « sortir de l’histoire et du stigmate des Minguettes ». Ceci alors même que pour les femmes ce nom et leur quartier sont valorisants et qu’elles sont a contrario dans une dynamique de retournement de ce stigmate. Lorsque j’ai rapporté aux femmes cet échange téléphonique, elles ont décidé de maintenir ce nom : « Je suis Minguettoise, j’ai vécu plus ici qu’à Tunis21 », « J’ai grandi aux Minguettes, les Minguettes c’est mon pays !22 ». Toutes ces interactions et données sont bien issues du dispositif lui-même.
Concernant mon positionnement de recherche, la collaboration avec les artistes et acteur/trices du territoire m’a permis de renégocier et préciser ma place de chercheuse auprès des femmes rencontrées. L’une des difficultés que j’avais identifiée dans mes premiers temps de terrain, était justement la confusion pour mes interlocuteur/trices entre les différentes identités sous lesquelles l’on me présentait, que celles-ci soient réelles ou fictives : infirmière, anthropologue, étudiante, bénévole, professeure de français, future convertie à l’islam… Ceci alors même que je présentais toujours et régulièrement la recherche que je menais et la finalité de l’écrit. À ce propos, A. Di Triani parle de « faire intrusion » (2008, p. 246) au sujet de sa recherche dont une partie s’est déroulée après le 11 septembre 2001 dans une synagogue au sein du ghetto de Venise en Italie. Dans son cas, sa présence en tant que chercheuse au sein du ghetto et de la synagogue fut jugée par certain.es comme suspecte et indésirable. L’auteure décrit la division de la communauté vivant au sein du ghetto au sujet de sa présence et les rumeurs la concernant (espionnage, conversion au judaïsme…). Dans le contexte de ma recherche, c’est finalement la collaboration avec les artistes qui m’a permis d’être mieux identifiée comme « celle qui écrit une thèse » ou « un livre sur nous ». Ainsi, les rôles et identités de chacune au sein des ateliers étaient bien repérés. Pour autant, mettre en œuvre ce dispositif m’a conduite à mobiliser du temps et des compétences au-delà de la recherche doctorale en tant que telle. Il a fallu rechercher des financements pour le matériel et la rémunération des artistes, être l’interlocutrice des différent.es partenaires, remplir des dossiers administratifs, trouver des lieux pour l’exposition, en faire la promotion, et très concrètement le montage. Le dispositif de recherche partagée mis en place par le biais des ateliers et de la réalisation de ces expositions a permis de proposer et d’acter le « cadre de la rencontre » en utilisant avec les femmes « la pratique de la photographie elle-même [ici entendue au sens large] comme lieu de rencontre anthropologique » (Antoniadis, 2000). Contrairement aux premiers temps de terrain basés sur une approche plus classique en termes d’entretiens et d’observation participante, le cadre des ateliers et leur dimension co-construite a permis aux femmes d’avoir prise sur la recherche elle-même et d’en clarifier les contours. Lors de mes premiers échanges aux Minguettes, lorsque j’évoquais avec les femmes rencontrées ou leur entourage la discipline anthropologique les réponses étaient sans appel : « Anthropologue c’est l’étude des tribus…bah les tribus, c’est nous là… ». À cette vision répandue, au-delà des Minguettes, de l’anthropologie comme une discipline coloniale et exotisante qu’elle fut aux premiers temps de son institutionnalisation (Bensa, 2010) s’ajoutait l’expression d’une certaine saturation vis-à-vis de « sociologues ou anthropologues qui font leur étude et dont on n’entend plus jamais parler ». Le dispositif et ses ateliers a permis de sortir en tout cas en partie de ces deux écueils en posant un calendrier, des objectifs, des modalités et des finalités communes. Le fait d’orienter les ateliers vers la mémoire du quartier et non vers le pays d’origine a permis de sortir de l’impasse culturaliste par laquelle ces femmes sont souvent catégorisées comme gardiennes d’une tradition imaginée. D’autant qu’à la saturation vis-à-vis des chercheurs s’ajoutait une saturation due à la médiatisation péjorative des Minguettes et des musulman.es. Ici réside un des paradoxes des processus liés à l’(in)visibilisation sociale. Si les femmes rencontrées sont dites invisibles au sein des structures et des recherches, la zup des Minguettes a été survisibilisée politiquement et médiatiquement au début des années 1980. Lieu d’émergence et de départ de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, c’est surtout sous l’angle des violences, de la délinquance et du communautarisme que ce territoire et ces habitant.es sont régulièrement mis.es sous les feux des projecteurs. Le dispositif de recherche et sa dimension partagée mis en place sur la longue durée avec les femmes leur ont permis d’avoir une prise et des gages de confiance sur tous ces aspects.
Au sein de cette co-création, nous pouvons nous demander ce que ce dispositif fait aux participant.es et inversement. Il est encore tôt pour répondre de manière approfondie à cette question. Il est néanmoins sûr que les participantes ont mis plusieurs séances à « s’approprier » le dispositif, à voir où les ateliers les menaient et surtout quelle part de décisions elles pouvaient y prendre. Mais petit à petit elles ont progressivement pris une place dans la construction des ateliers et dans la démarche même de recherche. Elles ont d’elles-mêmes proposé de venir avec moi aux archives municipales et de renommer l’exposition et le groupe. Dans les sélections d’images et la mise en texte ou encore dans l’élaboration des cartes mentales, elles ont été très actives et claires dans leurs choix. Comme l’explicite M. Meyer, « le “jeu” des images fournit un amortisseur pour une relation d’enquête parfois marquée par l’incertitude des enquêtés quant aux buts visés par le sociologue » (Meyer, 2017). La configuration collective des ateliers a permis de renverser en partie du moins, la dissymétrie des rapports de pouvoir chercheuse/enquêtée. De même, elles ont participé activement aux réunions pour défendre ou parler du projet ou encore au vernissage et à la médiation des expositions. Si au départ des ateliers, elles me disaient ne pas savoir ce qu’elles pourraient mettre dans une exposition à leur sujet et ce que cela pourrait leur apporter, au bout d’un an de travail collectif, elles ont fait leur ce projet et veulent le transmettre notamment aux plus jeunes. Un film sur l’exposition a été réalisé dans cette visée par un groupe de jeunes du centre social et en lien avec l’association Tillandsia23. Ce dispositif de recherche a permis de renforcer ou créer des liens d’amitié entre elles car toutes ne se connaissaient pas au départ. Il a également éveillé la volonté d’assister avec moi à des conférences sur l’immigration, la guerre d’Algérie ou la Marche pour l’égalité. Je ne suis évidemment pas à l’origine de tout cela, c’est bien elles qui en sont les actrices. Le lien avec les artistes a été très riche même si pas toujours aisé. Là encore dans ce type d’entreprise collective, les représentations, les codes, les manières de voir et de faire sont différentes et demandent des capacités d’adaptation de part et d’autre. Par exemple, les lieux d’exposition ont demandé beaucoup d’ajustements et de compromis par rapport aux scénographies initialement envisagées par les artistes. Malgré des contraintes inévitables, les images, les cartes et les textes produits sont vraiment une création collective pour laquelle chacune, habitante, artiste et anthropologue, a apporté sa matière et son regard.
Comme j’ai tenté de l’expliciter ici, le dispositif de recherche partagée mis en œuvre a été à plusieurs titres fructueux pour ma recherche. Pour autant, subsiste un certain nombre de questions notamment quant aux limites et aux risques de récupération institutionnelle et politique induits par le financement et la mise en visibilité des femmes du groupe et de leurs créations au sein du territoire. Depuis les expositions, j’ai été sollicitée pour intervenir lors de la journée des droits des femmes organisée par la mairie ou encore interpellée par d’autres étudiant.es, associations, ou individu.es pour rencontrer les femmes du groupe. Ces sollicitations m’ont questionnée sur leurs manières de faire et de me placer comme intermédiaire. À cet égard, le fait que le centre social soit présent dans le projet facilite la prise de recul face à ces demandes. La réalisation des ateliers et les mises en expositions m’ont permis de questionner en actes la visibilité et l’invisibilité sociale ainsi que leurs mécanismes, et de les expérimenter en m’incitant à interroger mon propre positionnement et mes propres choix méthodologiques et éthiques dans ce processus. En ce sens, des autorisations de droit à l’image ont été signées par les femmes. Les photographies et les cartes sont la propriété du groupe, et pas la mienne ni celle des artistes.
Enfin, ce dispositif ne doit pas pour autant m’éloigner de ma problématique de recherche au sujet de l’invisibilité sociale de ces femmes mais bien la nourrir. Il m’a permis d’opérer un « glissement heuristique » me faisant passer d’une enquête sur les processus de visibilité de ces femmes dans l’espace social à une enquête sur et par le visuel : les clichés (au sens propre comme figuré) produits par et sur ces femmes (Meyer, 2017). Il s’agit donc avec beaucoup d’humilité et de « bricolages pragmatiques » (Miran, 2010), d’« associer satisfaction intellectuelle, enthousiasme devant une intuition, plaisir de voir s’échafauder un raisonnement d’une part, et partage de ce savoir d’autre part » (Vidal, 2016). La recherche menée avec et par les femmes et leurs images a permis de déployer, en les cadrant et en les enrichissant, des temps de rencontres et d’apprentissages mutuels et partagés.
1 La zone urbaine des Minguettes est située à Vénissieux au sud de Lyon. Construite de 1965 à 1975, cette zone d’habitat social appelée à cette époque « zup » (zone à urbaniser en priorité) était vouée principalement à loger les populations immigrées et résorber les bidonvilles de l’agglomération lyonnaise. L’appellation et la conception des « zup » est issue du décret no 58-1464 du 31 décembre 1958. L’État les nomme aujourd’hui « quartier politique de la ville » mais les habitant.es continuent pour certain.es à utiliser l’acronyme zup pour désigner les Minguettes.
2 Propos recueillis à Vénissieux en 2013.
3 Propos recueillis à Vénissieux, 27 février 2013.
4 Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 1er janvier 2011.
5 Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 1er janvier 2019.
6 Un deuxième terrain de recherche a été réalisé au sein du quartier Belsunce à Marseille à partir d’octobre 2018 mais il ne sera pas abordé dans cet article.
7 Termes utilisés par l’association pour désigner les femmes âgées et immigrées aidées par l’association.
8 Propos recueillis à Vénissieux, 10 avril 2013.
9 Cefaï, 2010.
10 Front de Libération National.
11 Propos recueillis à Vénissieux, 17 octobre 2017.
12 Propos recueillis à Vénissieux, mars 2018.
13 Propos recueillis à Vénissieux, janvier 2018.
14 Les images de cette série de photographies anciennes sont accompagnées de verbatim recueillis lors des ateliers réalisés de janvier à mars 2018 dans lesquels chaque femme racontait son cliché.
15 La basilique de Fourvière est située en hauteur dans le centre-ville de Lyon et constitue un point de vue sur toute l’agglomération.
16 Le quartier Monmousseau est l’un des treize quartiers de la zone urbaine des Minguettes. Il est également le premier à avoir été construit et la majorité des femmes rencontrées ont vécu dans ce quartier lors de leur arrivée aux Minguettes.
17 Les images de cette série sont accompagnées de verbatim recueillis lors des ateliers le 3 avril 2018.
18 Contrairement aux photographies personnelles des femmes dont celles-ci ont un souvenir extrêmement précis, les dates de cette série de photographies officielles sont majoritairement approximatives car les clichés archivés n’étaient pas datés.
19 Propos recueillis à Vénissieux, 13 mai 2019.
20 L’exposition Les Minguettoises : elles nous racontent leurs Minguettes a été présentée du 18 au 29 septembre 2018 dans le cadre du jour du livre [en ligne : http://www.bm-venissieux.fr/events/elles-nous-racontent-leur-minguettes/]. Puis l’exposition a été reprise du 7 novembre au 1er décembre 2018 au cinéma Gérard Philipe dans le cadre de la biennale Traces, Histoire mémoires actualités des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes [en ligne : http://traces-migrations.org/2018/09/25/minguettes/].
21 Propos recueillis à Vénissieux, 20 mars 2018.
22 Propos recueillis à Vénissieux, 20 février 2019.
23 Tillandsia est une association lyonnaise qui réunit des professionnels et des amateurs du cinéma documentaire, de l’audiovisuel et des sciences humaines.
ABDALLAH Mogniss H. (2000) « Le 17 octobre 1961 et les médias. De la couverture de l'histoire immédiate au "travail de mémoire" », Hommes et Migrations, 1228, L'héritage colonial, un trou de mémoire, pp. 125-133.
AGGOUNE Atmane (2009), Enquêter auprès des migrants. Le chercheur et son terrain, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales ».
AGIER Michel (2004), La sagesse de l’ethnologue, Paris, L’Œil neuf.
AIT BEN LMADANI Fatima (2007), La vieillesse illégitime ? Migrantes marocaines en quête de reconnaissance sociale, thèse de doctorat, Paris, Université Paris Diderot.
ANDRÉ Marc (2016), Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation, Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, espaces, temps ».
ANTONIADIS Leonardo (2000), « Chronique visuelle d’une migration tsigane. Une expérience de la photographie : outil de recherche, et/ou lieu de rencontre et d’interrogation », Journal des anthropologues, 80-81, p. 117-142.
ATTIAS-DONFUT Claudine (dir.) (2006), L’enracinement. Enquête sur le vieillissement des immigrés en France, Paris, Armand Colin.
BENSA Alban (2010), Après Lévi-Strauss, pour une anthropologie à taille humaine, Paris, Éditions Textuel, 128 p.
BOTEA Bianca (2014), « Expérience du changement et attachements. Réaménagement urbain dans un quartier lyonnais (la Duchère) », Ethnologie française, 44 (3), p. 461-467.
BOUKALA Mouloud (2009), Le dispositif cinématographique, un processus pour [re]penser l’anthropologie, Paris, Téraèdre.
CEFAÏ Daniel (dir.) [2010], L’engagement ethnographique, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. « En temps et lieux ».
CHAOUITE Abdellatif (2011), « Éditorial » [du thématique « Le vieillir-ensemble. Des femmes immigrées dans la cité »], Écarts d’identité, 118, p. 1.
CONORD Sylvaine (2000), « “On va t’apprendre à faire des affaires…” Échanges et négoces entre une anthropologue-photographe et des juives tunisiennes de Belleville », Journal des anthropologues, 80-81, p. 91-116.
CONORD Sylvaine (2007), « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française, 37, p. 11-22.
DI TRIANI Antonella (2008), « Travailler dans des lieux sensibles. Quand l’ethnographie devient suspecte », in BENSA Alban, FASSI Didier (dir.), Les politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte, p. 245-260.
GALLOU Rémi (2016) « Vieillir sans conjoint mais vieillir entourées : un défi pour les femmes immigrées », Gérontologie et société, 38 (149), p. 105-123.
GOFFMAN Erving (1973), La mise en scène de la vie quotidienne. Vol. 1 : La présentation de soi, 1re éd. 1959, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun ».
KUCZYNSKI Liliane, RAZY Élodie (2009), « Anthropologie et migrations africaines en France : une généalogie des recherches », Revue européenne des migrations internationales, 25 (3), p. 79-100.
LAACHER Smain (2014), Femmes immigrées. L’entrée dans la vieillesse, Evry, Centre de ressources Politiques de la ville en Essonne, [en ligne] http://www.crpve91.fr/Publications/Vieillesse_femmes_immigrees.pdf.
LEPOUTRE David (2001), « La photo volée. Les pièges de l’ethnographie en cité de banlieue », Ethnologie française, 31, p. 89-101.
MEYER Michaël (2017), « La force (é)vocative des archives visuelles dans la situation d’enquête par entretiens. Une étude par photo-élicitation dans le monde ambulancier », Revue française des méthodes visuelles, 1, [en ligne] http://rfmv.fr/numeros/1/articles/la-force-evocative-des-archives-visuelles-dans-la-situation-d-enquete-par-entretiens/.
MIRAN Marie (2010), « Quand ethnologue et imam croisent leurs plumes. Récit d’un voyage au pays de l’anthropologie collaborative », Cahiers d’études africaines, 50 (198-200), p. 951-980.
MOROKVASIC Mirjana (2011), « L’(in)visibilité continue », Cahiers du Genre, 51, p. 25-47.
PAPINOT Christian (2007), « Le “malentendu productif”. Réflexion sur la photographie comme support d’entretien », Ethnologie française, 37, p. 79-86.
ROUCH Jean (1979), « La caméra et les hommes », in FRANCE Claudine de (dir.), Pour une Anthropologie visuelle, La Haye, Mouton, p. 53-71.
VIDAL Laurent (dir.) [2016], Les savoirs des sciences sociales. Débats, controverses, partages, Paris, IRD Éditions, coll. « Colloques et séminaires ».
VOIROL Olivier (2005), « Présentation. Visibilité et invisibilité : une introduction », Réseaux, 129-130, p. 9-36.
WERNER Jean-François (1997), « De la photo de famille comme outil ethnographique. Une étude exploratoire au Sénégal », L’Ethnographie, 97 (2), p. 165-178.
WERNER Jean-François (2001), « Le studio photographique comme laboratoire d’expérimentation sociale », Africultures, 39, p. 37-46.
Julie Leblanc, « Quand les 'Minguettoises' s’exposent. Retour sur un dispositif de recherche partagée », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 4 | 2021, mis en ligne le 13 janvier 2021, consulté le . URL : https://rfmv.fr