

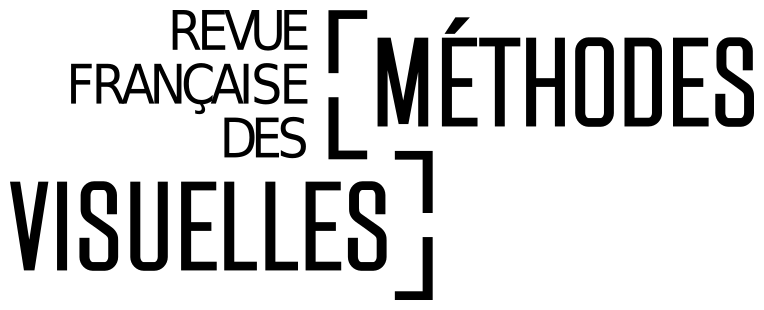
François Duchêne, Chargé de recherches, EVS-RIVES, ENTPE, UMR CNRS 5600, Université de Lyon
Dans les recherches en SHS, les photographies servent principalement à objectiver le réel. Mais au-delà de cet usage, comment dépasser l’image illustrative pour faire de la photographie, avec ou sans le photographe, un objet en capacité de produire des résultats de recherche à part entière ? Comment, en tant que chercheur en SHS, travailler de façon productive avec des photographies et des photographes ? Nous explorons ici ces questions en revenant sur une recherche concernant le quartier dit « des cantonnements », ancienne cité ouvrière dédiée au logement des familles migrantes salariées de l’usine chimique voisine, des années 1920 jusqu’aux années 1960. Nous analysons, dans une perspective heuristique, deux apports différents de la photographie dans cette recherche : d’une part, l’analyse d’un corpus de clichés de famille de ce quartier, effectuées entre les années 1930-1960 et collectées par le comité d’entreprise de l’usine ; d’autre part, l’analyse des effets sur la recherche de protocoles photographiques mis en œuvre avec d’anciens habitants de ce quartier au XXIe siècle. L’analyse des seconds plans du premier corpus révèle que ce quartier des étrangers se situait « au plus bas de l’échelle » du système paternaliste de logements de l’usine chimique voisine. Par ailleurs, à l’aide de plusieurs protocoles mis en œuvre avec un photographe contemporain, nous avons pu rendre compte de l’absence de traces ou des oublis de ce quartier, enfoui depuis sous l’expansion de la plateforme chimique voisine.
Mots-clés : Cantonnements, Migration, Usine chimique, Photographies de famille, Protocole photographique
In HSS research, photographs are often used above all to objectify reality. But beyond that, how can we go beyond the illustrative image, to make photography, with or without the photographer, an object able to produce full-fledged research results? How, as an HSS researcher, to work productively with photographs and with photographers? Here we explore these questions with a research concerning the so-called “cantonments” neighborhood, an old workers’ housing estate devoted to the housing of migrant wage-earning families from the nearby chemical factory, from the 1920s to the 1960s. We analyze, in heuristic perspective, two different contributions of photography to this research: on the one hand, the analysis of a corpus of pictures of families in this neighborhood, taken between the 1930s and the 1960s, and collected by work council of the factory; on the other hand, the analysis of the effects on research of photographic protocols implemented with former inhabitants of this district, in the 21st century. Analysis of the second plans of the first corpus reveals that this district of foreigners was “at the bottom of the ladder” of the paternalistic housing system of the nearby chemical factory. In addition, using several protocols implemented with a contemporary photographer, we were able to account for the absence of traces or omissions from this neighborhood
Keywords : Cantonments, Migration, Chemical plant, Family photographs, Photographic protocol
L’image photographique, pourtant née concomitamment avec la sociologie dans le milieu du XIXe siècle, a peiné et peine sans doute encore à être utilisée comme outil explicatif des phénomènes sociaux. La discipline sociologique s’est construite et a appuyé ses méthodes d’enquête avant tout sur la parole, l’écrit et la quantification (Vander Gucht, 2017), délaissant l’image en tant qu’outil d’investigation parce que considérée comme peu objectivable dans une approche positiviste de la science (Bouldoires et al., 2017). Ainsi, la photographie a longtemps été utilisée avant tout dans sa dimension illustrative (De Verdalle et Israël, 2002), comme preuve d’une réalité observée, et en quelque sorte dans une fonction supplétive de « “sherpa” de l’écrit » (De Latour, 2018, p. 169).
Pour autant, même s’il persiste encore une certaine occultation des approches visuelles dans les méthodes couramment prônées pour l’enquête sociologique (Maresca et Meyer, 2013), on note une évolution dans l’intérêt pour les travaux de photo-ethnographie et d’anthropologie ou de sociologie visuelle. May Du et Mickaël Meyer relèvent par exemple que « la revendication des images comme des “données” (data) à part entière a constitué le cœur de ce qui peut sembler un renouveau de l’intérêt pour le développement des méthodologies des images en sciences sociales » (2009, p. 3). De fait, la question de l’usage de la photographie et plus largement de données visuelles dans les sciences sociales a progressivement donné lieu à la structuration d’un champ de recherche, d’abord dans le monde anglo-saxon dès les années 1970 (Collier, 1967 ; Becker, 1974, 1981) regroupé aujourd’hui dans les visual studies, puis plus récemment en France avec des travaux se reconnaissant dans la sociologie visuelle1. On peut définir cette dernière comme « toute forme de sociologie mobilisant des images, principalement photographiques et filmiques, et leur accordant un statut central dans la logique de l’investigation et/ou de l’argumentation sociologiques » (Chauvin et Reix, 2015, p. 19). Il semble en effet que les photographies utilisées dans la recherche en SHS puissent dépasser la seule fonction d’objectivation du réel, en s’érigeant comme l’une des techniques d’enquête à part entière.
C’est du moins l’hypothèse faite ici, à propos de l’étude d’un ancien quartier industriel, aujourd’hui détruit, abritant autrefois exclusivement des familles de travailleurs migrants d’une usine chimique voisine. Nous souhaitons en effet rendre compte d’une recherche effectuée sur la mémoire de ce quartier, dans laquelle nous avions largement mobilisé l’usage de la photographie. Il s’agit en particulier d’analyser et de mettre en perspective deux corpus photographiques concernant les habitants et les paysages de ce quartier. Le premier a été réalisé sur plusieurs décennies par des habitants de cette cité ouvrière lorsqu’elle était active. L’autre a été produit à la fin de la décennie 2000 par un photographe, s’appuyant sur des protocoles conduits avec d’anciens habitants, individuellement chez eux, et de retour en groupe sur les lieux aujourd’hui en friche. Au-delà de simples « data », que nous apprennent ces deux corpus de clichés à propos des lieux de vie de ces migrants dans l’espace industriel produit par leur usine, de leur vécu et de leur parcours résidentiel ? Autrement dit, comment dépasser l’image illustrative dans une recherche en SHS, pour faire de la photographie, avec ou sans le photographe, un objet en capacité de produire des résultats de recherche à part entière ? L’image peut-elle également revendiquer une fonction démonstrative (Pezeril, 2008) et quel peut être son poids dans une argumentation scientifique (Conord, 2016) ? Comment, en tant que chercheur en SHS, travailler de façon productive avec des photographies et avec des photographes ? Une autre question concerne plus spécifiquement la vie et les multiples usages du corpus photographique constitué des photographies de famille : par qui et comment ces images changent-elles de statut, passant d’un usage familial à un dévoilement public à usage collectif ? Sur le plan méthodologique, nous distinguerons ici les deux corpus étudiés, usant pour le premier d’une approche de géographe sociale sur les images (« une lecture des contenus mis en forme en vue d’en extraire le sens et de le rapporter aux contextes de production et de consommation ») et pour le second, d’une approche en images (« la phase de la restitution des analyses par les images, c’est-à-dire l’exploitation des possibilités expressives des images en vue du partage des connaissances acquises ») (Maresca et Meyer, 2013, p. 25-27).
Nous souhaitons en premier lieu présenter rapidement ce quartier dit « des cantonnements », ses conditions de production et d’existence ainsi que le contexte de l’enquête concernant ses anciens habitants. Puis nous rendrons compte de l’intérêt du corpus de photographies d’habitants pour l’analyse de ce quartier dans son espace local. Nous nous attacherons aussi aux « différentes vies » de cet ensemble photographique. Enfin nous évoquerons l’intérêt de protocoles photographiques mis en œuvre dans cette enquête pour dire tant les douleurs mémorielles que la fusion discrète de cette première génération de migrants dans son espace social local.
Lors de la première guerre mondiale, la Société chimique des usines du Rhône (SCUR), future Rhône-Poulenc, implanta une importante usine de guerre à Roussillon, dans l’Isère rhodanienne. Il s’agissait de fournir une commande d’État en matière de phénol (intervenant dans la fabrication d’explosifs) puis de gaz Ypérite (autrement appelé gaz moutarde). Pour combler un manque de main-d’œuvre, partie au front, les autorités ont fait couramment appel, dans les usines de guerre, à la main-d’œuvre féminine locale, à des prisonniers de guerre puis à des travailleurs étrangers. Ces derniers ont été recrutés dans des pays non belligérants et dans l’empire colonial français. Ils ont été couramment logés dans des « cantonnements » conçus de façon provisoire pour l’occasion.
À Roussillon, à la fin de la première guerre mondiale, la SCUR a converti sa production à des fins civiles et l’usine s’est étendue. Du coup, la direction de la SCUR – et celle de l’usine textile Rhodiaceta voisine, toutes deux bientôt fusionnées dans le groupe Rhône-Poulenc – ont bâti progressivement un système de logements pour leur personnel, selon une hiérarchisation courante dans les managements paternalistes : cités ouvrières, lotissements spécifiques pour l’encadrement intermédiaire, maisons d’ingénieurs. Dans cet ensemble, le principal cantonnement issu de la première guerre mondiale a été réactivé et pérennisé à partir des années 1925 pour y loger spécifiquement la main-d’œuvre étrangère de l’usine (Duchêne, 2002). Ce quartier a gardé tout au long de son existence son nom ancien de « cantonnements2 ». Il a accueilli jusqu’à environ 400 familles espagnoles et portugaises, ainsi que plus ponctuellement des hommes célibataires nord-africains (Algériens) et indochinois (Vietnamiens).
D’un point de vue étymologique, le cantonnement est, depuis le XVIIe siècle, le « lieu où cantonnent les troupes », c’est-à-dire un lieu déterminé où l’autorité militaire « établit et fait séjourner des troupes », selon l’art antique de la castramétation (du latin castra, camp, et metari, mesurer), consistant à choisir et à disposer l’emplacement d’un camp3. Le terme va être ravivé lors de la première guerre mondiale, pour qualifier le logement des ouvriers étrangers et coloniaux, dont la venue a été organisée par l’État pour travailler sur « l’autre front » (Fridenson, 1977), celui de l’industrie de guerre. Issus d’une technologie militaro-industrielle, alliant l’État et les industriels concernés, ces préfabriqués de bois, de tôle et de briques ont été conçus par l’intendant militaire Adrian pour être facilement reproductibles et rapidement construits, souvent par leurs habitants eux-mêmes. Ils permettaient de loger jusqu’à environ soixante hommes, dans une sorte de grand dortoir pouvant contenir des lits superposés. Leur emplacement se situe fréquemment sur les emprises foncières des usines, au cœur même de la production industrielle.
Pensée comme une technologie de guerre, c’est-à-dire a priori provisoire, une partie de ces cantonnements a pourtant été recyclée en cités ouvrières après la première guerre mondiale, généralement pour loger des ouvriers migrants et leur famille. Il en a existé plusieurs dans les anciennes régions mobilisées pour produire une industrie de guerre, comme à Saint-Chamond (42) autour des aciéries, à Saint-Fons et Lyon-Gerland (69) autour des arsenaux, ou encore au Creusot (71) autour des installations sidérurgiques. À Salaise-sur-Sanne, commune mitoyenne de Roussillon et sur laquelle l’actuelle plateforme chimique s’est étendue depuis, les cantonnements ont logé des familles étrangères depuis le milieu des années 1920 jusqu’au milieu des années 1960, c’est-à-dire jusqu’à la destruction progressive de ces bâtiments. Beaucoup d’habitants ont été relogés localement. Et le souvenir de ces cantonnements est progressivement tombé dans un oubli collectif, même s’ils restaient vifs dans les mémoires familiales des personnes concernées.
Dans le courant des années 2000, nous avons mené une recherche portant sur ces anciens quartiers de migrants, sur leur isolement d’abord et sur leur oubli ensuite dans les processus locaux de production d’une mémoire industrielle et ouvrière (Duchêne et Godard, 2008). Vincent Veschambre rappelle en effet que le « discours globalisant du “bien commun” […] tend à occulter les capacités inégales des différents groupes sociaux à laisser une trace et à s’approprier les espaces les plus prestigieux » (2002, p. 65). Sur le terrain de Salaise-sur-Sanne, l’enquête portait en effet sur une cité disparue, la seule qui avait été détruite dans le système hiérarchisé de logements construits et longtemps gérés par Rhône-Poulenc dans l’agglomération roussillonnaise. Nos sources, éparses et clairsemées compte tenu de l’objet même et de son éloignement dans le temps, ont consisté, d’abord, à dépouiller des archives écrites, principalement les délibérations de conseils municipaux des communes de cette agglomération iséroise (Roussillon, Salaise-sur-Sanne, Péage-de-Roussillon et Saint-Maurice-l’Exil), mais aussi des archives départementales et les procès-verbaux du comité d’entreprise de l’usine voisine. Nous avons de même effectué une trentaine d’entretiens semi-directifs auprès d’une population vieillissante ayant passé son enfance dans les cantonnements. Et puis nous avons pu disposer d’environ 270 photographies collectées auprès de familles ayant vécu dans les cantonnements salaisiens. Ces photographies, sorties de tiroirs des commodes familiales, rendaient ainsi compte de vies de famille dans ce quartier de migrants et dévoilait « ce que ses photographes [amateurs] veulent nous donner à voir » (Lemire et Samson, 2003, p. 7). Il s’agit pour l’essentiel de photographies privées, réalisées dans le cercle familial ou amical et « produites dans le seul but d’être utilisées dans le cercle privé, de ne pas être rendues publique » (Busson, 2013, p. 93). Toutefois, s’ajoutent aux photographies familiales collectées quelques images communicationnelles probablement récupérées au sein de l’entreprise, telles des vues aériennes, des photos de chantiers en cours ou des photomontages de l’expansion prévue dans les années 1950 pour le site industriel.
En effet, la commission culturelle du comité d’entreprise de Rhône-Poulenc Roussillon, à majorité CGT, avait lancé l’initiative, dans les années 1990, de collecter auprès des salariés actifs et retraités de la plateforme chimique des photos familiales qui avaient pour décor ces cantonnements. Il s’agissait, pour l’animateur culturel du comité, de l’un des projets visant à exhumer une mémoire locale de l’immigration, en l’occurrence majoritairement espagnole. Il a lancé une petite annonce dans le journal du comité d’entreprise par laquelle il se proposait de collecter des photos de famille en lien avec le cantonnement. Son article est resté sans suite, il n’a eu aucun retour. Puis en 1998, l’animatrice culturelle qui lui a succédé a relancé l’opération. La commission culturelle du comité souhaitait en effet réagir de cette manière à la montée locale du vote Front national. Elle faisait l’hypothèse que les anciens cantonnements, premier foyer de migration de cette agglomération, pouvaient aider à comprendre et à accepter le phénomène migratoire, principalement alimenté localement par l’industrie. Cette fois-ci, de nombreux anciens habitants des cantonnements ont envoyé leurs photos familiales.
La collection sur laquelle nous avons travaillé comporte 269 clichés4, alimentés par 37 familles. Certaines d’entre elles ont déposé une seule photographie, tandis que d’autres en ont confié plus d’une quarantaine. Outre une trentaine de clichés provenant du service communication de l’usine, la collection, en noir et blanc, comporte principalement des photos de personnages posés, parfois seuls (pour une soixantaine) et plus souvent en groupes. Nous ne disposons d’aucune date concernant ces clichés. Cependant, si l’on se réfère aux tenues vestimentaires ou encore à l’évolution (particulièrement faible) de l’aménagement de ce quartier pendant sa durée de vie, il convient de dire que les clichés de la collection couvrent une période allant des années 1930 aux années 1960.
Nous avons peu d’informations directes sur les conditions dans lesquelles ont été prises ces photos, n’ayant pas pratiqué une enquête par photo-élicitation (Harper, 2002 ; Trépos, 2015). Toutefois, à l’étude du corpus, la plupart des clichés relèvent de photographies familiales : quatre photographies représentent des mariages, généralement entre deux membres de familles nombreuses, et plus d’une centaine de clichés représentent des personnes « endimanchées », tandis que dans environ 90 photos, les personnages posent dans des tenues plus ordinaires. Au final, nombre des clichés donnent à voir la mise en scène et en récit de l’institution familiale (Sapio, 2017) et un espace migrant dominé par des familles – en opposition avec le cantonnement nord-africain voisin, beaucoup plus petit en nombre, peuplé de célibataires, et pour lequel nous n’avons en effet pas trouvé trace de clichés réalisés par ses habitants. Par ailleurs, la plupart des clichés datent d’avant 1960 – décennie de disparition progressive des cantonnements salaisiens – à une époque où les appareils utilisés étaient encore complexes d’usage et proches du matériel professionnel. Cet élément, ajouté à la nature familiale et posée de nombre des photographies, permet-il d’en déduire, comme le fait Irène Jonas (2010), que les auteurs des clichés étaient majoritairement masculins ? Les autres éléments de l’enquête ne nous permettent pas de le confirmer fermement. De même, nous n’avons pas d’information sur la propriété des appareils : certaines photographies – en particulier celles des mariages – ont probablement été produites par des professionnels ; mais nous faisons l’hypothèse que nombre de clichés ont été pris par les familles elles-mêmes, au vu de la quantité de photographies mises à disposition par certaines d’entre elles. Autre élément relevant de l’étude de ce corpus, seule une trentaine de clichés ont été pris soit sur le vif – pour une grande part, des enfants en bas âge ou des personnes circulant à vélo – soit à l’occasion d’une activité identifiable – chants et musique lors d’une réunion de famille, baignade au bord du Rhône, etc. Parmi ceux-ci, on ne trouve que huit photos prises en intérieur, provenant pour l’essentiel de deux familles. Cela tient peut-être à des raisons techniques et financières, le flash nécessitant une extension appropriée de l’appareil photo. Enfin, on peut s’interroger sur ce qui a poussé les familles concernées à donner ces photos aux collecteurs du comité d’entreprise. L’enquête menée parallèlement nous fait dire qu’il y avait mêlé le souhait de revitaliser un lien entre les générations (Jonas, 2010) en même temps qu’une fierté, assumée par les donateurs, d’avoir habité dans ce lieu des cantonnements, pourtant par la suite disqualifié dans l’espace local parce que perçu comme « le quartier des migrants ». La relative impudeur qu’il pourrait y avoir à livrer ainsi un patrimoine familial, constitué avant tout dans une fonction familiale de transmission, se trouve tempérée par le fait que les photographies de familles « ne dévoilent qu’une part de l’information qui se rattache à ces images privées » (Jonas, 2009, p. 53), et que seul le discours porté sur ces images par la famille peut en révéler les éléments cachés.
Image 1 – Échantillon de la collection constituée par le comité d’entreprise de Rhône-Poulenc Roussillon (appartenant actuellement à l’Institut CGT d’histoire sociale de l’Isère rhodanienne)
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché O1, dépôt famille Coronel : une photo carte-postale du cantonnement de la première guerre mondiale, probablement issue du service communication de l’usine
b. cliché H2, dépôt famille Garcia : une photographie non posée de pas encore hésitants d’un enfant dans les cantonnements
c. cliché D10, dépôt famille Guerineau-Sevilla : une photographie d’un mariage dans les cantonnements
La lecture de cette collection photographique révèle quoi qu’il en soit un espace d’ancrage de familles migrantes vu par ses habitants.
« En étant située dans le domaine du sensible et de l’affect, l’image n’a pas d’équivalent à l’écrit » (Pezeril, 2008, p. 5) et nous constatons en effet que ce corpus photographique a connu une succession de vies quasi-autonomes. Au-delà des souvenirs familiaux individuels, on peut faire l’hypothèse que les personnages qui sont ainsi photographiés seraient devenus avec le temps des modèles d’art, anonymes et interchangeables ou pour le moins d’une portée universelle, symboles d’un ancrage en terre étrangère. Par ailleurs, le support argentique, plus que les supports numériques, détient cette capacité à mieux traverser le temps, « la pellicule [étant] définitivement impressionnée » et disponible sur un support papier là où le numérique permet « l’abondance ou l’effacement immédiat de l’image » (Clément-Perrier, 2012, p. 62) sans souvent même dépasser la représentation numérique sur un écran. Enfin, le noir et blanc, par le marquage plus important qu’il accorde aux contrastes, par la représentation décalée d’une scène vécue en couleur, contribue déjà à transformer le réel en récit. Peut-être pour toutes ces raisons, ces photographies de famille ont connu au moins trois vies publiques, l’une militante, l’autre scientifique et la troisième artistique.
En décembre 1998, après avoir collecté ces photographies, la commission culturelle du comité d’entreprise a organisé une première exposition, militante, intitulée « Mémoires d’immigrés et des cantonnements ». Les clichés du corpus étaient présentés très simplement, montés sur des cartons blancs dans une salle polyvalente du comité, sans légende spécifique ou ordre préétabli. Les organisateurs avaient principalement été attentifs à ce que toutes les familles donatrices soient représentées. Il s’agissait pour eux de montrer que l’immigration, à l’inverse des représentations politiques ou médiatiques stigmatisantes, était aussi cet ordinaire qui s’était inscrit dans un espace singulier – les cantonnements – et avait ensuite essaimé dans l’espace local de cette agglomération iséroise.
Le vernissage de l’exposition a connu un réel succès populaire, rassemblant plus d’une centaine de personnes issues des cantonnements. Beaucoup de familles, parfois voisines peu éloignées, ne s’étaient pourtant pas revues depuis près de trente ans et se redécouvraient. La plupart des gens présents se parlaient en espagnol. Et les photos constituaient avant tout le support de souvenirs, individuels et collectifs, que chacun évoquait, rendant un hommage chaleureux aux morts et prenant des nouvelles des vivants. On était là dans un usage premier de la photographie, utilisée avant tout comme le support du souvenir d’un lieu, de personnages et de plusieurs époques ramassées en une seule : le « temps des cantonnements ».
Quelques années plus tard, comme déjà expliqué, nous avons mené un travail scientifique sur l’origine nationale des cantonnements et leur déclinaison à travers trois sites régionaux. Le terrain de Salaise-sur-Sanne était de loin le plus riche de nos sites d’étude, en particulier par les possibilités supplémentaires d’analyse qu’ouvrait ce corpus de photographies familiales. On peut d’ailleurs relever, avec Sylvaine Conord, une forme de paradoxe autour de l’utilisation scientifique d’un tel corpus : « Ce sont le contexte de production et le contenu informatif de l’image qui intéressent au premier plan l’anthropologue [et par extension le chercheur en SHS], alors que ce sont les choix de mise en scène et de présentation de soi qui préoccupent les sujets photographiés » (2007, p. 16), écrit-elle.
Ainsi, à l’inverse de ce qui attirait les visiteurs de l’exposition du comité d’entreprise – la reconnaissance des personnes photographiées –, nous avons surtout observé les seconds plans de ces photos. En effet, parmi les 269 clichés récoltés, 153 présentent un arrière-plan, plus ou moins informatif, sur un ou plusieurs éléments du quartier des cantonnements. Notre approche de ces arrière-plans a consisté à constituer une typologie afin de renseigner les matériaux de construction utilisés, les dispositions des maisonnettes, les jardins et leurs usages, les aménagements de transition entre les espaces publics et privés, et enfin les vues et perspectives sur l’usine et ses dépendances. Ces observations ont permis de mettre en valeur plusieurs éléments importants que les autres sources de cette enquête ne disaient qu’en filigrane, en ombre plus qu’en lumière. Nous souhaitons détailler ici plusieurs résultats de cette enquête que les photographies ont révélés ou pour le moins confortés.
Le premier concerne la place singulière des cantonnements dans le système social de logements produits par Rhône-Poulenc dans l’agglomération roussillonnaise. Jean-Pierre Frey a montré le premier, en s’appuyant sur une étude détaillée de l’urbanisation du Creusot, que dans un système paternaliste de logements d’usine, la distinction entre chaque quartier d’usine permet de mettre en scène dans l’urbain la possibilité d’un parcours résidentiel correspondant à une ascension sociale et professionnelle dans l’entreprise (Frey, 1986). Autrement dit, dans le panel d’un système complet de logements d’usine, comme il en existait au Creusot ou à Roussillon et ses communes environnantes, on est en capacité de distinguer sans ambiguïté les logements d’ouvriers, de contremaitres, d’employés, de cadres, d’ingénieurs et la maison du directeur. Car plus on monte dans la hiérarchie sociale de l’usine, plus les logements sont confortables, construits avec des matériaux nobles et pourvus de dispositifs spatiaux les éloignant de la rue. Or quand on regarde les photos familiales des cantonnements, les seconds plans passés au crible de notre typologie montrent que, dans le dispositif local de logements d’usine, les cantonnements, comparés à la grande cité ouvrière toute proche, constituent au regard de ces indicateurs de confort et de composition urbaine une « sous-cité ouvrière ». Et ce, alors que les habitants des deux lieux occupent les mêmes statuts d’ouvriers dans l’usine chimique voisine.
Par exemple, de nombreux clichés révèlent des connaissances matérielles de conception des cantonnements que peu d’entretiens avaient permis de savoir. Il est question en premier lieu du système viaire du quartier : le cliché K9, pris sur l’une des routes internes aux cantonnements, permet par exemple de dire que les chemins carrossables au sein de ce quartier de l’usine n’étaient pas stabilisés et viabilisés mais laissés en terre battue, contrairement aux autres cités et lotissements Rhône-Poulenc de l’agglomération où ils étaient goudronnés et équipés d’égouts. Le cliché E45 renseigne sur l’état de ces chemins en hiver, non déneigés et probablement boueux lors de la fonte des neiges. Les clichés E45 et Q4, comme de nombreux autres de la collection, permettent aussi de voir qu’en l’absence de goudronnage des allées de circulation, les découpages entre espaces publics et jardins ou entre parcelles ne sont institutionnellement pas stabilisés, et que les habitants les ont effectués par le biais de barrières de bois sommairement posées. Les clichés K9 et Q4 montrent enfin un contraste saisissant entre ces sols salissants, pour les vêtements comme pour les intérieurs des maisonnettes, et la blancheur des chaussettes et habits « endimanchés » des différents personnages qui posent.
Image 2 – Un système viaire en terre battue, non goudronné et dont la délimitation est laissée au soin des habitants
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché K9, dépôt famille Parilla-Sanchez
b. cliché E45, dépôt famille Flores
c. cliché Q4, dépôt famille Garcia
En s’intéressant à la conception urbaine du quartier, les photos – corroborées sur ce point par les témoignages oraux – montrent des logements construits « en enfilade », là où les cités voisines relevaient du modèle du cottage anglais, davantage dans la tradition des cités jardins. Par exemple, sur le cliché Q5, pris depuis la butte nord des cantonnements en bordure de l’usine, le second-plan de la photographie – qui utilise les cantonnements comme décor – indique un alignement de bâtiments tout en longueur, dont on devine par quelques portes alternant avec des fenêtres sur le bâtiment le plus visible (derrière la tête de la jeune femme) qu’il est divisé sommairement pour plusieurs familles. Les entretiens réalisés plus que les clichés ont permis d’apprendre que les logements ainsi découpés n’avaient pas de couloirs intérieurs desservant les pièces, ce qui permettait ainsi à l’usine propriétaire d’agrandir ou de réduire les logements au gré des changements de locataires. Par ailleurs, le cliché L6 renseigne sur la transition brutale entre l’extérieur et l’intérieur des logements, l’entrée de ces derniers n’étant séparée des chemins en terre battue que par un petit seuil en béton courant le long du bâtiment, contrairement aux cités ouvrières voisines où la progression est marquée par un jardin puis un auvent.
Image 3 – Des bâtiments bâtis en enfilade et une transition sommaire et brutale entre l’espace public et l’espace intime du logement
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché Q5, dépôt famille Garcia
b. cliché L6, dépôt famille Parilla-Sanchez
Par ailleurs, la conception architecturale des bâtiments, visible en arrière-plan des clichés N’1 et L2, rend compte de bâtiments construits à l’aide d’une ossature en bois, poteaux et poutres, remplie probablement avec du torchis ou un autre matériau composite de type mâchefer et recouvert ensuite d’enduit. Le cliché M1 permet de voir que le soubassement des murs a été bâti avec des pierres, afin d’assurer leur étanchéité. Quoi qu’il en soit, il s’agit bien du recyclage d’anciens bâtiments de guerre, construits à la hâte pour loger des ouvriers soldats et réutilisés ensuite en l’état pour y loger durablement des familles. Et les matériaux utilisés sont les plus basiques des différents logements d’usine construits localement par l’entreprise chimique.
Image 4 – Des bâtiments de guerre, conçus en structure de bois, avec remplissage par torchis et soubassement en pierres, recyclés sommairement en logements
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché N’1, dépôt famille Liarté
b. cliché L2, dépôt famille Sanchez
c. cliché M1, dépôt famille Damian
Enfin, autre élément différenciant analysable sur le corpus de photographies familiales, dans le second plan du cliché Q6, derrière le groupe de personnages photographiés, on peut observer deux bâtiments collectifs, le premier – ouvert – étant le lavoir du quartier, et derrière, le second, fermé, étant une batterie de toilettes. Ce cliché renseigne le fait que dans les cantonnements, les toilettes sont extérieures aux logements contrairement aux cités ouvrières voisines dans lesquelles ils étaient intégrés. Notons par ailleurs qu’il s’agit des seuls équipements collectifs de ce quartier.
Ces quelques indicateurs urbains analysés sur les second-plans des photographies de famille, tels que la distance entre le logement « intime » et la rue, la disposition des plans des appartements, les matériaux de réalisation ou le nombre et la place des éléments de confort par exemple sanitaire, viennent non seulement compléter mais véritablement éclairer les autres sources de l’enquête. Par ailleurs, la quasi-totalité des témoignages oraux a évoqué l’impossibilité, pour les familles étrangères des cantonnements, d’accéder à la grande cité ouvrière voisine, plus confortable au regard de ces différents indicateurs, et ce, malgré des demandes répétées au service logement de l’usine. Une étude des recensements montre dans le même temps que cette grande cité ouvrière voisine devient peuplée, par les services de l’entreprise toujours, à près de 90 % de familles françaises en une vingtaine d’années. Ainsi le décryptage des clichés permet d’affirmer qu’au vu des indicateurs urbains cités ci-dessus, les cantonnements constituent les logements du « bas de l’échelle » industrielle locale de référence. L’ensemble des éléments de l’enquête montre que c’est le seul statut d’étranger, et non celui d’ouvrier, qui vaut aux habitants des cantonnements d’y être logés durablement. Gérard Noiriel évoque, dans ses travaux sur l’immigration, ces logements des étrangers dans des cités ouvrières de moindre qualité, les classant dans le registre des attentes réservées à ces salariés – en particulier l’attente d’un logement plus confortable – et dans « les échéances qui aident à vivre » (Noiriel, 2005, p. 277).
Un autre élément révélé par ce corpus photographique d’habitants concerne la relégation spatiale dont le quartier des cantonnements fait l’objet. En effet, un premier cliché, Y28, probablement extrait des archives de l’entreprise, permet de situer les éléments industriels et urbains de l’usine au sortir de la seconde guerre mondiale et de qualifier ses différentes façades. Les lotissements sont ainsi répartis : au nord du site industriel (en haut à gauche de l’image), les premiers logements d’ingénieurs qui seront par la suite bâtis plus à l’écart de l’usine ; à l’est (à droite de l’image), le quartier de la grande cité ouvrière ; à l’ouest (à gauche de l’image) et au sud (en bas à droite de l’image), les cantonnements. On notera que la façade « officielle » de l’usine, correspondant à l’entrée sur le site, est située au nord et qu’il existe une autre façade « de fait » à l’est, visible depuis la voie de chemin de fer qui la longe et la route nationale parallèle qui dessert l’agglomération.
Image 6 – Vue aérienne du dispositif des usine-logements, montrant les cantonnements enferrés entre l’usine et ses déchets
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché Y28, dépôt famille Garrido
b. cliché I6, dépôt famille Miras
Ainsi l’image Y28 suggère que les principaux cantonnements sont situés « derrière l’usine », entre celle-ci et le Rhône (fleuve situé à gauche hors du champ de la photographie), sur le passage de l’égout principal rejetant les déchets industriels aqueux vers le fleuve et dans le lieu progressif de stockage des déchets solides. En effet, l’usine produisait sa propre électricité à l’aide de chaudières alimentées au charbon. Or, les déchets non entièrement brûlés, appelés dans le langage vernaculaire la charbonnille, ont été stockés progressivement face aux principaux cantonnements (tas noir à gauche sur le cliché Y28). L’image I6, probablement extraite elle aussi des archives de l’entreprise, montre l’importance du tas de charbonnille en regard de la hauteur des bâtiments du principal cantonnement voisin. Ces deux clichés sont particulièrement précieux pour permettre d’objectiver les lieux et leur agencement.
On notera d’ailleurs dans le corpus photographique l’importance de ce tas de charbonnille pour les habitants des cantonnements. On ne relève pas moins de 24 photos sur les 269 qui ont été prises avec ces déchets comme décor principal ou secondaire du cliché. Le tas de charbon étant situé le long de la route départementale desservant les cantonnements, on y trouve fréquemment des images de personnages à vélo. Par exemple, le cliché C’2 est pris depuis le sud des cantonnements. Derrière le groupe de jeunes hommes à vélo, on voit nettement à gauche le tas de charbon pris dans toute sa profondeur et on distingue sur la droite ceux des bâtiments des cantonnements bordant la route départementale. On notera l’absence de voitures et le peu de passage qui permet la réalisation d’un tel cliché, ce qui renseigne aussi sur l’écart du reste de l’agglomération dans lequel se trouvait ce quartier. Aujourd’hui, un tel cliché serait impossible à réaliser tant cette voie est devenue depuis un axe de circulation très emprunté permettant de contourner l’agglomération. Le cliché J’6 est pris quant à lui depuis les cantonnements. On distingue clairement sur la droite le tas de charbonnille, avec tout en haut le wagonnet qui l’alimente. Des 269 photographies du corpus, seul un cliché, le P4, rend compte en premier plan d’une activité maintes fois évoquée dans les entretiens réalisés, consistant pour les habitants des cantonnements à aller récolter sur le tas de charbonnille les pièces de charbon encore utilisables, dans un usage domestique pour chauffer les maisons. Cette pratique visible sur ce seul cliché explique sans doute aussi comment ces déchets, transformés en ressource pour les habitants voisins, ont pu symboliser les cantonnements au point de rentrer aussi couramment dans le décor des photos familiales réalisées.
Image 7 – La récolte de la charbonnille, une pratique sociale propre aux habitants des cantonnements, expliquant l’importance symbolique de ce tas de déchets sur de nombreux clichés
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché C’2, dépôt famille De Souza
b. cliché J’6, dépôt famille Garcia
c. cliché P4, dépôt famille Damey
Là encore, ces différents clichés ont permis de conforter l’hypothèse d’un espace produit par l’industriel local dans une logique de ségrégation, dans lequel le « quartier des étrangers » était situé dans les zones de stockage des déchets de la plateforme chimique. Dans l’envers du décor de l’usine, à l’écart du déploiement urbain, son positionnement géographique le déqualifie encore un peu plus. C’est d’ailleurs du fait de l’extension du site d’une part, et d’une insalubrité grandissante de l’autre, que les cantonnements ont finalement été évacués et démolis dans le courant des années 1960.
Pour autant, malgré la mise à l’écart de cette population des migrants de l’usine, ou peut-être de ce fait, la collection photographique révèle aussi des formes très prégnantes d’appropriation de ces lieux par leurs habitants. Nombre de clichés, comme le E12, indiquent la façon dont les familles ont progressivement créé des espaces de transition et d’accueil à travers l’aménagement de murets ou de tonnelles pour accéder au logement. De même le cliché C18 rend compte en second plan des « petits arrangements du quotidien », par la pose de barrières de séparation de fortune, par l’aménagement différencié des sols, pour arriver à tenir la « bonne distance » dans un ensemble où la promiscuité entre voisins était de mise. Enfin le second plan du cliché E10 suggère l’aménagement par la famille d’un massif de fleurs situé dans l’espace public, afin probablement de marquer l’entrée vers le logement.
Image 8 – Des aménagements réalisés par les habitants pour mieux marquer les espaces privés et intimes
© Collection CIE Rhodia Roussillon
De gauche à droite :
a. cliché E12, dépôt famille Flores
b. cliché C18, dépôt famille Garcia
c. cliché E10, dépôt famille Flores
Les photographies familiales ont ainsi constitué des données à part entière de notre enquête, à l’aide des informations socio-spatiales qu’elles contenaient fréquemment en second plan. Elles ont permis tout à la fois de confirmer la relégation de ce quartier d’ouvriers étrangers, d’en révéler l’importance en même temps que de mettre au jour des formes d’appropriation conséquentes des lieux, jusqu’à en dresser souvent les stigmates en symboles. En objectivant les lieux des cantonnements, leurs origines et leur constitution, ces images ont parfois créé un « malentendu productif » (Papinot, 2007), confrontées au discours parfois ré-enchanté tenu par les anciens habitants enquêtés sur leur propre enfance. Ces derniers, au vu d’un parcours de vie les ayant généralement conduits à une insertion sociale dans l’agglomération, ne retenaient en effet fréquemment que le souvenir de l’appropriation des lieux et occultaient volontiers l’isolement du quartier et la mise à l’écart de l’agglomération de sa population. Ce travail de recherche a fait l’objet d’une nouvelle exposition en 2010, utilisant largement le corpus de photographies collectées par le comité d’entreprise, mais dans une mise en scène qui se voulait scientifique et explicative de la réalité ségréguée de ce quartier de migrants.
Lors de nos interventions publiques locales autour du travail de recherche précédemment évoqué, nous avons à plusieurs reprises rappelé le manque que provoquait la destruction de ce quartier d’ouvriers étrangers dans la compréhension du dispositif local de logements d’usine. Il s’agissait dans notre esprit d’exprimer les limites du paternalisme, à travers le fait que, pour la cité « du bas de l’échelle », la hiérarchisation ne portait plus sur la place statutaire occupée par les salariés-habitants dans l’usine, mais bien sur leur origine culturelle et nationale. Nous en appelions au souhait d’aménager un élément symbolique permettant d’évoquer l’existence passée de ces cantonnements. L’opérateur culturel de l’agglomération, TEC (Travail et Culture), a entendu ces demandes, a fait appel au plasticien Pierre David et a financé son œuvre. C’est ainsi que le corpus de photographies du comité d’entreprise a connu une troisième vie, artistique celle-ci.
En effet, le travail de Pierre David a consisté à recouvrir un bâtiment entier de l’agglomération, celui qui abrite le Rhodia-Club issu de l’histoire sportive de l’usine, avec des carreaux sur lesquels sont sérigraphiées les photos familiales collectées5. Le plasticien a fait le choix d’utiliser de simples carreaux de cuisine, d’abord parce qu’il s’agit d’un matériau commun qui évoque pour tous l’espace intime du logement, ensuite parce que le procédé rappelle les azulejos et les zellijs que l’on trouve fréquemment sur les constructions traditionnelles portugaises, espagnoles et maghrébines, pays d’où étaient issus les habitants des cantonnements. Par ce procédé sémantique, artistique et technique, les photographies changent de sens : non seulement elles sortent des albums de famille pour se donner à voir à tous, mais elles se solidifient et s’apprêtent à passer le temps. La part de création de Pierre David s’attache aussi aux mots utilisés. En effet, le titre de l’œuvre, Les cantonnés, n’est pas un terme constitutif du langage indigène. L’introduction de ce nouveau mot, cantonnés, relève bien du travail de distanciation de l’artiste, qui transpose la focale depuis les lieux vers les habitants. Et si le terme « cantonnement » était déjà explicite d’une mise à l’écart spatiale, celui de « cantonnés » se positionne sur une mise au banc non plus seulement des installations mais bien aussi des populations.
Image 9
© Laurent Pouget, mairie de Salaise-sur-Sanne
De gauche à droite :
a. l’œuvre complète de Pierre David recouvrant le bâtiment du Rhodia-Club
b. commentaire d’une photo par une habitante
Les cantonnés a été inaugurée à Salaise-sur-Sanne en septembre 2013. De par son statut d’œuvre plastique, sa « sacralisation » devrait permettre d’en faire de façon pérenne le support d’une mémoire collective autant que de mémoires familiales. Cette œuvre constitue aussi un appui pédagogique pour évoquer la première source migratoire de cette agglomération ou encore les caractéristiques locales d’un système paternaliste de logements industriels. Enfin, la présentation de la collection d’images (reproduite sept fois), que l’on peut voir à hauteur d’hommes, met en valeur les photographies dans une esthétique globale de l’œuvre. En effet, après plusieurs essais, le plasticien a finalement fait le choix de carreaux blancs sur lesquels les photos soit occupent toute la forme (clichés carrés), soit sont calées toujours à gauche (clichés verticaux) soit sont calées toujours en haut (clichés horizontaux). Posées sur le mur de façon aléatoire, les photographies se trouvent ainsi distribuées autour de bandes blanches qui composent un labyrinthe tout en offrant une respiration aux clichés (les carreaux pleins étant toujours côtoyés par un carreau entièrement blanc).
Lors de cette recherche sur les cantonnements, toujours, nous avons aussi expérimenté le travail avec un photographe, à partir de protocoles, afin d’aider à rendre compte intelligiblement de concepts perçus parfois comme obscurs ou complexes. Danièle Méaux définit le protocole photographique comme désignant « ce qui se trouve posé en amont du “faire” – que ce “faire” concerne la réalisation des images ou leur interprétation. Ainsi le protocole est constitué des règles précises qui régissent et déterminent l’exercice de la prise de vue » (2013, p. 9). Autrement dit, « un protocole, c’est du langage, mais ce n’est pas que du langage ; c’est un processus mais non naturel, codé au contraire de A à Z » (Guérin, 2013, p. 21). Le principe de répétition parfois obsessionnel du protocole créé des effets spécifiques, en particulier des effets de comparaison. Il s’agit d’une modalité qui est couramment usitée dans la photographie contemporaine6.
Le photographe Michel Blondeau nous a accompagnés dans cette partie de la recherche sur les cantonnements. Il travaille habituellement comme portraitiste pour les studios Harcourt ; il a aussi une expérience de photographies publicitaires7. Pour des raisons essentiellement de manque de temps dû à un financement opportuniste8, nous lui avons suggéré les protocoles qu’il s’est ensuite appropriés. Nous souhaitions par là même donner à voir, en particulier dans l’exposition de 2010, des processus sociologiques que la recherche avait révélés.
Un premier protocole consistait à photographier devant leur logis actuel d’anciens enfants, adolescents et jeunes adultes des cantonnements. Il s’agissait de « mettre en série », de passer « du cas au type social » (Chauvin et Reix, 2015, p. 31) afin de rendre compte de parcours résidentiels qui tous partaient des cantonnements.
Parmi les portraits réalisés, plusieurs enquêtés habitent aujourd’hui dans les cités ouvrières voisines des cantonnements, alors que le service logement de l’usine en avait longtemps bloqué l’accès pour leurs parents. Il s’agit pour l’essentiel de personnes dont les parents ont été relogés là au moment de leur évacuation des cantonnements et qui ont acquis ensuite le logement directement ou par succession. Plusieurs autres ont construit de leurs mains la maison devant laquelle ils posent, parfois même sur des terrains vendus peu chers par l’entreprise Rhône-Poulenc dans le cadre de l’aide au logement de ses personnels. Enfin, l’une des personnes photographiées a été élue au cours de sa vie maire de Salaise-sur-Sanne. Lors de nos fréquentes rencontres à l’occasion de cette recherche, il a dit d’ailleurs à plusieurs reprises qu’il a eu peur de faire perdre les élections à son parti (le PCF) parce qu’il était issu des cantonnements, ce qui en dit long sur la profonde intériorisation de cette mise à l’écart socio-spatiale de sa propre ville.
Image 10
© Michel Blondeau
De gauche à droite :
a. portrait dans les cités ouvrières
b. portrait devant la maison qu’il a construite
c. portrait de l’ancien maire de Salaise-sur-Sanne
La mise en œuvre d’un tel protocole photographique autorise aussi à renouveler les discussions avec l’enquêteur, et permet de poursuivre et d’approfondir l’entretien ethnographique. Ainsi, « l’enquêté » du chercheur, en se muant en « modèle » du photographe, apporte parfois ses propres éléments de compréhension dans la mise en scène de la pose. Pierre-Marie Chauvin, dans l’explicitation de portraits d’ouvriers étrangers photographiés dans les Émirats arabes unis, indique ceci :
Peu habituées à être photographiées et valorisées, [les personnes rencontrées] étaient souvent en demande de « pose » et souhaitaient participer à la mise en scène de certains liens, de certaines activités ou de certaines postures. Les photographies « posées » sont donc des traces de notre passage, en ce sens qu’elles traduisent non seulement l’observation de lieux et des hommes, mais aussi et surtout une interaction asymétrique au cours de laquelle les personnes « observées » peuvent devenir un peu plus acteurs de l’interaction et exposer de manière fière et positive leur environnement quotidien ou leur travail
(2017, p. 19)
Dans cette même logique d’une volonté de garder le contrôle, l’une des enquêtées attire l’attention, au moment de la prise de vue, sur ses deux hortensias et quelques rosiers de son jardin, qu’elle présente comme étant des « rescapés des cantonnements » : elle voulait absolument qu’ils soient sur la photo. Un autre enquêté possède en bonne place dans son salon une photographie aérienne des cantonnements ; avant de se plier au protocole et de se faire prendre en photo devant chez lui, il a d’abord vivement souhaité se faire photographier devant cette image. Enfin, un autre enquêté a tenu à poser avec sa carte d’identité française bien en vue dans sa main droite, suite à un entretien réalisé quelques jours auparavant où il avait longuement exprimé les humiliations, les douleurs et les rancœurs quant à l’épreuve qu’a pu constituer pour lui sa demande de naturalisation française. Il s’agit bien là d’exemples d’interventions des personnes photographiées dans le processus de fabrication de l’image, « à travers des jeux de mise en scène de soi produits devant l’objectif, principalement destinés à contrôler une manière de se montrer » (Conord, 2002, p. 4), voire à transcender et poursuivre le propos retenu par le photographe et le chercheur.
Image 11
© Michel Blondeau
De gauche à droite :
a. portrait avec hortensias des cantonnements
b. portrait devant la photo des cantonnements
c. portrait avec carte nationale d’identité française
Ce protocole photographique, même amendé ou détourné, a pu donner à voir par une approche en images (Maresca et Meyer, 2013) que les enfants des cantonnements se sont progressivement installés, pour beaucoup d’entre eux, dans cette même agglomération iséroise ; qu’après une enfance vécue à l’écart social et spatial du reste de l’agglomération, ils avaient pris place dans la société locale, même si parfois cela avait été douloureusement, jusqu’à devenir aujourd’hui indistincts du reste de la population.
Un autre protocole a consisté à venir avec le photographe et un groupe d’anciens habitants sur les lieux actuels des cantonnements. Personne ne conserve le souvenir d’un jour cathartique de démolition de ce quartier. Les logements ont au contraire disparu progressivement, presque en catimini, engloutis par de nouvelles installations industrielles de l’usine ou par la végétation. Progressivement aussi, ces terrains sont devenus inaccessibles au public, à mesure que le service de sécurité de la plateforme chimique renforçait son périmètre de surveillance. De par la dangerosité des productions chimiques, l’accès à ces lieux a nécessité d’intenses négociations avec l’entreprise, d’abord parce qu’il nous a été impossible de nous y rendre sans être accompagnés par un membre du service sécurité de la plateforme chimique, ensuite parce que les différentes entités industrielles et juridiques qui la composent aujourd’hui exigeaient un droit de regard sur tous les clichés produits, de peur que des « secrets de fabrication » ne soient divulgués.
Le dispositif photographique avait pour objet de rendre compte de la trace, qui « rend présent ce qui a été » (Veschambre, 2008, p. 10). Se rendre sur place n’est pas une pratique habituelle tant les lieux sont situés à l’écart du développement urbain et beaucoup des enquêtés photographiés n’étaient plus jamais revenus sur ces lieux. Ainsi, il y avait une part d’inconnu dans ce protocole car nous pensions trouver des « choses », sans bien savoir quoi d’ailleurs. Or, c’est avant tout de l’absence de traces d’un lieu habité quarante années durant dont le protocole photographique a finalement rendu compte.
Image 12 - Un ancien habitant des cantonnements à la recherche vaine de traces matérielles de son enfance
© Michel Blondeau
En effet, à partir de la mise en situation de personnages sur les lieux de leur enfance, Michel Blondeau a saisi les réactions créées par la situation sur les enquêtés. Il a par exemple suivi l’un des anciens habitants visiblement à la recherche de traces matérielles de son quartier d’enfance. Les neuf clichés qu’il en a tirés constituent en eux seuls le récit de la recherche, puis du constat de l’absence, puis du dépit qui en résulte. Un apport des approches visuelles en sociologie est, comme c’est le cas ici, « de pouvoir restituer, à partir d’images fixes ou animées, des temporalités hétérogènes et complexes, en les condensant dans des séquençages visuels » (Chauvin et Reix, 2015, p. 31).
D’autres photographies réalisées dans le cadre de ce protocole évoquent la transformation de ces anciens lieux habités en espaces industriels, sans qu’il ne reste de trace matérielle de ce passé urbain. La mise en situation que demande le protocole permet, là encore, de saisir, par un raccourci de l’histoire, la violence des situations auxquelles se sont prêtés les enquêtés. Sur l’un des clichés, un homme pose debout à côté du bassin de traitement des eaux industrielles de la plateforme, bassin qu’il a lui-même partiellement conçu en tant que dessinateur dans le bureau d’études de l’usine mais qui recouvre désormais précisément l’emplacement de l’ancien logement de ses propres parents. Sur un autre cliché, un couple ne reconnaît rien du lieu où il a vécu les quelque dix premières années de son mariage, l’espace de l’un des cantonnements ayant été entièrement recouvert par des installations industrielles depuis.
Image 13 – L’usine a recouvert d’anciens lieux de vie, sans en laisser la moindre trace
© Michel Blondeau
Ces photographies, par les enjeux qu’elles recouvrent, ont permis de nourrir un peu plus les résultats de l’enquête : après avoir montré la construction de la déqualification de ce quartier de migrants, les protocoles photographiques mis en œuvre, les clichés qu’ils ont permis de saisir et l’analyse que l’on en fait ensuite rendent compte d’une mémoire urbaine rendue illégitime (Lepoutre et Cannoodt, 2005), par la seule négation de lieux autrefois habités et dont les traces ont été totalement recouvertes par une activité productive. La photographe Jacqueline Salmon s’intéresse aux raccourcis de l’histoire des lieux lorsqu’elle photographie un hangar à Sangatte abritant des tentes de réfugiés souhaitant partir en Angleterre, hangar qui était destiné à l’origine au stockage des matériaux pour la construction de l’Eurotunnel (Salmon et Fleury, 2011). Les changements d’usage aussi contrastés, d’habitation à industrie comme de stockage de matériel à stockage-hébergement d’êtres humains, recèlent une violence difficilement intelligible lorsqu’elle est simplement écrite. L’utilisation de ces photographies de Michel Blondeau lors de l’exposition de 2010 a permis, en quelques clichés, de donner à voir et à comprendre ce double processus, de personnes issues des cantonnements ayant vieilli et trouvé bonne place dans l’agglomération roussillonnaise, mais dont les traces de leur quartier d’enfance ont été englouties sous des installations industrielles.
À propos des travaux d’Howard Becker sur la photographie et la sociologie, Albert Piette écrit la chose suivante : « Becker, qui a beaucoup écrit sur la photographie sociologique, ne prétendait-il pas qu’elle concernait en premier lieu les chercheurs en sciences sociales non satisfaits des procédés classiques de leur discipline ? » (Piette, 2007, p. 23). Les travaux récents sur la sociologie visuelle ont largement dépassé cette interrogation. Nous avons, pour notre part, tenté de montrer ici ce que la photographie ajoute à la palette ordinaire d’outils géographiques, ethnographiques ou sociologiques pour appréhender un terrain, et ce avec son propre mode d’expression. Au-delà de la seule photographie, Jacques Levy, dans un article sur la géographie et le cinéma, en appelle au final à dix principes pour en finir avec le film documentaire et pour travailler davantage la mise en image de l’espace dans le cinéma scientifique. Parmi ces principes, il développe l’idée qu’il faut « inventer », c’est-à-dire « s’affranchir de l’utilisation du langage cinématographique comme une “illustration” d’autres discours et rechercher son apport singulier pour la communication scientifique : comparatisme, preuve par l’existant (qui diffère du discours illustré et des images commentées) ». Il faut, selon lui, « penser », c’est-à-dire « montrer l’invisible par le visible, en n’oubliant pas que ce n’est jamais tout à fait possible » (Levy, 2013, p. 708).
L’usage de la photographie dans une investigation en SHS peut ainsi être alternativement une source spécifique, qui dispose d’un statut aussi légitime que d’autres archives, un outil, qui s’exprime par le langage propre du photographe, ou encore un média, qui par sa familiarité avec le grand public, peut aider à mieux diffuser les résultats d’une recherche. Ainsi, la photographie constitue un outil de connaissance à part entière qui permet « d’œuvrer à un renouvellement de l’écriture dans les sciences sociales » (Maresca et Meyer, 2013, p. 96). Qu’il s’agisse de dispositifs photographiques ou de procédés plus simples empruntant aux portraits, aux paysages ou aux clichés d’actualité, le photographe, par son expression autonome, est en capacité de produire un savoir indépendant. Cela oblige nécessairement à repenser le positionnement du photographe dans la commande ainsi que dans le projet initial de recherche.
1 Pour davantage de précisions historiques sur l’émergence des visual studies et de la sociologie visuelle, voir Harper 2000, Chauvin et Reix 2015 ou les chapitres 1 et 3 de Maresca et Meyer 2013.
2 Il existait en réalité deux anciens cantonnements, proches l’un de l’autre, recyclés de la première guerre mondiale. Un troisième, conservé d’abord puis détruit et rebâti ensuite, jouxtait le cantonnement principal. Pour des soucis de simplification, nous les regroupons ensemble dans ce texte sous le vocable pluriel de « cantonnements ».
3 Le nouveau petit Robert, 1993 (p. 298).
4 Précisons toutefois que 38 clichés ne sont pas exploitables, ayant été mal numérisés ou mal conservés après la numérisation.
5 Voir le travail de Pierre David en ligne : http://pierredavid.net/page/fr/les-cantonnes-1.
6 Voir par exemple, le travail de Guy Hersant dans Pose travail (Baron et al., 2013), dans lequel les salariés de petites entreprises d’un même département posent systématiquement ensemble dans leur tenue de travail ; ou de celui de Bertrand Stofleth (2014), sur les aménagements du Rhône vus systématiquement depuis des engins élévateurs, rendant ainsi compte d’éléments d’un fleuve fortement aménagé qui semblent invisibles (ou peu visibles) à hauteur d’homme.
7 Voir le travail de Michel Blondeau en ligne : http://www.michelblondeau.com
8 Il s’agissait d’un financement inattendu de fin d’année budgétaire, comme il en arrive parfois dans la recherche, et qu’il fallait dépenser dans la quinzaine sous peine qu’il soit supprimé.
BARON Evelyne (dir.), HERSANT Guy, LE TIRANT Dominique (2013), Pose travail, catalogue d’exposition, Gand, Snoeck Éditions.
BECKER Howard S. (1974), « Photography and sociology », Studies in Visual Communication, 1 (1), p. 3-26.
BECKER Howard S. (1981), Exploring society photographically, Evanston (Ill.), Mary and Leigh Block Gallery.
BOULDOIRES Alain, MEYER Michaël, REIX Fabien (2017), « Introduction. Méthodes visuelles : définition et enjeux », Revue française des méthodes visuelles, 1, [en ligne], http://rfmv.fr/numeros/1/introduction/.
BUSSON Adeline (2013), « Photographie privée de RDA : production et réception conditionnées, une approche socio-historique », Allemagne d’aujourd’hui, 203, p. 92-103.
CHAUVIN Pierre-Marie (2017), « Mussafah Shots. Une expérience pédagogique de sociologie visuelle dans une petite ville industrielle des Emirats », Revue française des méthodes visuelles, 1, [en ligne], http://rfmv.fr/numeros/1/articles/une-experience-de-sociologie-visuelle-dans-une-petite-ville-industrielle-des-emirats/.
CHAUVIN Pierre-Marie, REIX Fabien (2015), « Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche », L’Année sociologique, 65, p. 15-41.
CLÉMENT-PERRIER Annie (2012), « De l’argentique au numérique. L’image révélée, quelques exemples dans la littérature contemporaine », Littérature, 165, p. 62-83.
COLLIER John Jr. (1967), Visual anthropology. Photography as a research method, New York, Holt Rinehart and Winston.
CONORD Sylvaine (2002), « Le choix de l’image en anthropologie : qu’est-ce qu’une “bonne” photographie ? », ethnographiques.org, 2, [en ligne], http://www.ethnographiques.org/2002/Conord.
CONORD Sylvaine (2007), « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française, 37, p. 11-22.
CONORD Sylvaine (2016), « La photographie et les sciences sociales dans l’approche d’une mémoire collective communautaire », in RAULIN Anne, CONORD Sylvaine, BERTHOMIERE William, EBILITIGUE Ines, FÄRBER Alexa, MA MUNG Guillaume, VEIGA GOMES Hélène, « Migrations et métropoles : visées photographiques », Revue européenne des migrations internationales, 32 (3-4), p. 73-83.
DE LATOUR Éliane (2018), « La fausse bataille de l’art et de la science. Mise en scène cinématographique en ethnologie », Revue française des méthodes visuelles, 2, [en ligne] http://rfmv.fr/numeros/2/articles/07-la-fausse-bataille-de-l-art-et-de-la-science/.
DE VERDALLE Laure, ISRAËL Liora (2002), « Image(s) des sciences sociales (avant-propos) », Terrains et travaux, 3, p. 7-13.
DU May, MEYER Michaël (2009), « Photographier les paysages sociaux urbains. Itinéraires visuels dans la ville », Ethnographiques.org, 17, [en ligne] http://www.ethnographiques.org/2008/Du-Meyer.
DUCHÊNE François (2002), Industrialisation et territoire. Rhône-Poulenc et la construction sociale de l’agglomération roussillonnaise, Paris, L’Harmattan, coll. « Villes et entreprises ».
DUCHÊNE François (dir.), GODARD Jérôme (2008), De l’isolement à l’oubli, le cantonnement des travailleurs allogènes. Relégations urbaine, environnementale, citoyenne et occultation mémorielle dans les territoires de l’industrie chimique lyonnaise (69) et roussillonnaise (38), rapport de recherche, Lyon, Université de Lyon.
FREY Jean-Pierre (1986), La ville industrielle et ses urbanités. La distinction ouvriers/employés, Le Creusot, 1870-1930, Bruxelles, Éditions Mardaga.
FRIDENSON Patrick (1977), 1914-1918, l’autre front, Paris, Éditions ouvrières (Cahier du Mouvement social 2).
GUÉRIN Michel (2013), « Qu’est-ce qu’un protocole ? », in MEAUX Danièle (dir.), Protocole et photographie contemporaine, Saint-Etienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, p. 21-36.
HARPER Douglas (2000), « The image in sociology: histories and issues », Journal des anthropologues, 80-81, p. 143-160.
HARPER Douglas (2002), « Talking about pictures: A case for photo elicitation », Visual Studies, 17 (1), p. 13-26.
JONAS Irène (2009), « L’interprétation des photographies de famille par la famille », Sociologie de l’Art, Opus 14, p. 53-70.
JONAS Irène (2010), « La photographie de famille : une pratique sexuée ? », Cahiers du Genre, 48, p. 173-191.
LEMIRE Vincent, SAMSON Stéphanie (2003), Baraques. L’album photographique du dispensaire La mouche-Gerland, 1929-1936, Lyon et Cognac, ENS Éditions et Éditions Le temps qu’il fait.
LEPOUTRE David (dir.), CANNOODT Isabelle (2005), Souvenirs de familles immigrées, Paris, Odile Jacob.
LEVY Jacques (2013), « De l’espace au cinéma », Annales de géographie, 694, p. 689-711.
MARESCA Sylvain, MEYER Michaël (2013), Précis de photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Didact Sociologie ».
MÉAUX Danièle (dir.) [2013], Protocole et photographie contemporaine, Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne.
NOIRIEL Gérard (2005), État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, 1re éd. 2001, Paris, Gallimard.
PAPINOT Christian (2007), « Le “malentendu productif”. Réflexion sur la photographie comme support d’entretien », Ethnologie française, 37, p. 79-86.
PEZERIL Charlotte (2008), « Place et intérêt de la photographie dans une étude anthropologique sur l’islam au Sénégal », ethnographiques.org, 16, [en ligne] http://www.ethnographiques.org/2008/Pezeril.
PIETTE Albert (2007), « Fondements épistémologiques de la photographie », Ethnologie française, 37, p. 23-28.
SALMON Jacqueline, FLEURY Jean-Christian (2011), « Le hangar », Ligéia, 105-108, p. 110-119.
SAPIO Giuseppina (2017), « Le film de famille. Représentations collectives, mise en récit et subjectivation », Politiques de communication, 8, p. 27-48.
STOFLETH Bertrand (2014), Rhodanie. Paysages déclassés, Lyon, Éditions deux-cent-cinq.
TRÉPOS Jean-Yves (2015), « Des images pour faire surgir des mots : puissance sociologique de la photographie », L’Année sociologique, 65, p. 191-224.
VANDER GUCHT Daniel (2017), Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
VESCHAMBRE Vincent (2002), « Une mémoire urbaine socialement sélective. Réflexions à partir de l’exemple d’Angers », Annales de la recherche urbaine, 92, p. 65-73.
VESCHAMBRE Vincent (2008), Traces et mémoires urbaines. Enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Géographie sociale ».
François Duchêne, « Loger les migrants en 'sous cité ouvrière'. Clichés de familles migrantes dans les anciens cantonnements de Salaise-sur-Sanne », Revue française des méthodes visuelles [En ligne], 4 | 2020, mis en ligne le 15 juin 2020, consulté le . URL : https://rfmv.fr