

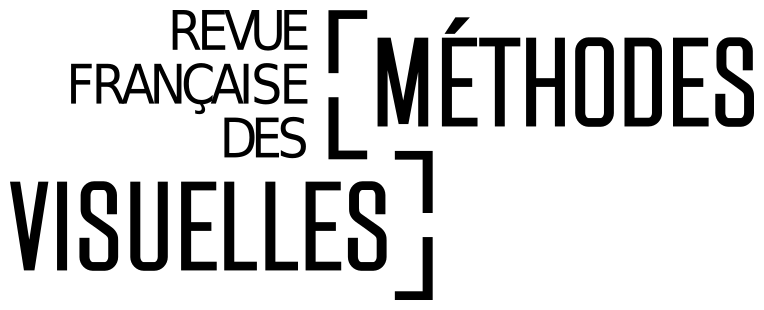
Eliane De Latour, Directrice de recherches, CNRS (IRIS/EHESS)
Paradoxe de l’anthropologie qui dès sa naissance unit science et image au profit de la connaissance de mondes sociaux, sans jamais arriver à surmonter une forme de positivisme létal ! Dans cette expérience utilitariste ethnologie et cinéma ont perdu leurs dynamiques intrinsèques. Le geste réflexif et le geste artistique ont en commun une transversalité qui puise à de multiples sources, relève du raisonnement comme de l’expérience sensorielle. A l’aide de quelques exemples de mises en scène cinématographiques puisées dans mes propres films, je vais tenter de mettre en lumière la possibilité du dépassement commun à partir des catégories propres à chaque champ. Mais auparavant, un questionnement sur d’apparentes évidences s’impose.
Mots-clés : Epistémologie, Art, Science, Image, Ecritures cinématographiques, Documentaire, Fiction
Paradox of anthropology which from its birth unites science and image for the benefit of the knowledge of social worlds, without ever managing to overcome a form of lethal positivism ! In this utilitarian experience ethnology and cinema have lost their intrinsic dynamics.The reflexive gesture and the artistic gesture together have transversality. They draw from multiple sources and draw on reasoning as well as sensory experience. They use categories specific to the possibility of a common overtaking as shown by some examples of personal cinematographic productions that I will analyze. But first, a questioning of apparent evidence seems necessary.
Keywords : Epistemology, Art, Science, Image, Cinematographic writing, Documentary, Fiction
L’homme naît avec l’image. L’homme ne devient homme que lorsqu’il devient spectateur, et c’est comme tel qu’il devient sujet et citoyen, parce qu’il y a quelque chose dans le rapport à l’image qui le fonde comme sujet.
(Mondzain, 2008)
En France, en Afrique de l’Ouest, en Inde, j’ai porté un regard sur les mondes fermés de ceux que l’on repousse derrière une frontière géographique ou sociale, une mise à l’écart ressentie dans la douleur et le sentiment d’inutilité. Cette recherche s’est moins attachée aux raisons de la relégation sociale qu’aux « mille façons de braconner le quotidien » (de Certeau, 2002) en situation de « hors » l’espace et le temps des autres. Ricœur (1988) par le concept d’« identité narrative » montre comment le sujet s’invente dans une inscription entre « récit de soi » et « récit historique ». Dans les situations de relégation, cette inscription transite par des objets, des rêves, des mythologies… Les nouvelles temporalités construites font émerger des valeurs et des places dans la vie réelle. Ainsi, les « subjectivités agissantes », comme les nomme le philosophe de Soi-même comme un autre « se confrontent au récit comme le lieu de compréhension de la vie » (Bragantini, 2013) et œuvrent à la réappropriation de soi.
J’ai été amenée à travailler sur des formes très diverses d’enfermement : personnes âgées dans les Cévennes hors âge (1989), épouses de harem au Niger placées derrière un mur hors du sexe dominant (1993), détenus de la Maison d’arrêt de la Santé hors la loi (1996), ghettomen ivoiriens ou nouchi, hors normes et vivant dans les interstices des villes (2000), jeunes prostituées de ghettos d’Abidjan (2011, 2014, 2016)1 les Go de nuit hors parmi les exclus. Ne sont cités ici que les cas dont je vais me servir par la suite et pour lesquels j’ai mobilisé photo et cinéma.
Aussi hétérogènes que ces personnes puissent paraître, elles ont en commun d’avoir été retirées de leur monde, puis confinées dans des lieux raréfiés où l’infime, le dérisoire, l’immatériel, l’immobilité, le silence deviennent événement et, où l’espace, le temps se reformulent par des déplacements intérieurs, des conquêtes fragmentées de liberté, des exils imaginaires. Les maisons de personnes âgées se resserrent sur un découpage intime ritualisé par une photo encadrée, une fleur artificielle, un livre de poème, un chat. La prison uniforme, égalitaire, cadenassée est subvertie par le jaillissements des temporalités subjective. Le ghetto d’Abidjan donne naissance à des « héros » singuliers qui cherchent une nouvelle dimension pour échapper à l’anonymat des faibles. Les plats cuisinés des femmes enfermées au Niger passent à travers les murs pour être vendus dans le bourg au bénéfice d’une petite économie personnelle constructive, même si face à une coépouse plus jeune, le temps du corps détruit la confiance en soi. Combat pour la beauté que les « Go de nuit » (jeunes prostituées) tiennent pour essentiel face à l’infamie et à la dégradation dont elles sont l’objet.
L’observation de l’intérieur rend compte de la diversité des parcours individuels qui font émerger des sujets moraux. L’élaboration d’une recherche conceptuelle et esthétique est la plus adaptée pour exhausser les récits subjectifs par lesquels hommes et femmes relégués continuent à se faire reconnaître dans un monde qui les nie. Réappropriée dans une existence « non rattachée », l’image de soi, passe par la conquête d’un langage comme outil d’expression universel.
Ma thèse terminée, j’associais mes recherches au cinéma dont je voulais explorer la richesse davantage à chaque projet. Pour moi, la réalisation d’un film était non seulement soumise à l’engagement sur un terrain ethnographique mais aussi à de nouveaux défis formels, notamment en creusant sens et narration par la construction esthétique. Ce mouvement sera traité ici, dans un premier temps, par le questionnement critique sur la recherche en sciences humaines face à l’image; ensuite, par l’analyse de quelques choix de mises en scène auxquels j’ai été confrontée.
L’académie a des relations de transparence avec l’écriture alphabétique, alors que depuis Platon l’image2est suspectée d’empêcher le discernement. Dans notre culture cartésienne, on ne prête pas au cinéma la possibilité de restituer un savoir et une vérité. C’est bien tardivement que l’université a commencé à accueillir des vidéothèques ; et les travaux filmés sont encore difficilement évalués. Je ne vais pas entrer ici dans le vieux débat desséchant des mérites comparés entre graphies sensibles et textes, mais plutôt interroger le fond de cette méfiance endémique.
Acclimater notre inconnaissance par des langages connus.
(Barthes, 1980)
Par hantise des échappées et des incertitudes, les scientistes instrumentent l’image dès sa naissance, et la recouvrent de discours. Ainsi placée à la remorque d’autres régimes d’explication, elle se trouve réduite à un rôle illustratif du texte ou de support à la description du social. Un « sherpa » de l’écrit. Pourtant l’image est irréductible à la logique discursive des mots3. Sa maîtrise à tout prix finit par lui faire perdre son pouvoir cinématographique et sa capacité à renvoyer ses propres effets de vérité.
C’est dans les années 1940 qu’une forme de « cinéma scientifique » voit le jour. Il faut « révéler le monde » en changeant de paradigme cinématographique comme commençait à le faire le néo-réalisme italien. Défini par Leroi-Gouhran en 1948 comme un cinéma aux contenus et aux méthodes scientifiques entre les mains des ethnographes, Le Film ethnographique tente de trouver une forme canonique qui acclimate un discours scientifique à des scènes prises sur le vif.
Jean Rouch lance ses premiers documents visuels Au pays des mages noirs (1947), Les Magiciens de Wanzerbé (1948). Suivront de nombreux films consacrés à des rituels dans la région songhay au Niger et sur la falaise de Bandiagara au Mali. Les images sont accompagnées de sa voix off dans la plus pure tradition des commentaires qui ont fleuri depuis la naissance du parlant. Le cinéaste reste fidèle à son maître Griaule et à l’ethnographie symboliste déjà dépassée dans les années 1960. Le « décodeur maître » (Haraway, 2004) reste du même côté même si les autochtones sont « positivement » exotisés4. Rouch parle en lieu et place du récitant dont il tient le rôle, mais aussi en lieu et place du prêtre, du génie qui possède, de la foule, du mythe… il endosse toutes les voix empêchant un accès à la pensée des personnes filmées.
Assez vite la production académique s’est modélisée. Le récit impérial porté par le savant explique les indigènes-objets dénués de subjectivité et de connaissance sur eux-mêmes : des « idiots culturels » selon Garfinkel (1967) réduits de manière unidimensionnelle à des fonctions : le prêtre, les Massaïs, la potière… D’un film à l’autre, on retrouve la caméra objectivante, les génériques formatés, les musiques « locales »dans le style Ocora, des monteurs institutionnels pour concevoir l’assemblage final.
Malgré sa forte décroissance, cette veine cinématographique distancée perdure sous toutes les latitudes jusqu’à aujourd’hui comme on peut le voir avec cet extrait de 2013.
Nanterre (Paris X) confirme cette vision scientiste par la figure de« l’ethnographe-cinéaste » chargé de filmer ses observations in extenso. La lavandière qui plie un drap sans qu’aucun pli ne nous soit épargné, de même pour le tapissier avec ses clous. L’ellipse ne fait pas partie du bagage esthétique, la durée réelle serait un gage d’« objectivité » !
Dès les années 1970, l’anthropologie ainsi que toutes les sciences humaines, connaît de grands bouleversements. Les premières charges critiques viennent d’intellectuels anglo-saxons (École de Birmingham, École de Chicago5). Ils battent en brèche les certitudes savantes : culturalisme, généralisations, notion d’invariants, assignations inamovibles. Geertz intitule un de ses ouvrages La Description dense (1973) qui renvoie aux sédimentations de significations dans les contextes variés de l’expérience humaine.
Loin de cette révolution de la pensée, Rouch ne s’intéresse plus depuis longtemps aux réflexions épistémologiques de sa discipline. Il filme tant qu’il peut en usant son vieux « back ground » sans renouveler ses études de terrain. Cependant, il suit un double cheminement6 qui marque son cinéma de manière diachronique. En même temps qu’il tourne de nombreux films sur des rituels soumis à « décodage7 », il réalise Moi un Noir(1958) avec une liberté de ton, de regard et d’inventions cinématographiques. Il crée une expression spontanée, hétérogène, s’attache à la langue des acteurs, glisse avec sa caméra dans leurs espaces d’errance et leurs pensées. Il en émerge une fine ethnographie urbaine d’Abidjan, ville du « miracle ivoirien », à travers les immigrés de l’intérieur, marginaux, que personne ne regarde alors que l’économie enrichit les classes moyennes. Ces films spontanés restent proches de l’univers mental des acteurs comme Cocorico Mr Poulet, Jaguar, Petit à petit.
La maîtrise ou non des langues vernaculaires explique sans doute ce dédoublement. Rouch comprend le français de rue des jeunes immigrés d’Abidjan et de sa bande –Damouré, Lam, Talou– dont il fait même un enjeu novateur de ses films, mais il ne parle ni le Zarma, ni le Dogon, ni le Bambara, langues des cérémonies religieuses qu’il filme. Il donne la parole dès qu’il comprend la langue car il sait entrer en relation directe avec les acteurs, mais dès qu’il ne la comprend pas, il la prend et la garde. Il s’enferme alors dans une forme de cinéma ethnographique suranné qui pourtant implose sous ses yeux, notamment au Canada avec Michel Brault, Pierre Perrault et beaucoup d’autres de l’ONF (Office national du Film).
Faut-il encore rappeler que le cinéma est né à la fois du spectacle de foire et de l’étude scientifique du mouvement par Marey (1889) ? Une dualité qui l’a marqué à l’origine par la logique et l’émotion. En instaurant le principe de la distance du chercheur à son objet, la pensée positiviste sépare émotion/raison, esprit/corps, documentaire/fiction, vérité/mensonge, fond/forme, sens/style, écrit/image, réalité/fiction ; une axiomatique qui se construit aussi par les oppositions : nature/culture, tradition/modernité, centre/périphérie, dominants/dominés, etc.
Or le geste artistique comme le geste intellectuel ne cesse de traverser, hybrider, agglomérer une réalité en mouvement qui loin d’être « verticale » se saisit par son histoire contradictoire, ambiguë, à travers la complexité des acteurs qui représentent à eux seuls « des multitudes ».
Le réalisme, c’est-à-dire l'emprunt au réel constitutif de tout art, a une histoire depuis Aristote et sa mimesis. Dès son origine, le cinéma fut décrété « Art total ». Sons, matières, couleurs, lumières sont extraits de ce qui nous entoure « comme si on y était ». Suite à une exploitation foraine (1896-1907) réussie, le besoin de sensation du réel est pris en compte par l’industrie du cinématographe. On passe du muet au parlant, de la post-synchronisation à la synchronisation de l’image et du son au moment du tournage, du noir et blanc à la couleur, de la photo chimique à la photo numérique aux effets hyper-réalistes, sans compter les tentatives de relief en 3D, de sièges vibreurs jusqu’aux odoramas (guère développés). On veut que le spectateur saute encore de sa chaise quand le train entre dans la gare de La Ciota ! Renoir évoque ces « progrès technologiques » qui permettent de saisir le réel avec de plus en plus de détails mais nous amènent à la « laideur ».
Dans les années 1960, l’avènement des outils légers et synchrones permet de s’approcher des autres et rapporter des expériences aux spectateurs là aussi « comme s’ils y étaient ». Une expression qui pourrait presque être celle d’un Tour-operator, mais qui répond à une forme de réalisme d’observation emprunté au mythe de l’objectivité des savoirs en cours à cette époque. Le plan séquence porté au pinacle (durée réelle) et la théorie de la mouche sur le mur, « the fly on the wall » (Ricky Leacock, Alfred et David Maysles, Don Alan Pennebacker) en sont les émanations directes. Plus les opérateurs seraient transparents à l’espace (la mouche) et au temps (la durée réelle), plus émergerait une relation « pure » au « réel » qui conduirait à une forme de « vérité » ou « d’objectivité ». Le public serait en prise directe avec des inconnus qui agiraient « naturellement » ; la médiation étant considérée comme tendancieuse. C’est bien l’inverse– voir sans être vu – qui est tendancieux ! Cette position erronée est battue en brèche par ceux qui comme Rouch préconisent au contraire l'affirmation du dispositif cinématographique jusqu’à la fusion appelée « ciné-transe », acte performatif de la caméra qui modifie la réalité de manière heuristique. Cependant avec son ami Morin, il a la mauvaise idée de baptiser ces nouvelles émergences : « cinéma vérité », un label auquel il ne croit pas lui-même !
Les flottements sémantiques confortent les catégories de genre. À la fiction : la mise en scène, le mensonge, l’imagination, le fabriqué. Au documentaire : la spontanéité, la vérité, la science. Absurde.
Ces frontières de genre relèvent de processus administratifs9. Les grands festivals sélectionnent avant tout des auteurs et, en 1994, mon film Contes et Décomptes de la cour va à la Berlinale. Depuis ce moment-là, mes films –documentaires, fictions, tous liés à un travail ethnographique– sont pris aux sélections officielles de Berlin, Locarno, Venise, Rotterdam, Londres, San Sebastien, etc. Cela me conforte dans l’idée du brouillage des limites10 et de l’importance de la construction du regard nourri de sa propre histoire.
L’anthropologue sur son terrain a une expérience sensorielle de la connaissance. Mais selon qu’il travaille dans la perspective d’une publication ou d’une distribution, il va utiliser des méthodes différentes. Généralement pour écrire, le moment de l’enquête in situ sera mobilisé plus tard par la mémoire. À l’inverse, l’expérience d’un tournage se vit en même temps qu’elle s’imprime. Les acteurs – quel que soit leur statut –entrent dans le corps diégétique du récit au sein duquel le réalisateur interagit par des opérations émotives, cognitives, esthétiques, en même temps que sa présence transforme ce qui l’entoure dans un mouvement heuristique. Le cadrage loin d’être un simple « prélèvement » du réel est une opération structurante qui « affecte et permet d’affecter ». Je reprends volontiers la formule de Jeanne Favret Saada (1977) pour l’appliquer au tournage et même à ce qui se passe avant le tournage. Le « jeu à deux » (réalisateur/acteurs) modifie les places sur le terrain et fait naître de nouvelles questions entre maîtrise et échappée qui n’auraient pu être perçues avant. Cette dynamique crée des tensions contenues dans le style qui permet de dépasser la littéralité des faits et gestes pour apporter la cinématographie en révélant le sens.
Le style est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation […] de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun.
(Proust, 1927)
Cette « vision » dont parle Proust produit des actes de connaissance qui rencontrent l’identification du spectateur souvent sottement réduite à l’adhésion mimétique au héros de l’histoire. Il s’agit plutôt d’une « croyance » consciente-inconsciente qui articule une expérience de cinéma (hypnotique) à une expérience de connaissance (sensible).
En 1982, sans formation dans une école de photo ou de cinéma, je partais au Niger la première fois avec une caméra Aaton16 mm inventée et prêtée par Jean-Pierre Beauviala qui me mit en confiance avec cet objet jamais tenu.
On tisse des relations de connivence et d'intimité qui font de l'outil bien plus qu'un prolongement de la main ou un instrument de la raison : un alter ego.
(Bazin, Bensa, 1994)
Comme on était rock, reggae, rap, on était « aatonien » et en bonne compagnie. Albert et David Maysles, Ricky Leackok, Michel Brault, Jean-Luc Godard, Louis Malle, Pierre Perrault, Jean Rouch, et du côté militant : Renaud Victor, Richard Coppans… Pendant vingt-cinq ans, tous mes films ont été tournés en Aaton. Mon cheminement suivait l’évolution des caméras : LTR 16 mm, XTR Super 16 mm, 35 mm avec des accessoires inventés au fil des jours par Jean-Pierre Beauviala. Time code intégré, obturateur en peigne (jamais commercialisé), magasins blancs contre le soleil (jamais commercialisés), cadre noir dans le viseur (jamais commercialisé).J’aimais cadrer. Cela ne s’apprend pas mais se sent intérieurement avec des impressions d’échec, de pertinence ou d’euphorie dans les instants de fusion avec un geste ou une lumière : deux notes qui soudain vibrent ensemble.
À côté de la caméra, je me construisais un petit viatique technique en prenant conseil auprès de spécialistes du son et de l’image à qui je donnais intentions et conditions de l’expérience. Je recommençais pour chacun de mes tournages et n’imaginais pas que des décennies plus tard, le grand chef opérateur Bruno Nuytten allait trouver des mots proches des miens pour évoquer son rapport à la technique.
Je n'ai jamais de savoir. D'un film à l'autre, j’oubliais tout ce que j’avais cherché et bricolé sur le précédent. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'expérimentation.
(Nuytten, 2018)12
L’expérimentation technique prolongeait l’idée que je développais narrativement après avoir essayé de comprendre de l’intérieur le milieu que j’étudiais. Une recherche qui passait par les outils du sensible comme par les outils scientifiques dans leur interconnexion. Cependant jamais je n’ai enquêté ou observé avec une caméra pas plus qu’avec un appareil photo.
En définitive, quand j’ai débuté, je ne connaissais pas grand-chose mais j’avais un repoussoir, Le Film ethnographique qui m’a aidée par défaut. Dès le début du tournage de mon premier documentaire Les Temps du pouvoir (1983), les voix contradictoires des personnages installaient le récit dans un paradoxe13. Ce mode « d’installation » construisait la mise en scène que je vais maintenant questionner geste par geste à partir de quelques-uns de mes films tournés dans les situations d’enfermement évoquées plus haut.
Image 3 - Hélène, Le Reflet de la vie
© É. de Latour
Légende
Le Reflet de la vie porte sur huit personnages de plus de 85 ans dans un village cévenol. Qu’est ce qui fait rempart au déclin et à l’enfermement quand on est rejeté hors l’économie sociale dominante et qu’on se trouve dans la dernière ligne droite de sa vie ?
Le plan synchrone paraît aller de soi mais il arrive que le doute remplace l’évidence. La question du synchronisme se posa pour un des personnages du film Le Reflet de vie que je tournais en 1989 dans le sud de la France. Hélène vivait dans un hameau, elle y était née, elle s’y était mariée, elle y avait eu ses enfants. Seule sur ce pic montagneux, elle voulait mourir là. À mon arrivée, je découvrais une très belle femme au visage sculptural, mais elle se déplaçait lentement avec deux grands bâtons ; ses dents mal accrochées la gênaient parfois lorsqu’elle parlait. Devant ses faiblesses, je décidais de la photographier et non de la filmer, alors que la photo n’était pas partie intégrante de l’esthétique du film. Je posai sa voix sur les images.
Si j’avais utilisé le synchrone, le regard se serait centré sur les handicaps plutôt que sur la force et la beauté de cette dame au profil d’oiseau. Cela aurait été injuste car en sa présence on oubliait vite ces détails cliniques. Si la vie entre dans le cinéma, le cinéma ce n’est pas la vie !
J’utilisais aussi la dissociation de l’image et de la parole pour Emma, nonagénaire dans l’épreuve de la solitude : le quasi-silence et l’ordre régnaient chez elle. Pendant sa longue plainte (en off) sur le grand âge, je restais en plans fixes sur ce décor« faux rustique » briqué et que personne ne voyait. Cet ordre ciré signifiait son attente dans le vide.
La projection sur écran amplifie tout, c’est pourquoi la construction du regard procède par élimination au tournage et au montage. Aller vers l’épure pour dessiner le sens donné à une scène en se débarrassant des informations inutiles.
En 2009, j’entamais un travail ethnologique sur l’économie sociale des ghettos de freshnies, jeunes filles qui se vendent. Ils sont traversés par les drogues dures et la violence. Je compris vite qu’avec les passes à 1€50 et les lieux du sexe loués quelques centimes, les Go de nuit étaient renvoyées à l’infamie dans le regard social, même dans celui des autres prostituées ou des filles « libres » de leur génération.
La photo arrivée un peu par hasard fût pour moi le moyen de trouver une légitimité. Jamais je ne revenais sans les tirages sur papier qu’elles s’arrachaient. Elles se trouvaient belles dans ce reflet, elles y voyaient un éclat qu’elles pensaient socialement perdu et me guidaient vers un travail photographique centré sur des portraits posés, le jour, la nuit. J’étais à la recherche de leur subjectivité dans ces lieux fracassés.
Les tirages se mettaient à circuler alors que, précisément, leur image les enfermait. Elles les envoyaient à leurs parents dans l’ignorance de leurs activités, les utilisaient pour leurs funérailles, les gardaient pour leurs enfants plus tard, etc. Une photo comme « pain to power » (du pâtir à l’agir). Bien que rongées par le doute et l’incertitude, ces jeunes filles transgressaient les normes bravaient la honte dont elles souffraient, mais elles ne revenaient jamais à la soumission qu’elles avaient endurées enfants.
L’idée d’une exposition et d’un livre (Latour, 2011) dédiés à leur dignité coulait de source mais je ne voulais rien faire dans leur dos et j’ai demandé leur autorisation active et signée pour faire apparaître leur visage sur la place publique quand souvent elles souhaitaient rester clandestines par honte. Je leur ai promis de ne jamais rien exhiber en Côte d’Ivoire et, en échange, de les aider si jamais les photos se vendaient.
Cela ouvrit un deuxième volet à mon travail d’investigation (www.elianedelatour.com).
Le parcours scénographié reliait le sens de mon expérience subjective avec ces filles. Les matériaux fixes, iconographiques et scripturaires, laissaient le spectateur libre face aux situations extrêmes dans un monde inconnu. Il s’arrêtait, passait, revenait, guidé par les cartels et les cimaises. De nombreuses visiteuses s’effondraient en larmes à la fin. Il fallu apporter une chaise et une petite table à côté de la porte de sortie.
Tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction.
(Godard, 1959)
En 1992, je partais tourner Contes et Décomptes de la cour au Niger. Juste avant mon arrivée, le mari déplaça Hadiza sa cinquième femme dans un village à une trentaine de kilomètres de là. Pour éviter les bagarres entre les quatre plus âgées et la plus jeune, disait-il. En fait, il voulait la voir à sa guise. Il en était empêché chez lui : la loi musulmane exige l’équité entre les femmes. Bien avant l’entrée de Hadiza dans la famille, il avait décidé d’un partage de deux nuits par femme. Il fallait donc attendre huit nuits avant que la plus jeune ne revienne ; les tours d’horloge conjugaux doivent être rigoureusement semblables dans la maison familiale. Mais à l’extérieur, le chef n’était obligé de rien, il n’avait aucun compte à rendre.
Dans cette cour où je passai 9 semaines, mon regard se déplaça résolument du côté des quatre plus âgées. Quand c’était leur tour, elles apportaient nourriture, eau chaude, elles prenaient la cuisine de la maison en charge ; le jour, elles apportaient nourriture, eau chaude dans la chambre du mari qu’elles préparaient ; la nuit, elles arrivaient parées de leurs plus beaux atours pour finalement trouver le lit vide.
Hadizame disais-je n’apparaitra que dans la pensée de ces femmes délaissées. Je n’avais plus envie d’aller la filmer dans son contexte et ne saisis d’elle que trois plans devant sa coiffeuse où elle se préparait pour le tournage à venir. La scène de cette jeune femme face à son miroir allait au-delà de l’action objective. Par « fictionisation » du réel, l’image correspondait en tout point à la rémanence qui occupait l’esprit des quatre autres : une coquette parée de son éclatante beauté et de la préférence du mari que sa mise affichait. Cette séquence, découpée en quatre plans déréalisés au son rendait la belle poupée émotivement présente par son obsédante immatérialité.
De cette mise en scène émergeait une vérité qui transcendait les discours convenus des femmes autour de l’obéissance à l’islam pour justifier leur claustration. Bonne pour nous, bonne pour nos enfants, répétaient-elles. Une part de vérité qui n’épuisait pas leur ressenti. La souffrance liée à l’enfermement ne pouvait éclater que sous la pression trop forte du huis clos dès que la plus jeune revenait à leur esprit comme un éclair. Le cinéma sait condenser les émotions : une vérité « officiellement » cachée se transformait en enjeu majeur du film.
La description cristalline atteignait déjà à l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, mais la narration falsifiante fait un pas de plus et pose au présent des différences inexplicables, au passé des alternatives indécidables entre le vrai et le faux.
(Deleuze, 1985)
Rien n’est donné à l’état « naturel », tout reste ouvert. La « narration falsifiante » par ses réponses formelles dit notre rapport au monde en remontant une réalité par fragments associés librement à l’intérieur d’un point de vue.
Au départ mon projet portait sur l’économie des femmes cloîtrées qui avaient du temps libre mis à profit dans des petites entreprises individuelles. Les hommes qui enferment les femmes doivent en avoir les moyens, ils se privent du travail que toute épouse dans cette région doit accomplir : chercher le bois, l’eau, faire le marché. Ils se voient obligés de rémunérer des personnes qui prennent ces tâches en main.
Goshi, Rabi, Amaria étaient au centre de petites activités agricoles : troupeaux, jardins potagers, fabrique d’huile d’arachide, tissage de couvertures, sarclage des petits champs etc. Des intermédiaires leur apportaient les fruits de leurs exploitations qu’elles transformaient en plats cuisinés ensuite revendus dans le bourg par les petites filles de la cour. Grâce à ce one penny capital, elles maintenaient une socialisation en participant aux baptêmes et, lors des mariages, elles entraient dans les échanges croissants de dons et contre-dons entre mères de filles à l’occasion de la fabrique du trousseau de la fiancée traditionnellement offert par la lignée maternelle. Les grands partages sociaux traversaient les murs des quatre épouses qui maintenaient coûte que coûte leur présence à travers le mouvement des cadeaux et des visites de femmes dont elles étaient l’objet. Surtout ne pas être totalement soustraites au monde qui les entoure.
Lorsque j’arrivais la première fois, rien n’allait plus car Goshi, Rabi, Amaria manquaient de semences pour leurs jardins auxquels, à contrecœur, elles commençaient à renoncer en début d’hivernage. Le moindre bénéfice perdu signifiait une petite conquête de liberté en moins. Il y avait urgence à planter les semis : j’allai les acheter avec des engrais au marché de Niamey à 400 kms de là. En revenant, la fatalité modifiée avec un peu d’essence, je faisais complètement partie de la maison, devenant le témoin quotidien des petits événements que je percevais mal au début. En arrivant, j’ai eu l’impression qu’il ne se passait rien. Et comme on s’habitue au noir quand on sort du soleil, le minuscule devint événement. Les quelques poules et caprins de la cour prenaient un sens aigu. La petite fille qui chuchotait à sa mère d’apparentes banalités était son lien vers l’extérieur. Thème imprévu, la jalousie qui sourdait à l’égard de Hadiza devint aussi importante que le sujet économique initial.
Le scénario au départ était construit sur le dedans et le dehors. Le huis clos prévalu au montage, je jetai tous les plans tournés à l’extérieur mais gardais les transformations culinaires intra muros, symbole d’une capacité à retourner la faiblesse en force. Le recentrage sur Hadiza permit d’ajouter de la complexité en marquant aussi leur impuissance si violemment ressentie. Ce paradoxe plaçait l’ethnographie du lieu en tension. Nul besoin d’aplatir les personnages par leur fiche signalétique, nul besoin de l’histoire familiale factuelle14 : le cinéma prenait le pas sur ces informations pour toucher « autrement ».
La prison génère la passivité. Constamment pris en charge, un prisonnier n'a même plus à acheter un paquet de cigarette. En outre, désigné comme « rebut social », « inutile », il perd confiance en lui.
En abordant une nouvelle situation d’enfermement à travers la Maison d’arrêt de la Santé à Paris, je voulais laisser de côté les conditions carcérales déjà maintes fois traitées. Éviter aussi le langage du détenu qui puise dans le répertoire d’une novlangue (Latour, 1998) fabriquée par des hommes soumis au rythme des entrées et des sorties qui cherche un plus petit dénominateur commun lors de leur « passage ».
L’histoire d’une prise électrique interdite me guida vers les petits gestes de résistance, cette « débrouillardise » dont parle Goffman« qui investit les fins de l'institution pour en faire des moyens de la réalisation de ses propres fins » (1961). Cela passait par la fabrication d’une chauffe ou d’un thermoplongeur mais aussi par une conversation, un rire, un livre, une pensée, un dessin, un plat mitonné…Je m’approchais de la subjectivité des détenus et faisais le pari que derrière la prison républicaine identique pour tous, il y avait une prison par homme. Je demandai à sept détenus :« comment surmonte-t-on la privation de liberté ? » Cette question unique recevait une réponse écrite dans les cellules hors de ma présence. Du décor de 12 m2, le même pour tous, jaillirent huit histoires différentes. Dans la cellule, chacun puisait dans son être intérieur des rituels qu’il opposait à la contrainte carcérale en créant des liens réels et imaginaires selon son histoire propre.
J’opposais formellement la temporalité de l’individu à celle de l’institution. La cellule, lieu de l’intériorité de l’être humain, était traitée par la photo – l’image fixe « absorbe » le temps – et par leurs récits en voix off. Quant à l’institution pénitentiaire qui « impose une réglementation unique de l'existence » (Castel, 1961), je la filmais en caméra synchrone.
Les auteurs interprétaient leur propre « scénario » que nous mettions en scène lors des séances de photographies dans les cellules. J’avais droit à deux ou trois demi-journées par détenu pendant lesquelles nous chamboulions le décor en suivant le texte. C’est surtout le son qui me permit de moduler l’émotion, l’intériorité, la présence du corps des auteurs de chaque récit grâce à quatre sources différentes :
Le présent de l’homme –description d’un moment de vie ou témoignage face caméra– devait être dépassé pour faire sentir la durée subjective qui varie selon la sentence, un an, dix ans, vingt ans, perpétuité. Une peine courte ne s’appréhende pas de la même façon qu’une longue peine, ou que l’attente d’un procès pour un prévenu. Le recours à la stylisation permettait d’aller au plus profond de l'enfermement par les états intérieurs.
La double temporalité exprimait l’ambivalence entre l’intérieur et l’extérieur. On pourrait dire qu’un intérieur succédait à une autre intérieur et ainsi de suite dans une mise en abyme commune aux lieux où les hommes sont gardiennés.
Le récit de fiction est plus riche en informations sur le temps,
au plan même de l’art de composer, que le récit historique.
(Ricœur, 1984)
Image 7 – Affiche Bronx Barbès
© Comm
Légende
Toussaint et Nixon, se retrouvent au ghetto du Bronx où ils apprennent à braquer, ils découvrent l’argent facile, et l’amitié. Guerriers des temps modernes, ils sèment la terreur, rencontrent la lâcheté, la répression policière, la prison, la mort. Ils finissent par quitter « cette belle vie », « cette sale vie », pour un autre voyage qui doit leur apporter ce qu’ils cherchent : un nom, une place, une vie.
Bronx Barbès est un long-métrage de fiction issu de plusieurs enquêtes dans les ghettos des villes d’Abidjan et de San Pedro, ainsi que dans leurs prisons respectives. Sur place, je justifiais mon travail ethnographique par la perspective de réaliser un long-métrage, ce qui facilitait ma légitimité dans ces lieux où normalement j’aurais dû être chassée ! Certains ghettomen me disaient : « ne fais pas un film français mais un film américain. Et nous on sera les Wesley Snipe, les Samuel Jackson avec nos sciences. » Le milieu était très violent mais j’étais entourée de vieux pères qui me protégeaient comme ils auraient protégé un agent artistique venu de Hollywood !
Les films calebasse15–ainsi labélisés sur le continent noir– traitaient d’histoires de village, de magie, de mariage, souvent centrés sur les conflits « entre tradition et modernité ». Les personnages échangent des dialogues ciselés, « propres ». Ils ne représentaient plus la jeunesse qui a grandi entre les autoroutes et les supermarchés et qui s’est forgé un langage tumultueux en rêvant de vitesse, d’ici et de maintenant, tout en accommodant ce qui, pour eux, relève de la « tradition » dans les zones marginalisées.
Bronx Barbès16 fut un des premiers films d’Afrique francophone à traiter de la violence des cités. Il rompait avec le stigmate de « l’Africain bon enfant toujours content ». Un jour, mon assistant me questionna sur le « Politiquement correct » ; j’essayai de lui expliquer : « pour les Politiquement corrects, parce que vous avez la peau noire, on a pas le droit de dire que vous faites du mal et que vous êtes violents ». « Ils veulent nous minimisez alors ! » s’exclama-t-il.
Ce film s’installait non pas dans l’apparence extérieure des ghettos– le réalisme documentaire ne m’intéressait pas –mais dans l’image que s’en faisaient les ghettomen à travers leurs mythologies. Ils passaient des heures au pied du même mur tout en se voyant en guerriers de cité portés par un destin aux ambitions personnelles. Il faut faire monter son nom, lieu de l’honneur, qu’ils empruntaient à un panthéon labile où figuraient Scarface, Tarek Aziz, Tupac Amarou, Michaël Jackson, Marley, Le Che, Pablo Escobar... Le chaos et la mort qui jalonnaient leur vie étaient transcendés par des récits à la hauteur desquels je voulais me situer cinématographiquement tout en gardant l’ambivalence propre à ces mondes mis au ban où règne l’arbitraire : la puissance est éphémère, rien n’est acquis, toute position est réversible.
Je voulais trouver une représentation de leurs répertoires d’actions, leurs mythologies, leurs philosophies et leurs croyances en la sorcellerie. La fiction s’imposait pour faire apparaitre cette activité symbolique. Elle offrait en outre un contrat moral à ceux qui, encore coutumiers de pratiques illicites, devenaient des acteurs pour la première fois.
La scène des funérailles du vieux père Tyson est basée sur l’exploration d’un récit du ghetto entre rêve et réalité. Où le cercle des nouchi se forme autour du mort. Où la solidarité porte le groupe au-delà des mots. Où les joutes virilisées entre vieux pères manifeste l’invention de soi. Elle a été tournée dans une cour. Soixante figurants furent convoqués avec les dix acteurs du Bronx, des pleureuses, l’orchestre de six tambourinaires et l’équipe technique qui rassemblait une vingtaine de personnes. Les trois mouvements scénarisés de la séquence furent respectés et les dialogues aussi, au mot près.
Quand, à la fin de la séquence, je dis « Couper », tout le monde resta sur le plateau comme un grand chœur uni aux musiciens. Je tournai quelques plans live qui prolongèrent la scène avec profondeur. Le moment de ranger le matériel dans les camions devint impératif, pour autant personne ne s’en alla. La fiction plus forte que le réel entraina tout le monde dans le même récit émotif manifesté par une longue danse autour du cercueil. On chanta un mort imaginaire qui nous unissait.
Qu’ils s’appellent guerrier plein lorsqu’ils sont contents, fils de capote percée quand ils ne le sont pas, les nouchi parlent un français de rue que je découvrais, fascinée. Je notais tout.
« Les guerriers, on s’attrape !
Le guerrier, c’est l’homme fort qui prend son destin en main.
Il part pour la victoire, jamais pour la défaite.
C’est un grand brûlé.
C’est le sacrifice du ghetto.
C’est un sanguinaire.
C’est un blessé de guerre
Pour les guerriers va sortir (ndlr.la chance) Les Babylonnais n’ont qu’à se tenir.
Un guerrier est irrévocable à sa décision.
- Le guerrier plein, c'est comment ?
- Ya foy (pas de problème) ! Toujours dans les cherchements. »
Ce fut un plaisir d’écrire les dialogues dans cette langue trépidante, inventive et poétique, lorsque de nombreux réalisateurs africains usaient d’un français châtié dans leurs films. Sans doute, avaient-ils du mal à voir dans le nouchi l’œuvre d’inventeurs hors pair comme je le percevais. Accompagnée d’une gestuelle corporelle ample et forte, cette langue rapide donnait un rythme en soi qui me portait. Pour chaque scène, j’imposais un découpage en peu de plans assez longs, voire en un seul plan, pour ne pas casser le jaillissement organique et l’énergie des acteurs.
J’allais jusqu’au « faux plan séquence » afin de garder une unité de ton et « ellipser » les événements contingents. Ainsi, la scène du dispensaire avait deux buts, l’un de montrer que Toussaint laissé pour mort n’était que blessé ; l’autre, que sa vie au Bronx était désormais derrière lui. L’entre-temps des soins n’avait aucune importance. Le corps en sang devait être vite relié au visage sauvé pour marquer le passage forcé au ghetto de Barbès.
La scène du dispensaire avait deux buts, l’un de montrer que Toussaint laissé pour mort n’était que blessé ; l’autre, que sa vie au Bronx était désormais derrière lui. L’entre-temps des soins n’avait aucune importance. Le corps en sang devait être vite relié au visage sauvé pour marquer le passage forcé au ghetto de Barbès.
D’innombrables commentaires entendus ont questionné mon dualisme ambigu voire discutable : « chercheuse » d’un côté et « artiste » de l’autre ! Je ne suis pas clivée entre imagination et raison. Bien au contraire, ma réflexion lie intimement cinéma et ethnologie au travers d’outils conceptuels qui les unissent : contexte, temps et espace, récit, paradoxe, ambivalence, émotions, subjectivité, style, point de vue ou cadre, langues, acteurs, performativité ou « recherche-action », engagement…
A son invention, le cinéma était considéré comme un « art d’enregistrement » du réel et l’ethnologie était chargée de rapporter la réalité des régions récemment colonisées. Dès les premiers plans des grandes explorations, s’est conclu un mariage « pour le pire ». L’ethnologie asservissait son partenaire au sein d’un « couple » qui semblait aller de soi : l’évidence et la routine étouffent rapidement les meilleures intentions !
Une forme de réconciliation eut lieu quand, dans les années 1980, l’ethnologie s’ouvrit à de nouveaux paradigmes qui engagèrent les sciences sociales vers un « art du déchiffrement visant à déployer la pluralité des couches de signification » (Ricœur, 1983) ; un art propre aussi au cinéma quand il dépasse la littéralité des événements ou l’apparence des faits et gestes pour mener à la compréhension d’un souffle, d’une larme, d’un silence, d’un déhanchement, d’un cri, d’un trait tiré sur un mur… d’un entre les mots.
Que le projet passe par le réalisme documentaire, une fable ou une fiction lourde à effets spéciaux, est une question de style mais pas comme on l’a longtemps cru de « vérité scientifique » ; celle-ci émerge de la justesse de la « vision » selon Proust soutenue par la pertinence d’une mise en scène au service d’une pensée. Souscrire à cette assertion, c’est aussi voir une même question enrichie par la multiplication des angles et tendre vers des hybridations créatrices.
Plutôt que chercher ce qui appartient au réel, à l’imagination, à la rencontre… il faut accepter les gestes de connaissance dans leur complexité créative et réflexive, afin qu’un jour une thèse filmée ait la même valeur qu’une thèse écrite, que les financements du 7ème art aillent aussi vers des travaux dont le questionnement perpétuel est le moteur.
Je m’intéresse à l’avenir car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes jours.
(Woody Allen)
1 En référence magnifiée au ghetto américain, « ghetto » est le nom donné par les jeunes marginaux inventeurs du nouchia, la culture de rue, pour désigner un lieu dans la ville où ils se retrouvent pour trainer comme pour partager des expériences illicites. On parle aussi de « fumoirs » (cannabis et autres) car ce sont toujours des points de drogue. Par extension, les quartiers établis dans des zones urbaines illégales sont nommés « ghettos ». De manière générale, cela renvoie à une forme de précarité.
2 Je ne parlerai pas ici de l’image comme objet d’analyse. Mais seulement de l’image fabriquée par un auteur et regardée par un spectateur.
3 Il s’agit ici des explications plaquées sur les scènes en aucun cas de la parole ou la graphie sur l’image qui peut apporter un sens autonome. Loin de moi de vouloir récuser toute voix off ou commentaire qui, pensés à l’intérieur d’une mise en scène, incarnent l’acte cinématographique au même titre que le reste. Pensons à Chris Marker ou à Scorcese et beaucoup d’autres.
4 Cité par Puig de la Bellacasa Maria, Les Savoirs situés de Donna Haraway et de Sandra Harding, Paris, L’Harmattan, 2014.
5 L'expérience de la marginalité est située dans ses contextes urbains et biographiques.
6 On a souvent séparé chez Rouch la fiction du documentaire, ce qui à mon avis n’a aucun sens.
7 Bien souvent les décryptages renvoient aux fantasmes des ethnographes symbolistes et Rouch en fait des contes oraux plus que la restitution de connaissances.
8 Je ne parle pas ici du « réalisme social » qui, dans maints domaines, a permis de remettre au centre le pauvre, le paysan, le marginal, l’anonyme… En peinture, le baroque et les bas-fonds, l’école naturaliste du XIXe siècle. En cinéma, le néo-réalisme italien qui devint un courant international. En histoire et sociologie, les subaltern studies. En littérature, les naturalistes comme Zola, Dickens...
9 L’administration du cinéma différencie les genres pour la gestion des aides, la typologie des salles de cinéma, les dénominations de festivals, l’organisation des départements (télévision, médias…).
10 Cela n’empêche pas les sélections sur critères plus spécifiques : documentaire, films de femme, ethnologique, programme de télévision, films français, cinémas d’Afrique, etc.
11 Au long de ce cheminement, je ferai appel à certains de mes travaux : trois documentaires, une fiction, une exposition de photos. Je mobiliserai aussi deux Making of de ces films.
12 Voir l’interview de Bruno Nuytten par Anne Diatkine, « Revenir aux premiers chocs rétiniens » dans le journal Libération du 18 mars 2018.
13 Les Temps du pouvoir : un chef coutumier hausa au Niger près de la frontière du Nigeria. Derrière la magnificence de la cour du prince de sang se cache une impuissance. Il rend la justice, parade et prie ostensiblement mais se courbe devant le sous-préfet et marque une gêne devant les vieux animistes qui reprochent aux musulmans - dont il fait partie - d’avoir « gâté » la terre des ancêtres. Il était possible de ne filmer que les rituels fastueux de la chefferie en tradition partagée par les ethnographes et les indigènes. Mais j’ai préféré la complexité à l’univocité.
14 Avant d’être chef coutumier, le mari était gendarme et vivait avec ses quatre épouses dans une grande ville. Hadiza arriva avec l’intronisation, un rituel qui prend la forme d’un mariage par lequel métaphoriquement l’homme épouse le pouvoir symbolisé par une jeune vierge. Mariage devenu ensuite réel selon le souhait du chef.
15 Films « calebasse ». On appelle ainsi des films réalisés surtout au Burkina dans les années 1980/90, devenus un modèle pour l’Afrique francophone. Il a beaucoup été dit que cela correspondait à l’image de l’Afrique que les financiers occidentaux attendaient.
16 Le Monde, juin 2001 : « Bronx Barbès plébiscité à Abidjan. En Côte d’ivoire, le film d’Éliane de Latour est en passe de battre le record de Titanic ». Une époque où il y avait des salles de cinémas dans le pays. Le phénomène, qui s’est répercuté sur les pays d’Afrique francophone, fût si important que Le Monde en fait une demi-page.
BAZIN André (1960), Qu’est-ce que le cinéma?, Paris, Éditions du Cerf.
BAZIN Jean, BENSA Alban (1994), « Les objets et les choses : des objets à “la chose” », Genèses, 17, pp. 4-7.
BARTHES Roland (1980), L’Empire des signes, Paris, Flammarion.
BRAGANTINI Attilio (2013), « Identité́ personnelle et narration chez Paul Ricœur et Hannah Arendt », Lo Sguardo - Rivista di filosofia, n° 12, 2013, pp.135-149.
CASTEL Robert (1961), « Préface », Asiles. Études sur la condition des malades mentaux, Paris, Éditions de Minuit.
DE CERTEAU Michel (2002), L'Invention du quotidien, Tome1, Paris, Gallimard.
DELEUZE Gilles (1985), L’Image temps, Paris, Éditions de Minuit.
FOUCAULT Michel (1975), Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
FAVRET SAADA Jeanne (1977), Les Mots, la mort et les sorts, Paris, Gallimard.
GARFINKEL Harold (1967), Recherches en ethnométhodologie, Paris, PUF.
GEERTZ Clifford, (1973), « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », Traduction de André Mary in Enquête (1998), pp. 73-105.
GODARD Jean-Luc (1959), « L’Afrique vous parle de la fin et des moyens. Moi un Noir », Cahiers du cinéma, n° 94, pp. 182-184.
GOFFMAN Erving (1961), Asiles. Études sur la condition des malades mentaux, Paris, Éditions de Minuit.
DE LATOUR Éliane, http://elianedelatour.com/
— (2016), Little Go girls. Long métrage, sortie salle 9 mars, distributeur JHR.
— (2014), Go de Nuit, Les belles retrouvées. Exposition de photo (Maison des métallos), Paris.
— (2011), Go de Nuit, Les belles oubliées. Exposition de photo (Maison des métallos), Paris.
— (2011), « Les jeunes invisibles », Éd. Taama, Paris.
— (2000), Bronx Barbès. Arte cinéma, Canal Plus, France 3, Les films d’ici. 120’.
— (1996), Si bleu si Calme. Arte cinéma, Canal Plus, Les films d’ici. 70’
— (1998), « La Prison intérieure », in Trafic, n° 26, Été, pp. 36-45.
— (1993), Contes et Décomptes de la cour. Arte, AATON, CNRS image. 80’.
— (1989), Le Reflet de la vie. Arte, CNRS image, AATON. 30’.
LEROI-GOURHAN André (1948 [1983]), « Cinéma et sciences humaines : le film ethnographique existe-t-il ? », in LEROI-GOURHAN André (dir.), Le Fil du temps, ethnologie et préhistoire, Paris, Fayard, pp 59-67.
LEVI-STRAUSS Claude (1964), La Pensée sauvage, Paris, Plon.
MONDZAIN Marie Josée (2008), Image, sujet, pouvoir. Entretien avec Marie-José Mondzain par Michaela Fiserova, Paris, Le Seuil.
PIAULT Marc-Henri (1982), « Le héros et son destin. Essai d'interprétation des traditions orales relatant la genèse d'un État du Soudan central, le Kabi, au XVIe siècle. », Cahiers d'Études africaines, vol. 22, 87-88, pp. 403-440.
PUIG DE LA BELLACASA Maria (2014), Les savoirs situés de Sandra Harding et Donna Haraway. Science et épistémologies féministes, Paris, L’Harmattan.
PROUST Marcel (1927), Le Temps retrouvé, Paris, La Pléiade.
RICŒUR Paul, cité par Sabina Loriga (2013), « Le temps vécu dans le récit de fiction et dans le récit historique », Enthymema. En ligne : https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/3526
RICŒUR Paul (1988), « L'identité narrative », Esprit, n° 140/141 (7/8), juillet-août, pp. 295-304.
RICOEUR Paul (1983), Temps et Récit 1, Paris, Le Seuil.
Eliane De Latour, « La fausse bataille de l’art et de la science. Mise en scène cinématographique en ethnologie », Revue française des méthodes visuelles. [En ligne], 2 | 2018, mis en ligne le 12 juillet 2018, consulté le . URL : https://rfmv.fr