

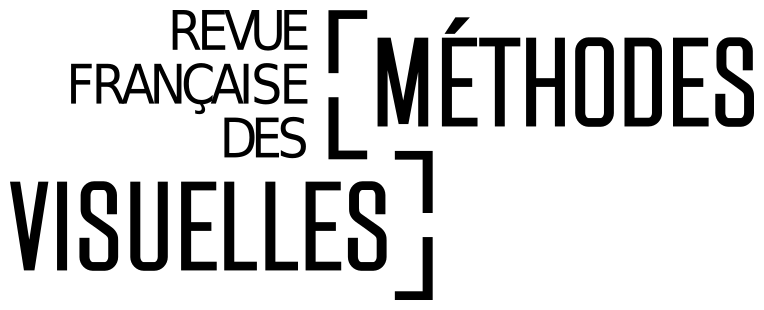
Pierre-Marie Chauvin, Université Paris Sorbonne, GEMASS
L’article restitue une expérience pédagogique de sociologie visuelle réalisée dans l’Émirat d’Abou Dhabi. Intitulée « Mussafah Shots », du nom de la petite ville industrielle dans laquelle s’est située l’enquête, cette expérience est présentée ici à travers un ensemble de photographies (N = 20) commentées et ordonnées en deux séries : des photographies d’espaces publics et de mobilités, et des portraits de travailleurs migrants révélatrices de leurs conditions de travail mais aussi des relations enquêteurs / enquêtés. À travers ces séries, et un travail de contextualisation des images appuyé sur des méthodes complémentaires (observations, entretiens, documentation) l’article propose un portrait visuel de Mussafah, souvent considérée comme l’un des « poumons industriels » d’Abu Dhabi. L’article entend ainsi contribuer à la réflexion sur valeur de la photographie considérée comme « trace » de relations sociales plutôt que comme trace révélant la vérité d’un terrain.
Mots-clés : Sociologie visuelle , Photographie , Trace visuelle , Émirats , Ouvriers , Pédagogie , Relation d’enquête , Intersectionnalité
This article presents a pedagogical experience of visual sociology in Abu Dhabi. Labelled “Mussafah Shots” in reference to the small industrial city in which the experience was carried out, this experience is synthesized by a set of pictures (N=20) that are commented and displayed in two series: some photographs of public spaces and mobilities, and some portraits of migrant workers revealing their working conditions but also the relationships between the inquirer and the inquired. Through this series of photographs and an effort of contextualisation based on complementary methods (observations, interviews, documentation), the article offers a visual portrayal of Mussafah, which is often considered as one the “industrial hearts” of Abu Dhabi. The article aims at contributing to the reflection on the value of photography as a “trace” of social relationships rather than a trace revealing the truth of a fieldwork.
Keywords : Visual Sociology, Photography, Visual Trace, Emirates, Workers, Pedagogy, Intersectionality
Cet article restitue de manière réflexive une expérience pédagogique menée à l’Université Paris-Sorbonne d’Abou Dhabi (PSUAD) auprès d’une dizaine d’étudiants de Licence 1 et 21. Après une semaine de cours magistraux consacrés à l’histoire de l’anthropologie et de la sociologie visuelles ainsi qu’à la photographie documentaire, nous avons préparé et réalisé une brève expérience de recherche dans une petite ville industrielle de l’Émirat : Mussafah. L’objectif de cette enquête de terrain était double : montrer les intérêts de l’outil photographique – en complément d’autres méthodes – sur un terrain peu voire pas étudié, et globalement méconnu des étudiants ; et proposer une réflexion sur la visibilité, l’invisibilité et les « traces » visuelles saisissables des travailleurs d’une ville industrielle ouvrière et cosmopolite.
Mussafah fait ainsi partie de ces territoires cachés du regard et pourtant essentiels pour le fonctionnement économique des Émirats. Rendue invisible à la fois par les buildings spectaculaires de la ville « principale » et par les images de papier glacé servant à construire la réputation de l’Émirat, cette petite ville constitue un bon cas d’étude, par le décalage entre son importance économique, son invisibilité publique et médiatique, et son potentiel photographique. Ce dernier repose sur une combinaison originale entre de grands espaces vides (larges allées reliant les usines), des espaces plus denses (résidence de travailleurs, quartier des ateliers), des contrastes sociaux forts (galerie d’art contemporain au milieu des usines) et un foisonnement de détails matériels inhérents aux corps et aux matières qui le composent, traduisant la « vie au ras-du-sol » des travailleurs migrants qui l’habitent.
Abou Dhabi (également orthographiée Abu Dabi ou Abu Dhabi) est à la fois le nom d’un Émirat du Golfe Persique et celui de la capitale de cet Émirat. Intégré à une Fédération des Émirats Arabes Unis constituée en 1971, l’Émirat d’Abou Dhabi couvre environ 80 % de la surface de la Fédération et constitue la plus grande puissance économique locale. Celle-ci est liée aux réserves pétrolières de l’Émirat, aux réserves du fonds souverain, mais aussi à la stratégie de diversification adoptée pour pallier la fin anticipée de la rente pétrolière. Les investissements réalisés depuis les années 2000 concernent tout à la fois l’immobilier, l’industrie, le tourisme, le sport et la culture. Ce développement économique est alimenté par une main-d’œuvre issue d’Asie du Sud-Est et d’Afrique pour ce qui est des travailleurs du bâtiment et de l’industrie, mais aussi d’une main-d’œuvre de pays occidentaux venant épauler et accompagner les « élites locales » dans leur activité d’encadrement. L’une des particularités du développement économique spectaculaire des Émirats et en particulier d’Abou Dhabi, outre sa rapidité, repose sur son caractère hybride, mêlant des éléments d’une société arabo-musulmane traditionnelle que les autorités tentent de préserver, et des dynamiques libérales (économiques, culturelles ou relatives aux mœurs) que les étrangers occidentaux contribuent à importer et que les élites locales stimulent plus ou moins explicitement.
Mussafah est une petite ville industrielle (14 km2) située à 30 km dans la banlieue sud-ouest d’Abou Dhabi City (voir carte 2 et 3), dans un paysage qui était encore désertique dans les années 1960. Elle forme un carré urbain bordé d’eau au Nord et à l’Ouest, et dont le découpage interne correspond à un urbanisme en « blocks ». Méconnue des touristes, principalement fréquentée par les habitants d’Abou Dhabi pour ses ateliers de réparation automobile, cette ville-satellite constitue désormais l’un des « poumons » économiques de l’Émirat. C’est d’ailleurs ainsi qu’est présentée la ville dans les articles de presse locale qui lui sont consacrés : un port industriel dynamique, stimulé économiquement par des incitations publiques. Mussafah se trouve au cœur de la stratégie de planification urbaine menée par les pouvoirs publics pour 2030 (Stratégie « Abu Dhabi Vision 2030 », menée par l’agence de planification stratégique Abu Dhabi Urban Planning Council). Déjà considérée comme un district industriel en développement, les pouvoirs publics veulent consolider cette dimension de la ville en en faisant le site industriel le plus important des Émirats, tout en développant l’offre de logements, de commerces et de services.
Cette dimension stratégique justifie d’ailleurs les travaux d’architectes et d’urbanistes sur les modèles concrets de cette planification. Un article académique publié par des chercheurs en urbanisme (Brkovic et Milakovic, 2011) étudie le « cas Mussafah » en identifiant les modèles de planification possibles. Nous reproduisons ici la série photographique illustrant l’état actuel de Mussafah selon les auteurs (image 1) : il s’agit d’une planche de 7 photographies, dont une image satellite issue de Google Maps donnant à voir la forme géométrique de Mussafah et 6 autres photographies illustrant la nature industrielle du paysage de Mussafah (usines, bâtiments, ateliers…).
Plus généralement, les rares travaux consacrés aux Émirats et à Abou Dhabi en particulier (Texier et Doulet, 2016) ne disent – ni ne montrent – quasiment rien de ce type de quartiers industriels. Ces derniers constituent une partie peu visible du travail de « marketing territorial » (Corbillé, 2013) mis en œuvre par les pouvoirs publics depuis les années 1990/2000. Mussafah en particulier est loin de faire partie du cœur de cette stratégie de branding visuel, il s’agit plutôt d’un élément marginal de la stratégie réputationnelle « frontstage » (Zafirau, 2008) qui vise d’autres types de sites et d’infrastructures. Les images les plus courantes promouvant les Émirats sur les sites officiels ou touristiques sont celles des buildings et des hôtels les plus spectaculaires (la tour Burj Khalifa de Dubaï, l’Emirates Palace d’Abou Dhabi…), des plages ou promenades plantées les plus vastes (La Corniche d’Abou Dhabi), ou encore des infrastructures culturelles et touristiques récentes (Le Louvre) ou établies (Ferrari World). Derrière ces images, Mussafah fait plutôt figure d’univers « backstage » que l’on donne à voir de façon périphérique.
Comment rendre compte d’un territoire urbain contrasté, cosmopolite et masculin dans une zone méconnue du Golfe Persique, tout en proposant une réflexion sur la nature visuelle de cette connaissance à partir d’images photographiques et de textes descriptifs et analytiques ? Comment caractériser la vie sociale d’un quartier industriel (présence d’usines), artisanal (ateliers de réparation de voitures), « résidentiel » (résidence de travailleurs), plus récemment doté d’une composante « artistique » (présence de la galerie d’art au milieu de ce quartier essentiellement ouvrier) ? Pour répondre à ces questions, nous proposons un récit d’expérience combinant approche visuelle et argumentation écrite. Les photographies réalisées ont été prises2 dans la ville de Mussafah le lundi 17 février 2014. La sélection opérée entend proposer un essai visuel à partir de photographies prises par notre équipe lors de cette journée d’observation en les organisant en deux séries : une première série consacrée aux espaces et mobilités des travailleurs observés ; et une seconde série présentant portraits de travailleurs et relations enquêteurs / enquêtés.
Les photographies ne sont pas destinées à illustrer de façon secondaire un propos sociologique contenant la connaissance du monde social étudié. Elles donnent à voir une connaissance de ce monde, en en proposant un échantillon visuel, mais en lien direct avec un texte composé de trois éléments : un propos de contextualisation des pratiques photographiques et de leur place dans un protocole d’enquête, des légendes tenant compte des autres éléments récoltés (entretiens et observations), et un commentaire cherchant à dégager des éléments interprétatifs plus généraux par rapport à la question de recherche de sociologie urbaine. Ces textes sont censés cadrer, sans les refermer, la lecture et l’interprétation. C’est ainsi que nous concevons ces photographies comme les « traces ouvertes » de notre enquête, traces d’une configuration spatiale, de conditions sociales, et de relations sociales entre enquêteurs et enquêtés. La combinaison de cet essai visuel et de ce dispositif textuel est une façon de répondre aux exigences d’une articulation entre images et textes, encore balbutiante en sociologie (Maresca et Meyer, 2013 ; Chauvin et Reix, 2015 ; Vander Gucht, 2016).
On pourrait considérer que l’intérêt de Mussafah comme terrain d’investigation sociologique est d’autant plus grand que ses images sont peu nombreuses, peu diffusées et peu connues. Nous voyons surtout dans ce territoire un laboratoire social au sens où l’entendaient les sociologues de Chicago : un monde dans lequel les transformations, l’effervescence sociale et les contrastes sont autant d’objets sociologiques en mouvement ; un monde public également, au sens où l’espace public y est largement investi et constitue un site d’observation privilégié. Un espace principalement masculin, peuplé d’ouvriers d’origine sud-asiatique (Inde, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan…), aux marges du centre-ville, des buildings spectaculaires et des grands hôtels. Toutes ces raisons justifient le choix de Mussafah comme cas d’étude exemplaire d’une approche de sociologie visuelle, confrontant les images courantes d’un territoire aux images qui résultent d’un travail d’observation et d’enquête photographique.
Mussafah, peu propice au tourisme, constitue un terrain d’enquête pertinent pour les sociologues cherchant à comprendre ce qui se joue dans les territoires (péri)urbains des Émirats. Un sondage oral et informel effectué auprès des étudiants et des collègues de l’université confirma l’hypothèse d’un quartier méconnu, considéré de manière distante et utilitaire (comme un simple atelier de réparation automobile) par les élites locales et les expatriés occidentaux. Cette faible considération nous incita à en faire un lieu d’initiation à la pratique sociologique, et plus particulièrement à la sociologie visuelle.
Un repérage effectué à l’aide d’une collègue de l’université et de l’un de ses amis nous permit d’identifier des sites d’observation privilégiés3. Ce repérage facilita l’organisation d’une sortie d’une journée donnant la possibilité aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis théoriques en sociologie visuelle sur trois sites de Mussafah. La consigne donnée était de produire des photographies permettant de dresser un portrait visuel de Mussafah, ou, à tout le moins, un portrait visuel des sites d’observation choisis :
Les étudiants ne devaient pas nécessairement chercher à prendre le quartier « sous toutes les coutures », mais devaient surtout traiter visuellement des thèmes classiques de la sociologie et répondre à des questions précises sous la forme de « shooting scripts » (Suchar, 1997) :
Bien qu’orientée par ces lieux et ces questions sociologiques, la liste des prises de vue restait ouverte et pouvait intégrer des découvertes liées aux itinéraires des étudiants. L’outil photographique devait par ailleurs être complété par d’autres méthodes plus classiques comme l’observation avec carnet de terrain et entretiens semi-directifs avec les ouvriers rencontrés. Les personnes interviewées (sous la forme d’entretiens courts) étaient des hommes, travailleurs immigrés issus des pays suivants : Inde, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Philippines. Ces entretiens ont permis d’avoir quelques éléments d’information sur leurs conditions de vie, sans avoir pu pour autant obtenir des données systématiques. Parmi les éléments récoltés, figuraient notamment :
Au cours de cette journée d’observation, plus de 1 200 photos ont été prises par notre équipe. Nous en présentons ici une sélection restreinte (N = 20), donnant à voir les infrastructures et les dispositifs composant ces paysages industriels, mais aussi les visages et les corps des hommes qui les habitent et les font vivre. Si j’ai pu en tant qu’enseignant-coordinateur prendre moi-même quelques photographies (dont certaines sont jointes à cet article), je restitue ici surtout les photographies d’étudiants sélectionnées et présentées lors d’une exposition organisée à Abou Dhabi en février 2014 et à Paris en janvier 20154.
Ces différentes photographies constituent une pluralité de traces permettant d’informer visuellement sur ce territoire et sur les conditions matérielles de ceux qui y vivent : trace d’une segmentation sociale de l’espace, trace d’une situation sociale, d’une activité, trace de proximités et de complicités entre enquêtés, trace des visions des étudiants aussi, trace d’un rapport social entre photographe et photographié, et trace de notre passage au sein d’un territoire peu habitué à ce genre de pratiques.
Si Mussafah est souvent qualifiée de « ville industrielle », il existe aussi quelques commerces, et un établissement « culturel », et plus précisément une galerie et espace de résidence artistique dénommés « Art Hub ». Cette implantation, si elle est unique à notre connaissance dans cette petite ville industrielle, n’est pas isolée dans la territorialisation de l’art contemporain et de l’art d’avant-garde, qui s’accommode bien des friches industrielles et des zones désaffectées. Mais la singularité de ce positionnement précis repose sur l’actualité industrielle de cet environnement : il ne s’agit pas d’une zone délaissée économiquement suite à la mutation post-industrielle de l’économie locale, mais bien plutôt d’une zone en pleine effervescence économique, regorgeant d’usines et de bâtiments industriels en activité.
Le fait de choisir l’Art Hub comme l’un des lieux d’observation répond à au moins deux objectifs : d’une part, étudier la diversité interne et les contrastes de Mussafah ; d’autre part, justifier sans difficulté la sortie de terrain aux yeux des étudiants en leur permettant de commencer leur observation par un lieu valorisé socialement et dont le contenu fait l’objet de visites conventionnelles (image 2).
Un hangar propre extérieurement mais sans grand caractère abrite ainsi sur deux étages des expositions temporaires d’artistes contemporains en résidence ou d’artistes locaux et étrangers que la galerie entend soutenir. À cet espace d’exposition s’ajoutent des ateliers mis à la disposition des artistes en résidence. Lors de notre visite du centre, la galerie hébergeait une exposition éphémère consacrée aux artistes français.
Les étudiants étant invités à débuter leur observation au sein du Art Hub puis à sortir du hangar pour appréhender son environnement matériel immédiat (image 3). Le confort relatif de cette première observation leur permit de prendre leurs marques en tant qu’observateurs, en se trouvant dans un univers à la fois proche d’un point de vue social (les étudiants étant pour la plupart issus de milieux sociaux favorisés) et « intéressant » bien que méconnu par les étudiants concernés : la seule distance avec ce premier lieu d’observation reposait sur la potentielle intimidation d’une galerie d’art contemporain, espace auquel certains avaient pu être confrontés auparavant, mais qui n’était vraiment familier pour aucun d’entre eux. Cette petite distance sociale, plus horizontale que verticale, était aisément surmontable par ces étudiants, qui y voyaient l’occasion d’une sortie culturelle dans un territoire qu’ils ne fréquentaient que pour faire réparer leur voiture. Cette distance est sans commune mesure avec la distance sociale forte, verticale et descendante qu’ils ont rencontrée dans la suite de leur observation (voir supra).
Les photographies suivantes sont le produit des observations réalisées à l’extérieur de la galerie, à quelques dizaines de mètres de là, à l’approche et à l’intérieur de quelques usines de Mussafah. La proximité entre les deux espaces totalement hétérogènes à la fois du point de vue du type d’activités (industrielles vs artistiques) et surtout du type de segment socio-économique (ouvriers immigrés vs prix élevés des œuvres d’art) est l’un des principaux faits saillants de Mussafah.
Cette photographie restitue d’abord quelques caractéristiques matérielles de Mussafah : du sable en guise de trottoirs (comme souvent à Abu Dhabi), quelques objets et morceaux de matériaux qui y traînent, un arbre (nécessitant une irrigation régulière) à l’intérieur d’une cour d’usine derrière un mur d’enceinte assorti de fils barbelés. Et au second plan, la construction récente et colorée de l’Art Hub. Cette photographie donne à voir la contiguïté entre la galerie d’art et les entrepôts et usines voisines. Un ouvrier en tenue de travail croise une étudiante, sans que cela ne suscite aucune réaction chez le premier, la proximité de la galerie pouvant expliquer la présence d’une jeune femme « photographe », tandis que dans les autres lieux investigués, notre présence suscitera systématiquement des réactions de la part des sujets photographiés. Soulignons que rares sont les piétons dans l’espace public en général à Abu Dhabi, notamment en cours de journée, en raison des conditions climatiques et des infrastructures routières peu adaptées à la circulation pédestre. À Mussafah, où les distances à parcourir sont plus limitées que dans la grande ville d’Abu Dhabi, certains ouvriers marchent sur des distances courtes, à des fins fonctionnelles entre tel bâtiment et telle usine, ou tel petit commerce de détail. En journée, pour des trajets un peu plus longs (mais toujours au sein du carré urbain que forme Mussafah), ils se déplacent plutôt à vélo ou en scooter.
Cette photographie donne à voir un paysage caractéristique de la partie Ouest de Mussafah et plus généralement des zones industrielles des Émirats : le bâti industriel du second plan, le vide paysager du premier plan, des traces de pneus désordonnées sur le sol, et cet ouvrier en scooter au centre. Elle permet ainsi de mettre ainsi en évidence l’étendue de certaines zones industrielles de Mussafah, où les distances entre lieux fonctionnels augmentent, où les trottoirs de sable s’élargissent, rappelant le désert sur lequel s’est bâtie cette ville. Les larges allées voient se succéder les camions de transport de matériaux – ici à l’arrêt et en arrière-plan – et les mobilités individuelles des ouvriers, le plus souvent en scooter et sans casque, ou à vélo, et plus rarement à pied (voir l'image 4). Le langage photographique ici mobilisé propose une vision non personnaliste de la condition des ouvriers immigrés : cadrage large, composition organisée autour d’un ouvrier tranchant par son bleu de travail sur les couleurs paysagères et notamment le sable monochrome, prise de vue à distance du sujet photographié. Le premier plan accentue la taille des nombreuses traces de pneus, notamment celles des doubles pneus des camions de chantier, qui paraissent bien grandes en comparaison de cet ouvrier saisi de dos, roulant tête nue et à faible allure, probablement vers une usine voisine.
Les couleurs éclatantes des gilets portés par les ouvriers sont une caractéristique visuelle saillante des Émirats. Ils signalent leur présence d’une façon paradoxale : destinés à être visibles sur l’espace routier (ces ouvriers stationnent, marchent ou travaillent le plus souvent sur des zones utilisées par les camions, bus et automobiles), ils permettent également à leur employeur de les repérer facilement. Ici, hormis trois hommes en tenue civile, tous les ouvriers portent encore leur bleu de travail et ses gilets fluorescents. Outre « l’hyper visibilité » matérielle liée aux couleurs fluos des gilets portés, la photographie traduit le mouvement pendulaire journalier des travailleurs migrants entre l’usine et leur résidence. Le bus est lui-même affrété par leur employeur, et constitue autant un moyen de transport qu’un mode de contrôle des ouvriers. Les ouvriers ont peu de mobilités motorisées en dehors de ces allers-retours, et exceptions faites de quelques trajets en scooter pour ceux qui en disposent sur leur lieu de travail (image 5). Leurs mouvements sont contraints, contrôlés, et évidemment limités par l’absence de moyen de transport individuel.
L’arrière-plan de cette photographie n’est pas anecdotique, car il s’agit là l’ICAD Residential City, l’une des plus grandes résidences de travailleurs des Émirats. L’ICADaccueille ainsi plusieurs dizaines de milliers de travailleurs (ouvriers des usines voisines, des petits ateliers, mais aussi chauffeurs de taxi, etc.) dans des bâtiments de trois étages comprenant chambres collectives, sanitaires, cuisines et commerces. L’ensemble est un univers clos séparé de l’espace public par un long mur d’enceinte et des grilles.
Cette photographie a été prise à l’entrée de la résidence ICAD. Par leur position, au sein de la photographie comme lors de la prise de vue, les résidents et le « gardien » barrent l’entrée au visiteur. Nous observons ici un contraste entre leurs tenues colorées, dépareillées et singulières, et le bâtiment où ils vivent, très simple dans son architecture, uniforme et bicolore. Parmi les individus photographiés, seul le gardien respecte un code vestimentaire professionnel, à travers un uniforme jaune qui signale sa position hiérarchique plus élevée. Également immigré, cet homme travaille et habite à Mussafah depuis plus longtemps que tous les autres (25 ans) et il représente ainsi ces migrants ayant pu gravir quelques échelons d’une hiérarchie sociale rigide, mais sans s’affranchir du territoire masculin et populaire que représente Mussafah.
Un tourniquet métallique surveillé par un gardien régule l’entrée et la sortie des habitants. Tout visiteur extérieur doit demander une autorisation avant de pouvoir entrer et circuler dans la résidence. Cet ensemble immobilier constitue l’une des tentatives locales pour organiser et améliorer les conditions de logement des ouvriers, par ailleurs souvent logés dans des petits baraquements ou bâtiments préfabriqués jouxtant les usines ou les bâtiments en construction. L’un des quotidiens locaux titrait ainsi le 29 septembre 2015 à propos de la résidence : « L’ICAD fait évoluer les standards de logement vers un nouveau niveau5 », tout en soulignant que des améliorations pouvaient encore être accomplies, notamment dans le nombre de cuisines mises à disposition des travailleurs, ou encore dans le nombre de travailleurs par chambre à coucher, ce que nos entretiens avec les ouvriers ont pu confirmer.
Parmi les contrastes les plus spectaculaires relevés lors de cette journée d’observation, figurent les décalages entre les corps des ouvriers et ceux affichés sur les publicités le long des murs de la résidence de travailleurs. Certaines publicités concernent des espaces et dortoirs à louer, d’autres sont plus surprenantes, notamment lorsqu’elles exhibent des corps musculeux sculptés par le « fitness » et le « body-building » contrastant avec les corps fins des travailleurs observés devant la résidence. L’écart entre ce qu’énoncent, exposent et valorisent les outils promotionnels et la réalité de leurs référents supposés est ici particulièrement saillant, à moins que le public cible des publicités sportives ne soit pas ce monde ouvrier aux corps légers et usés mais plutôt les (rares) Émiriens et expatriés upper class qui passeraient devant l’ICAD. Cette deuxième hypothèse est probablement la bonne, car la salle de sport promue ne se situe pas dans le quartier de l’ICAD à Mussafah mais dans le « centre » d’Abu Dhabi City. Il existe toutefois au moins une salle de sport à Mussafah, et des espaces sportifs extérieurs seraient utilisés au sein de l’ICAD (source Gulfnews).
Cette photographie, prise à proximité de l’ICAD, montre des ouvriers traversant la route, escaladant une barrière métallique et se dirigeant vers un centre commercial « discount ». Contrairement aux hautes barrières et aux murs d’enceinte de la résidence, ces petites barrières métalliques sont allègrement franchies par les travailleurs, qui ont équipé et routinisé leur passage avec cette pierre posée verticalement en guise d’appui. La proximité des corps, leurs regards complices et amusés, signalent les petites libertés individuelles et solidarités collectives que ces ouvriers déploient au quotidien dans une vie très cadrée.
Les carcasses d’automobiles, de vans et d’autocars constituent l’un des paysages familiers des quartiers industriels des Émirats. Les accidents routiers représentent un problème social dont les pouvoirs publics et les médias font souvent écho comme l’une des priorités politiques du pays. D’un point de vue pratique et économique, les véhicules accidentés donnent lieu à un travail et à un commerce de pièces détachées dont Mussafah est l’un des terrains privilégiés. Le troisième espace investi lors de cette expérience d’observation fut le quartier que nous pouvons qualifier de « quartier métallique » tant y règne l’automobile sous toutes ses formes : ventes d’automobiles (on trouve notamment un concessionnaire Porsche à l’entrée de Mussafah), ateliers de réparation et petits commerces de ventes de pièces détachées, épaves de voitures ou de minibus plus ou moins abandonnées constellent un espace public quotidiennement fréquentés par des visiteurs « extérieurs ». Émiriens, expatriés occidentaux et chauffeurs (de taxis ou de bus) viennent y faire réparer leurs véhicules et connaissent le quartier pour cette seule et unique raison en général
Cette photographie signale l’entrée d’un recycleur et marchand de métaux chez qui nous avons pris une série de photographies. Le vélo à l’entrée signale l’un des moyens de locomotion les plus empruntés entre ces ateliers et les commerces environnants. Le mur et ses couleurs, ici peu mises en valeur et en quelque sorte ternies par le sable gris qui l’entoure, seront l’un des éléments visuels forts que nous retrouverons en arrière-plan d’un portrait de travailleur (image 11). Le vélo et l’entrée sableuse, le bilinguisme du panneau indicatif, ce mur bicolore, les antennes et paraboles signalant que ce lieu de travail est aussi un lieu de vie, constituent autant d’éléments nous permettant de faire la transition vers la seconde série de photographies, consacrées aux portraits de travailleurs du quartier « métallique ».
Nous avons pu montrer à travers ces 10 premières photographies commentées des éléments de la morphologie spatiale et humaine de Mussafah : contiguïté paradoxale de la galerie d’art et des paysages industriels, espaces peu denses de la partie ouest du quartier (usines et larges artères) opposés à l’espace plus concentré que représentent l’ICAD et ses environs, barrières plus ou moins franchissables qui organisent les mobilités des ouvriers, morphologie des corps publicitaires visant les expatriés contrastant avec la fragilité des corps ouvriers… Ces photographies sont pour la plupart prises sur le vif (à l’exception de la photographie posée des étudiants ouvrant la série), en plan large, et à une distance que l’on pourrait qualifier de « publique » selon la typologie de Edward T. Hall (1978). Nous allons voir que la prochaine série de photographies, consacrée aux portraits de travailleurs et aux relations entre enquêteurs et enquêtés sont en général des photographies posées, aux cadrages plus serrés, et avec une distance photographe / photographié plus « sociale » que publique pour reprendre une nouvelle fois les catégories de Hall.
Cette dernière partie, consacrée à la question de la (non) visibilité des travailleurs, pose la question du portrait, mais aussi de ses limites. Parmi la sélection de photographies opérée, nous exposons notamment des photographies qui témoignent de difficultés ou de « ficelles » pratiques pour rentrer en relation (images 14 et 16). Les premiers portraits ont été pris dans la galerie d’art (Art Hub) et ont été choisis pour la façon dont ils transgressent les normes de visibilité et d’invisibilité locales. Figures ignorées de la division du travail, non photographiées, peu célébrées, généralement invisibles pour le regard du touriste ou de l’investisseur (image 12), ou peu visibles en raison du poids du genre dans la gestion de la main-d’œuvre immigrée (image 13), ils s’affichent ici avec de légers sourires, des regards doux tournés vers l’objectif, et une certaine surprise à être l’objet de l’intérêt et de l’empathie des étudiants de passage.
Les portraits suivants permettent de jouer avec d’autres dimensions du langage photographique, notamment le jeu avec l’imagerie publicitaire et l’intericonicité involontaire d’un buveur d’eau (image 18), ou encore le double cadre renvoyant à la condition « cadrée » des ouvriers migrants (image 14). Soulignons d’emblée le risque lié à de telles interprétations : l’imposition d’un biais ethnocentrique, esthétisant ou misérabiliste, qui efface la singularité sociale des sujets photographiés, que notre enquête n’a pas eu le temps d’interroger plus avant, si ce n’est sous la forme d’entretiens très courts. La question du bonheur et du malheur, du bien-être ou du mal-être des sujets photographiés, affichés sur ces clichés ont alimenté des discussions parmi les étudiants. L’intérêt sociologique de ces photographies, outre la mise en visibilité évoquée ci-dessus (ce qu’elles rendent explicitement ou analogiquement visible), réside dans la façon dont elles suscitent un questionnement sur la vie et le bien-être de ces travailleurs. En ce sens, les portraits photographiques interpellent le chercheur en sciences sociales tenté par les réponses catégoriques à ces questionnements, notamment dans un contexte de développement des indicateurs et des mesures de « bien-être » permettant de classer les performances économiques et/ou éthiques des pays. Nous ne donnons donc à voir ici ni le bonheur ni le malheur des travailleurs migrants, mais plutôt des traces du questionnement apparu chez nos étudiants à leur égard, ainsi que les traces de la mise en visibilité assumée positivement par les travailleurs photographiés. Cela peut également constituer une incitation (pour les enquêteurs comme pour les lecteurs) à proposer une meilleure connaissance de leurs conditions de vie. À cet égard la fonction sociologique des portraits est probablement plus pertinente du point de vue heuristique de l’invitation à la recherche, et du point de vue éthique de l’exposition des figures invisibles du travail ouvrier, que du point de vue positiviste de l’administration de la preuve à une question attendant une réponse bivalente (oui ou non).
Une fois sortis de la galerie d’art, les étudiants ont été confrontés immédiatement au monde des usines, des travailleurs pauvres immigrés, et il faut le souligner également, à un monde d’hommes peu habitués à voir et encore moins à échanger avec des femmes. Or la composition du groupe d’étudiants (5 femmes, 3 hommes) soulève la question du rapport de genre, et celle de son articulation avec le rapport social et le rapport ethnique entre enquêteurs et enquêtés. « L’intersectionnalité », souvent étudiée du point de vue du croisement des catégories d’appartenance des enquêtés est en effet aussi un enjeu du point de vue du rapport entre enquêteurs et enquêtés, dont les rapports de force ne se résument pas à une vision binaire « dominants » / « dominés ». Cette domination, si elle peut se manifester, répond à une articulation de différents critères que nous pouvons brièvement présenter ici.
Du point de vue social, la relation est asymétrique en faveur des étudiants-enquêteurs. Issus de milieux d’expatriés aisés, ces étudiants peuvent être situés dans la partie supérieure de la société émirienne, bien qu’eux-mêmes non-émiriens. Du point de vue du genre, la surreprésentation des jeunes femmes parmi les étudiants implique un rapport complexe, mêlant appréhension et curiosité de la part des étudiantes. Plusieurs m’ont confié lors de l’une des séances de cours préparatoires leur angoisse d’être confrontées à ces hommes inconnus, révélant un mélange de peur genrée d’une agression physique, verbale ou sexuelle, et d’une peur sociale du contact avec le travailleur pauvre, généralement invisibilisé, éloigné ou ignoré dans l’espace public6. À ce rapport social et genré s’articule également un rapport ethnique complexe jouant en faveur des étudiants soit en raison de leur appartenance nationale (étant issus de pays considérés de manière favorable dans la hiérarchie socio-ethnique implicite : Bahreïn, France, Mexique, Égypte), soit en raison d’une appartenance sociale aisée qui minore le handicap potentiel que pourrait représenter une appartenance nationale moins bien considérée (Afghanistan, Pakistan, pays d’Afrique noire francophone).
En raison de ces paramètres intersectionnels opposant potentiellement enquêteurs et enquêtés, nous avons formulé quelques conseils et recommandations au groupe d’étudiants : éviter les signes extérieurs de richesse, les bijoux, sacs ou vêtements griffés (hormis certains appareils photographiques de qualité que les étudiants possédaient) ; rester en groupe de 2 à 4 avec toujours un étudiant homme présent dans chaque groupe ; utiliser leurs compétences linguistiques et culturelles pour échanger avec des interviewés mais sans aller trop loin dans la connivence et l’intimité ; demander systématiquement l’autorisation de photographier aux individus concernés en expliquant qu’il s’agissait là d’un projet photographique en contexte étudiant, visant à mieux connaître Mussafah et ses habitants. Toutes les photographies que nous restituons ici sous la forme de portraits sont donc le fruit d’un consentement de la part des personnes rencontrées (parfois après la prise de vue). Peu habituées à être photographiées et valorisées, elles étaient souvent en demande de « pose » et souhaitaient participer à la mise en scène de certains liens, de certaines activités ou de certaines postures. Les photographies « posées » sont donc des traces de notre passage, en ce sens qu’elles traduisent non seulement l’observation de lieux et leurs hommes, mais aussi et surtout d’une interaction asymétrique au cours de laquelle les personnes « observées » peuvent devenir un peu plus acteurs de l’interaction et exposer de manière fière et positive leur environnement quotidien ou leur travail. Certaines poses exhibent bien la fierté – sérieuse ou joyeuse – que les enquêtés, pendant ces courts moments, souhaitaient mettre en scène.
Ce premier portrait propose un regard décalé sur l’Art Hub, non pas centré sur les artistes, mais sur l’un des travailleurs invisibles qui rendent possibles la production et valorisation des œuvres. Cet artisan aide les artistes en résidence et assiste la galerie dans toutes les tâches matérielles nécessaires aux expositions.
Le titre donné à cette photographie est une phrase que cet homme a prononcée pendant la prise de vue, marquant une opposition et une hiérarchie fortes entre les artistes et lui-même, s’assimilant plutôt au groupe des ouvriers, inintéressants et devant rester invisibles, selon son propre regard. Cette auto-dévalorisation a interpellé une étudiante, qui a voulu en prendre le contre-pied en valorisant cet homme et son travail par un cadrage serré sur son visage, et une mise en valeur de ses yeux. Ainsi cette photographie, accompagnée de cette citation, peut être considérée comme la trace d’une invisibilité intériorisée et retournée le temps de l’interaction.
Isolée des autres photographies, et sans contextualisation, cette photographie d’une serveuse dans la petite cafétéria liée à la galerie d’art de Mussafah passerait probablement inaperçue. À première vue, elle pourrait avoir été prise dans n’importe quel café d’institution culturelle. Pourtant, cette photographie est singulière en ce sens qu’elle est la seule photographie d’une femme travaillant à Mussafah parmi les 1 200 photographies prises lors de notre expérience de terrain. D’origine philippine comme beaucoup d’employées de commerce et de service résidant à Abou Dhabi, cette femme travaille sans hasard dans le secteur alimentaire, secteur genré à Abou Dhabi comme dans de nombreux pays. La logique genrée à l’œuvre dans la division du travail est particulièrement visible à Mussafah, en raison de l’absence de femmes dans les usines et les ateliers observés, ainsi que dans l’espace public. Cette femme nous rappelle ainsi par sa présence que le genre se manifeste non seulement par la présence de femmes et d’hommes dans certains espaces de la vie sociale, mais aussi par leur absence ou leur invisibilité organisées. Comme la première photographie, elle est le fruit d’une interaction homme-femme rare dans cet espace social (le photographe est un homme), ce qui peut aussi expliquer l’attitude souriante de la jeune femme photographiée.
Cette photographie prise à l’entrée d’une usine et à proximité de la galerie d’art montre un ouvrier encadré par un support métallique en cours de peinture. L’effet de ce double cadre, procédé photographique classique qui permet de renforcer l’attention portée au sujet, et de l’enserrer dans un cadre potentiellement porteur de sens, peut être lu de manière métaphorique, comme une façon de signifier la condition contrainte de travailleur migrant aux Émirats. L’étudiante qui a pris la photographie soulignait ainsi la double interprétation possible de cette photographie : clin d’œil à la cage d’acier de Max Weber, symbole de la rationalisation et de la spécialisation des tâches subalternes, ou symbole de l’échelle sociale que cet ouvrier ne pourra probablement pas gravir en raison des frontières sociales et ethniques très fortes qui caractérisent cette société ? Nous sommes là proches d’un « symbolisme naïf » (Vander Gucht, 2016) et à la limite du raisonnement sociologique, du moins sortons-nous de sa version démonstrative et empiriste, car la puissance métaphorique ou analogique des photographies n’est pas de l’ordre de l’administration de la preuve, et permet plutôt de « donner à penser » et d’incarner visuellement un concept. Par ailleurs, un dernier élément vient troubler une lecture fataliste et misérabiliste de la situation de ce travailleur : son sourire, qui révèle probablement plus l’interaction photographe / sujet photographié, basée sur la surprise et la sympathie éprouvées à l’égard d’une jeune étudiante égyptienne, que la « satisfaction au travail » voire le « bien-être » que certains étudiants ont pu lire au premier abord sur ce visage.
Cette photographie a été prise au bout de l’allée de l’Art Hub, devant une usine de construction et d’assemblage de matériaux. Nous pouvons distinguer à l’arrière-plan deux travailleurs qui sont comme deux figures lointaines, aux traits indéfinis et difficilement accessibles. L’intérêt de cette image est qu’elle marque un double arrêt. Le panneau, par sa position diagonale, coupe l’image et sa dynamique et oblige le spectateur à « stopper » le regard. Ce stop fait écho à l’impossibilité de pénétrer dans l’usine considérée. La présence de cette étudiante gênait visiblement les managers de l’usine, qui souhaitaient que les travailleurs restent en poste pendant nos observations, et ne soient pas perturbés par une présence doublement inhabituelle (femme, photographe).
La surreprésentation féminine au sein de notre groupe d’étudiants explique la curiosité et l’attitude interloquée, souriante ou « chambreuse » de certains travailleurs, dont cette photographie témoigne. Plusieurs hommes sourient, se regardent, échangent quelques mots et manifestent ainsi la présence incongrue de l’apprentie sociologue, à la fois en tant que femme et en tant que photographe. Les jeux de regards, les postures et les sourires sont ici en grande partie les produits de la dimension genrée du rapport enquêtrice / enquêtés, mais aussi de la dimension genrée de la vie quotidienne de ces hommes. Séparés physiquement de leurs éventuelles compagnes, femmes, et familles, relégués dans une zone périphérique essentiellement masculine, ils manifestent ici en quelque sorte l’absence de femmes dans leur vie sociale ordinaire. L’identité sexuée de la photographe et le contexte de production de la photographie sont ici décisifs pour éviter une mauvaise interprétation de la photographie.
Pour entrer en relation avec les résidents et gagner leur confiance, l’un des étudiants a acheté l’un des produits vendus sur les étales devant l’ICAD (une pâte à mâcher). Cette photographie, mise en scène par l’étudiant concerné, témoigne du lien monétaire, asymétrique et artificiel qui a été à la base de cette relation éphémère. Si la précédente photographie ne pouvait être comprise qu’en lien avec la dimension genrée de la relation d’enquête, cette photographie témoigne plutôt de la dimension sociale ou « classiste » du rapport enquêteur / enquêté. L’asymétrie sociale ne repose pas uniquement sur une inégalité économique monétaire, mais aussi sur l’asymétrie de position économique au sein du monde de production local. Si les travailleurs ont migré pour des raisons financières, et si leur faible salaire peut les « satisfaire » au regard des revenus plus faibles qu’ils auraient gagné dans leur pays d’origine, ils restent soumis à un statut de travailleur migrant « amovible », dont le sort repose sur la décision de l’employeur.
Cette photographie permet de montrer commun un portrait individuel situé peut donner à voir plus qu’un individu, mais aussi la trace d’un collectif d’appartenance et d’une socialisation. À côté d’un chantier de construction, nous avons repéré ce petit dispositif formé d’une ficelle et d’une bouteille fournissant de l’eau aux ouvriers. Les habits traditionnels de l’ouvrier immigré aux Émirats sont ici des motifs importants de la photographie, à travers des couleurs fortes, standardisées, repérables. Mais cette photographie témoigne surtout de l’importance vitale de l’eau face aux conditions climatiques locales, et plus généralement de conditions de travail fortement marquées par la chaleur et la sécheresse, mais elle indique également les micro-solutions collectives trouvées pour affronter ces difficultés.
Ici, la nature collective du dispositif ne fait pas de doute, il s’agit bien d’une bouteille partagée par les ouvriers, à proximité de leur espace de travail extérieur : la ficelle, le non-contact entre les lèvres et la bouteille ainsi que la mention « drking water » (version abrégée du nom renforçant sa dimension informelle) sur le mur constituent des traces de la socialisation du dispositif. Ce cas permet de souligner l’aspect non nécessairement « matériel » et « non humain » des traces interprétées, qui peuvent donc être d’ordre gestuel ou interactionnel. Ici la petite distance entre la bouche du sujet et la bouteille d’eau est les signes d’une collectivisation de cette ressource rare et d’une préoccupation personnelle d’hygiène de la part de ce travailleur. La posture corporelle de l’ouvrier, son bras parfaitement courbé, son geste fluide, sa prise d’eau distante, nette et sans bavure, la prise de vue de profil, la force des couleurs, constituent autant d’éléments plastiques qui ont interpellé les étudiants et ont convoqué chez eux des réminiscences d’images publicitaires pour des eaux minérales. L’« intericonicité » involontaire fait de cette photographie une image hybride du point de vue des étudiants : elle est la trace de la rencontre improbable entre la soif d’un ouvrier soumis à des conditions de travail rudes et le plus souvent invisibles, et la visibilité ritualisée des publicités pour consommateurs plus aisés.
Le commerce des métaux, qui est l’une des activités dominantes du quartier, se prête bien à un traitement visuel par sa matérialité: en plan large, on découvre ainsi les amas de matériaux, souvent réunis de manière apparemment désordonnée sur des petites surfaces, mais qui obéissent de fait à une organisation bien rodée. Tous les tas de ferrailles ne se valent pas, et l’opération de tri est essentielle dans le quotidien professionnel de ces employés. En plan rapproché (images suivantes), les matériaux, mais aussi les corps et tenues des ouvriers traduisent le rapport à la matière constitutif de leur quotidien.
Cette photographie est le portrait d’un ouvrier issu d’un atelier de pièces détachées. Avant et après la prise de vue, son activité consistait à séparer les pièces utilisables et les déchets, en compagnie de plusieurs collègues. Pendant notre observation, ces ouvriers cherchaient à montrer leur dévouement à leur travail et la plupart d’entre eux nous ont d’ailleurs demandé de les prendre en photos. L’ouvrier pose ici fièrement à côté des matériaux de son travail, un tas de ferraille au premier plan, et un amas de tôles compressées au second plan.
La dernière photographie (image 21) est de notre point de vue à la fois la plus singulière d’un point de vue plastique, et la plus difficile à commenter. Nous l’avons choisie comme photographie phare de notre exposition, en l’utilisant comme support d’affiche, et en la plaçant à la fin du parcours du visiteur sans commentaire particulier. Pourquoi ce choix ? Même si pour cette photographie, les mots peuvent sembler superflus ou inadéquats, tentons de repérer ce qui nous a interpellés dans cette photographie. Trois caractéristiques internes à l’image méritent d’être soulignées :
Le langage corporel et le langage visuel du portrait photographique se rejoignent ici pour construire une écriture visuelle sur le sujet de la condition des travailleurs migrants. Nous ne savons rien de cet homme (ni son nom, ni son origine, ni ses conditions de vie précises), mais la photographie interpelle, saisit et nous fait entrer dans une relation paradoxale où le sujet nous regarde, et nous invite à nous regarder nous-mêmes. Finir sur cette photographie est en quelque sorte une clausule paradoxale car notre entreprise méthodologique reposait sur l’articulation entre textes et images, et sur les informations contextuelles permettant de ne pas « sur- » ou « sous- » interpréter les photographies sélectionnées. Nous pouvons y voir là un argument en faveur de la construction de traces visuelles « ouvertes » que le commentaire ou la contextualisation littéraire ne viennent pas étouffer ou réduire. Autrement dit, la faiblesse des éléments connus à propos de ce dernier sujet et la force de l’image photographique se répondent pour ouvrir le champ des interprétations possibles, et inviter à donner à voir et surtout à mieux connaître les mondes sociaux invisibles, ou invisibles d’un certain public.
Nous avons présenté ici une série de photographies prises lors d’une courte expérience d’observation dans un terrain méconnu du Golfe Persique. Les trois espaces investis (l’Art Hub, la résidence de travailleurs, le quartier « métallique ») donnent un aperçu de la vie sociale à l’œuvre. Il serait probablement abusif d’y voir un échantillon visuel représentatif des grandes mutations des Émirats, mais il est possible d’y voir une trace rare de conditions de travail et de vie locales, doublée d’une trace d’une interaction, courte et nécessairement dotée d’une dose d’artificialité, au sein d’un territoire traditionnellement fréquenté de manière utilitaire et commerciale. Les photographies, observations et entretiens réalisés mériteraient d’être étoffés et étayés avec de nombreux autres matériaux pour aboutir à une enquête systématique. Cependant, ils permettent de montrer comment une expérience pédagogique, bien que limitée dans le temps et en terrain a priori difficile, peut être conduite en mettant à profit l’outil photographique. Celui-ci est plus qu’un instrument de captation du réel, il est un traceur de relations sociales, une ouverture vers d’autres mondes sociaux, permettant d’établir rapidement un rapport de confiance et d’échange avec les enquêtés. Ces derniers cessent d’ailleurs de l’être de manière passive à partir du moment où ils deviennent actifs dans le processus photographique, que ce soit par le choix des lieux, des poses, et des postures, ou par la prise même de photographie. Rompre l’étrangeté d’un lieu, le donner à voir par le choix d’espaces délimités, exposer les corps, outils et objets constitutifs de la matérialité d’un territoire, restituer les contrastes discrets et spectaculaires qui peuvent se nouer dans des espaces sociaux en mutation, voilà notamment les vertus méthodologiques de la photographie sociologique. C’est en ce sens que nous souhaitons pour finir réhabiliter la photographie comme trace, tout en montrant les enjeux de la construction d’une relation sociale entre enquêteurs et enquêtés, et tout en laissant ouvertes les interprétations et les usages des photographies présentées.
La notion de trace renvoie à la valeur documentaire, informative et substantielle d’une photographie. Si cette valeur a été abondamment théorisée sous la forme d’un réalisme indiciel7 (Krauss, 1977 ; Peirce, 1978 ; Barthes, 1980 ; Garrigues, 1998) et renvoie à une croyance populaire tenace, la trace n’a pas bonne presse en 2016 dans le champ des études photographiques8. Quelle est donc cette valeur (que nous nommerons « argument) » et en quoi consiste sa critique (que nous nommerons « contre-argument ») ?
Ce que la photographie montre – ou ne montre pas – permet de mieux rendre compte d’une réalité sociale en sauvegardant quelque chose du passé. Ainsi Emmanuel Garrigues écrivait en 1998 dans un article défendant « La photographie comme trace » :« Nous ne ferons pas le tour de différentes approches théoriques depuis le XIXe siècle ; mais nous retiendrons que toutes s’accordent à reconnaître à la photographie une dimension de trace. Trace chimique, physique, psychique, réelle ou métaphorique, symbolique ou imaginaire, indicielle ou iconique ; peu importe, car il y a au moins convergence sur cet aspect de la photographie comme trace » (Garrigues, 1998, p. 79). Si l’on suit ce raisonnement, la photographie comme trace, si possible articulée lors de sa restitution au sein d’un thème, peut donner lieu à une série photographique permettant de saisir les différentes facettes d’un phénomène. La puissance de désignation, l’attention au détail (Piette, 1992), l’observation prolongée que permettent la photographie peuvent être considérées comme des avantages méthodologiques de la photographie considérée comme trace. Cette vision qui s’éloignait déjà d’une conception strictement mimétique (la photographie reproduit le réel) en introduisant l’aspect fragmentaire, distant et mémoriel de la trace, va faire l’objet de critiques issues d’une forme de « tournant pragmatique » des théories de la photographie.
La critique venant de cette dernière approche vise le réalisme implicite de l’idée de trace. S’il y a trace, c’est que l’on conçoit la photographie comme le dépôt de quelque chose d’autre, une forme de réalité autonome dont on fait l’hypothèse qu’elle existe et qu’elle peut être saisie, ne serait-ce que de façon fragmentaire et subjective, par le photographe. La critique vise donc la valeur réaliste et illustrative, considérée comme mineure voire illusoire par un certain nombre de partisans d’une théorie pragmatique de la photographie. Comme l’explique André Gunthert (2016), la valeur indicielle de la photographie reposerait sur une « illusion essentialiste » consistant à concevoir l’image photographique comme la reproduction ou l’empreinte d’une partie du réel. Ce que soutiennent les contradicteurs de cette thèse essentialiste, c’est le fait que les photographies ne montrent pas, elles mettent en forme, construisent, et relient à travers des formes et des dispositifs pluriels des producteurs, des intermédiaires et des récepteurs. C’est par exemple ce qu’expliquait Sylvain Maresca (1998, p. 48) à propos des différentes traditions du portrait photographique, toutes confrontées à « l’illusion » de la photographie comme reflet de la vérité des sujets photographiés : « C’est que ce médium réactive constamment les fantasmes objectivistes liés à sa nature indicielle, en dépit des critiques radicales contre cette illusion d’une trace qui certifierait la manière dont elle enregistre l’effectivité d’une présence. » Une grande partie de la littérature théorique consacrée à la photographie au moins depuis les années 1990-2000 considère ainsi que le paradigme de la trace ou de l’empreinte doit aujourd’hui laisser place à celui de l’image fiction, de l’image possible, ou des usages de l’image. Faut-il pour autant abandonner totalement l’idée de « trace » ? Sylvain Maresca, que nous venons de citer pour l’argument à charge ajoutait par exemple en conclusion de son article, dans une forme de reconnaissance relative de la notion de « trace » : « Signalons, pour finir, que la masse des photographies réalisées jusqu’à ce jour est indéniablement une trace non seulement de ce qui a été, mais encore de la, des manières de représenter la réalité. » La trace réhabilitée implique donc de considérer qu’elle n’est pas trace de réel mais trace d’un rapport au réel qu’il s’agit d’expliciter.
Nous voulons soutenir ici que le fait de montrer de façon précise un ou plusieurs fragments d’observation sous la forme de photographies commentées, réunies en thème ou en « séries », est précieux sur de nombreux terrains, notamment ceux méconnus ou peu visibles ou encore ceux dont les images les plus visibles et répétées ne semblent pas épuiser la consistance visuelle des phénomènes. Nous pouvons considérer qu’il s’agit là de la puissance de la photographie comme trace : trace d’une présence matérielle et corporelle, trace d’une rencontre et d’un rapport enquêteur / enquêté également, et trace d’une inscription dans l’espace, à la fois ancrée et mobile9.
Ajoutons que le fait de rétablir la valeur sociologique de l’image comme trace n’est pas contradictoire avec une étude des usages ou des interprétations possibles des images considérées (Conord, 2007). La trace et son interprétation ne sont pas définitives, elles dépendent à la fois du contexte de leur production et de celui de leur mobilisation et de leur lecture : de leur contexte de production car les traces exposées le sont en fonction, de ce qui accompagne la pratique photographique lors de la phase de « terrain » (observations, entretiens, et autres modes de collecte de données). La sélection des photographies, le fait de les retoucher ou non, leur agencement en série, thème ou « essai visuel », le travail d’écriture textuelle qui les accompagne (légendes, commentaires, interprétations) cadrent la trace et restreignent les possibilités d’interprétation sans les refermer. Dans notre article par exemple, les images sélectionnées n’ont pas « un sens » unique et irrévocable, elles dépendent de leur organisation, de leur mise en relation entre elles et de celle opérée avec des éléments informatifs extérieurs restitués sous la forme de textes mêlant contextualisation et analyses (Chauvin et Reix, 2015). L’intégration de ces photographies au sein d’analyses sociologiques, constituées de raisonnements, de théories et de concepts, participent à l’élaboration de leur signification (Becker, 1981).
Enfin, la trace photographique est d’autant plus pertinente que les choix techniques présidant à la pratique photographique (le cadre, la mise au point, la focale…) permettent de construire un point de vue et de cadrer les interprétations futures, sans les garantir pour autant. Un texte est nécessaire non seulement pour contextualiser l’image mais aussi pour limiter les biais possibles d’interprétation. Ainsi, nous défendons les avantages de la photographie considérée comme trace, tout en soulignant la pluralité de ses usages et de ses interprétations potentiels et effectifs, regroupés dans l’idée de « trace ouverte ».
1 8 étudiants ont participé à l’expérience de terrain décrite dans cet article. Parmi ces 8 étudiants, 6 se sont fortement impliqués dans cette expérience et ont participé à l’organisation de l’exposition du travail réalisé à cette occasion. La qualité des photographies nous a surpris, au vu des contraintes temporelles notamment, mais aussi au regard de l’âge et de l’inexpérience relative (en termes photographiques et surtout sociologiques) des participants.
2 Étudiants impliqués dans le projet (L1 et L2, PSUAD) : Amal Adel, Jose Cuervo, Eunice Ngala, Mathilde Panneau, Bahman Tawanai, Yasmine Wael, Qulsoum Zaidi. Merci à Dale Yost et à Clémence Montagne pour leur aide lors du repérage effectué à Mussafah le samedi 15 février 2014.
3 Merci à Dale Yost et à Clémence Montagne pour leur aide lors du repérage effectué à Mussafah le samedi 15 février 2014. Merci également à Jacob Schmutz pour les discussions stimulantes que nous avons pu avoir à propos de Mussafah.
4 L’exposition était visible dans les locaux de l’Université Paris-Sorbonne entre les mois de janvier et avril 2015.
5 http://gulfnews.com/news/uae/society/icad-city-home-away-from-home-1.1591918 (date de dernière consultation : 14 avril 2017).
6 La segmentation sexuée de l’espace est forte à Abou Dhabi, moins que dans des pays voisins comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran, mais plus que dans les pays occidentaux. Les rares zones de coprésence entre le public ressemblant à ces étudiants – et plus généralement les femmes de milieux aisés - et les travailleurs immigrés sont quelques espaces publics comme la longue promenade et la plage de la Corniche au sein d’Abu Dhabi City. Mais plusieurs dispositions ont précisément été prises sur cet espace pour organiser la séparation entre ces différents publics, notamment du point de vue du genre et du point de vue social (à travers la mise en place de plages privées et publiques etc.).
7 Nous reprenons ici la formule proposée par André Gunthert (2016) dans un article consacré à la démystification de ce qu’il dénomme une « illusion essentielle ».
8 Voir notamment un récent dossier de la revue Études photographiques (2016) intitulé « Que dit la théorie de la photographie ? » et qui fait suite à une journée d’études presque entièrement consacrée à la déconstruction du paradigme indiciel.
9 Ces trois « traces » seront exposées successivement dans la suite de l’article par 3 séries de photographies prises dans l’Emirat d’Abu Dhabi (portraits de travailleurs, relations enquêteurs/enquêtés, espaces et mobilités).
BARTHES Roland (1980), La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Le Seuil.
BEAUGÉ Gilbert (1986), « La kafala : un système de gestion transitoire de la main-d’œuvre et du capital dans les pays du Golfe », Revue européenne des migrations internationales, vol. 2, n° 1, pp. 109-122.
BECKER Howard S. (1981), Exploring Society Photographically, Evanston, Mary and Leigh Block Gallery.
BRKOVIC Milica Bajic et Milakovic Mira (2011), « Planning and designing urban places in response to climate and local culture: a case study of Mussafah district in Abu Dhabi », SPATIUM International Review, n° 25, pp. 14-22.
CHAUVIN Pierre-Marie et Reix Fabien (2015), « Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche », L’Année Sociologique, vol. 65, n° 1, pp. 15-41.
CONORD Sylvaine (2007), « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française, 1, vol. 37, pp. 11-22.
CORBILLÉ Sophie (2013), « Les marques territoriales. Objets précieux au cœur de l’économie de la renommée », Communication, vol. 32, n° 2. En ligne depuis : 15/04/2014, consulté le 19/02/2017 : http://communication.revues.org/5014
GARRIGUES Emmanuel (1998), « La photographie comme trace », Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 53, n° 2, pp. 79-94.
GUÉRAICHE William (2014), Géopolitique de Dubaï et des Émirats arabes unis, Nancy, Éditions Arbre bleu.
GUNTHERT André (2016), « Une illusion essentielle. La photographie saisie par la théorie », Études photographiques, n° 34, pp. 32-51.
HALL Edward T. (1978 [1966]), La Dimension cachée, Paris, Le Seuil.
KRAUSS Rosalind (1977), « Notes on the Index. Seventies Art in America », October, vol. 3, pp. 68-81.
MARESCA Sylvain (1998), « Les apparences de la vérité. Ou les rêves d’objectivité du portrait photographique », Terrain, n° 30, pp. 83-94.
MARESCA Sylvain et MEYER Michaël (2013), Précis de photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
PEIRCE Charles Sanders (1978 [1931]), Écrits sur le signe, Paris, Le Seuil.
PIETTE Albert (1992), Le Mode mineur de la réalité. Paradoxes et photographies en anthropologie, Louvain-la-Neuve, Peeters.
SUCHAR Charles (1997) « Grounding visual vociology research in shooting scripts », Qualitative Sociology, vol. 20, n° 1, pp. 33-55.
TEXIER Simon et Doulet Jean-François (2016), Abou Dhabi, Paris, Éditions B2.
VANDER Gucht Daniel (2016), Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles.
ZAFIRAU Stephen (2008), « Reputation work in selling film and television: life in the Hollywood talent industry », Qualitative Sociology, 31, pp. 99-127.
Pierre-Marie Chauvin, « Mussafah Shots. Une expérience pédagogique de sociologie visuelle dans une petite ville industrielle des Émirats », Revue française des méthodes visuelles. [En ligne], 1 | 2017, mis en ligne le 14 juillet 2017, consulté le . URL : https://rfmv.fr