

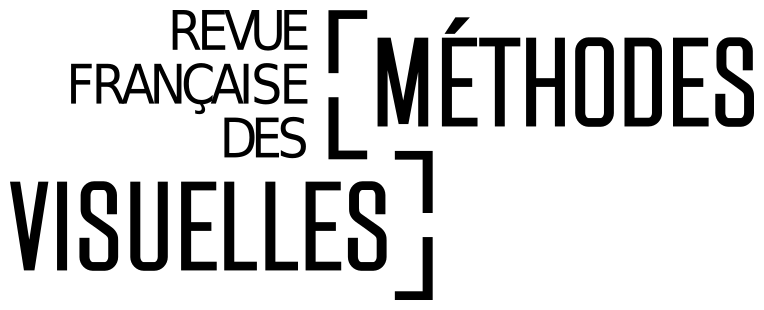
André Gunthert, EHESS
Face au constat de la dispersion des approches des formes visuelles, il paraît utile de préciser quelques repères pour l’analyse des images sociales, produits des industries culturelles à visée narrative. Compte tenu des caractéristiques des images fixes, qui articulent sous forme elliptique un récit existant à une proposition formelle, la production de la signification relève d’un travail d’interprétation ouvert. Pour restituer une objectivité à l’analyse, on peut mettre à profit les phénomènes de remédiation industriels et la multiplication des traces de la réception sur les réseaux sociaux, et déplacer l’observation d’une herméneutique des images vers une narratologie de leurs lectures. Devenues vecteur d’information, ressource de la nouvelle narration du réel, les formes visuelles s’appuient sur une esthétique de la transparence, qui utilise les codes sociaux plutôt qu’un savoir spécifique de l’image.
Mots-clés : Image, Culture visuelle, Études visuelles, Industries culturelles, Narration, Narratologie
Facing the dispersion of the many approaches of the visual, it seems useful to specify a few benchmarks for the analysis of social images, products of cultural industries with a narrative function. Given the characteristics of fixed images, which articulate in elliptic form an existing narrative to a formal proposition, the production of meaning is an open interpretation process. In order to restore the objectivity of the analysis, the phenomena of industrial remediation or the multiplication of the traces of reception on social media can be exploited to shift the observation from a hermeneutic of the images to a narratology of their readings. Having become a vector of information, a resource of the new narrative of the real, visual forms rely on an aesthetic of transparency, which uses social codes rather than specific knowledge of the image.
Keywords : Image, Visual culture, Visual studies, Cultural industries, Narration, Narratology
Comment constituer les images ordinaires de la période contemporaine en objets d’étude pour la recherche ? À une époque où la disponibilité nouvelle de nombreux corpus numérisés aiguillonne la curiosité, à un moment où de plus en plus de travaux mobilisent l’image au titre de preuve documentaire, une telle interrogation peut sembler dépassée. Ne disposons-nous pas déjà d’instruments suffisants pour traiter ces données ?
La question des images reste pourtant largement ouverte. Issus de l’histoire de l’art ou de ses prolongements : les Visual Studies, les outils théoriques existants ne semblent pas répondre aux besoins des chercheurs, dont les approches se diversifient en même temps que s’ouvrent de nouveaux terrains d’observation (Bartholeyns, 2016). Comme le langage, l’image est partout. Et comme le langage avant la linguistique, chacun pense en savoir assez sur l’image pour l’aborder sans précautions particulières. Or, non moins que le langage, les sources visuelles présentent de considérables difficultés. Et si l’étude des images industrielles contraint de recourir au bricolage, c’est bien parce que nous ne faisons que commencer à les apercevoir.
Dans ce contexte, il me paraît utile de proposer quelques principes théoriques issus de l’observation, susceptibles de contribuer à une approche plus méthodique. Mon attention se portera surtout sur le territoire le moins exploré : celui des images ordinaires, et en particulier des images fixes, car c’est là que nous manquons le plus d’éléments solides – les œuvres d’art ou les œuvres audiovisuelles ayant fait l’objet d’examens plus minutieux. La tentative de mieux circonscrire l’aire observée va de pair avec celle d’ajuster les moyens de l’observation.
En 2010, l’historien de l’art Horst Bredekamp ouvrait son essai Théorie de l’acte d’image par l’évocation du « déferlement d’images » (Bilderflut), explicitement associé à l’industrie du divertissement : « Les myriades d’images qui, jour après jour, jaillissent sur les téléphones mobiles, les écrans de télévision, sur internet et dans la presse écrite, partout dans le monde, comme si la civilisation actuelle voulait s’enfouir dans une sorte de cocon d’images » (Bredekamp, 2015, p. 9).
Vague ou cocon, ouragan ou abri ? La contradiction des analogies renforce l’impression d’incertitude et de désarroi entretenue par le langage métaphorique. Comme un raz de marée, ce qui déferle est incontrôlable. Mais de quoi parle-t-on exactement ? De l’inflation des objets de l’analyse ? Ou bien de l’inadaptation des instruments de l’observation ? Dans d’autres domaines, l’abondance de données est considérée comme une chance. Rebaptisée big data, elle peut inspirer de nouvelles méthodologies et mène à des découvertes majeures1.
Horst Bredekamp lui-même l’admet : percevoir les productions des industries culturelles sous cette forme cataclysmique est « un mélange d’impuissance et de résistance » (Bredekamp, 2015, p. 9). Et peut-être l’aveu que le « tournant iconique » tant vanté n’a pas eu lieu. S’appuyant sur le précédent du « tournant linguistique » décrit par Richard Rorty, les chercheurs W.J.T. Mitchell et Gottfried Boehm proclamaient chacun de leur côté au début des années 1990 l’avènement d’un nouveau paradigme, annonciateur d’une science des images dont ils s’employaient l’un et l’autre à jeter les bases (Mitchell, 1992 ; Boehm, 1994)2.
Mais l’analogie a rapidement tourné court. Si l’on observe une montée incontestable de l’intérêt pour le domaine visuel, la dispersion des approches et l’absence d’unité méthodologique sont flagrantes. Alors que le recours aux modèles linguistiques au sein de la philosophie analytique démontrait leur solidité, leur utilité et leur polyvalence, l’apport épistémologique de la « science des images » reste pour l’instant indiscernable.
Comment expliquer que, malgré la publication de plusieurs sommes théoriques ambitieuses (Mitchell, 2009 ; Boehm, 1994 ; Belting, 2004), la vogue des Visual Studies n’a pas renforcé la convergence, mais au contraire encouragé l’éparpillement ? Héritière du projet autonomiste de l’histoire de l’art (Michaud, 2005), la « science des images » perpétue le postulat de la singularité des formes visuelles. Or la diversification des travaux sur l’image est d’abord celle d’approches non-spécialisées qui, plutôt que de réutiliser un corps de connaissances existant, ont développé de façon indépendante leurs propres outils. Le programme autonomiste de la spécialité s’est heurté à la variété et à l’hétérogénéité des usages de l’image, irréductibles à l’approche univoque d’une herméneutique de l’œuvre.
Un sérieux obstacle à l’élargissement des objets d’étude est précisément le sort réservé aux industries culturelles. Dans la tradition de l’École de Francfort, qui préjuge au lieu de décrire et ne s’attarde sur le divertissement que pour dénoncer son caractère mystificateur, normatif ou aliénant (Horkheimer, Adorno, 1974), nombreux sont les travaux qui se limitent au territoire des œuvres légitimes, ou restent imperméables aux logiques industrielles et médiatiques, lorsqu’ils tentent d’approcher les formes vulgaires3. La distinction essentielle entre l’œuvre et sa reproduction interdit de considérer la production industrielle autrement que comme la répétition dénaturée de l’original – et non comme un contexte ayant ses propres caractéristiques. L’approche hiérarchique léguée par la culture de la Distinction impose la grille du jugement de valeur et de l’opposition entre high et low (Bourdieu, 1979 ; Roque, 2000). Éric Macé a décrit les conséquences de cet aveuglement des clercs, qui efface du champ de l’observation des pans entiers de l’activité culturelle, parmi les plus significatifs (Macé, 2006).
Le désarroi qu’exprime la métaphore du déferlement peut s’expliquer, non comme la conséquence de l’abondance des documents, mais comme résultant de l’absence de leur organisation. Car à la différence des sources imprimées, dûment classées au sein de vastes conservatoires qui en préservent l’accessibilité, les images ordinaires ne sont pas des objets autonomes que l’on peut ranger dans des collections standardisées. Outre les différences de médias4 qui imposent une séparation entre estampes, films, photographies, vidéos, affiches, etc., la part majeure de la production iconographique existe de manière diffuse, hors catalogue, au sein de supports imprimés, quand ce n’est pas comme décor d’objets divers, du calendrier à la boîte à bonbons, généralement exclus des collections publiques.
Ce n’est que depuis peu, grâce aux progrès de la numérisation des imprimés, que les sources graphiques accèdent à une uniformité virtuelle, permettant de proposer de nouveaux outils de consultation. Une barrière s’oppose pourtant à la constitution de vastes bases de données audiovisuelles. L’horizon de l’exploitation scientifique de ces documents reste borné par le verrouillage juridique de la propriété intellectuelle. En l’absence d’une exception de citation, équivalente à celle qui permet aux chercheurs de mobiliser librement les sources textuelles, la loi soumet la mention audiovisuelle à l’autorisation des ayants droits, voire à celle des copistes, donnant à ces acteurs un pouvoir de censure préalable, à peine tempéré par un fair use aux contours flous (Ballon, Westermann, 2006 ; Gunthert, 2014). Seul le moteur de recherche inversé Google Images bénéficie d’une tolérance concédée à la puissance du géant californien.
Malgré ces limitations, les sources disponibles excèdent largement les moyens de la recherche : à l’échelle du monde académique, les études visuelles représentent une spécialité peu nombreuse. Dans ces conditions, seul l’apport des non-spécialistes permettra de surmonter les obstacles issus d’une approche autonomiste de l’image. Mais les deux catégories de chercheurs ont intérêt au partage des savoirs. Les pratiques ont orienté la compréhension et les usages des formes visuelles. C’est pourquoi il est utile d’en caractériser les principaux traits – sans les confondre avec des propriétés ontologiques.
Mes remarques s’appuient sur l’observation de terrain. Après une première expérience d’observation participative dans le domaine des images numériques (Gunthert, 2015), j’ai utilisé mes carnets de recherche pour enregistrer au quotidien plusieurs centaines de relevés, confrontant une ou des images à des situations de réception documentées, à travers le filtre des médias ou des réseaux sociaux5. De l’analyse de ces cas concrets découlent les principes et propositions que je soumets au débat, en vue de favoriser une approche rigoureuse du matériel visuel, quel que soit son contexte.
Comme de nombreuses figures de la culture populaire, celle de la Marche du progrès est à la fois célèbre et méconnue. Dans La Vie est belle, le paléontologue Stephen Jay Gould s’attarde sur cette icône, dont un éditeur hollandais a eu la mauvaise idée d’orner la couverture d’un de ses ouvrages en traduction. Pour ce spécialiste, « L’évolution de la vie à la surface de la planète est conforme au modèle du buisson touffu doté d’innombrables branches […]. Elle ne peut pas du tout être représentée par l’échelle d’un progrès inévitable » (Gould, 1991, p. 25-35).
Pourtant, reconnaît Gould, la succession des hominidés en file indienne, connue dans le monde entier, est bien une « représentation archétypale de l’évolution – son image même, immédiatement saisie et instinctivement comprise par tout le monde » (ibid., p. 30). Peu de savants, explique-t-il, seraient prêts à reconnaître que certaines figures ont « un contenu idéologique intrinsèque. […] Mais bon nombre de nos illustrations matérialisent des concepts, tout en prétendant n’être que des descriptions neutres de la nature » (ibid., p. 26) – comme ce dessin, qui couronne invariablement le progrès évolutif par la représentation d’un mâle caucasien, conforme aux stéréotypes racistes et sexistes.
Homme de culture à l’érudition foisonnante, le paléontologue veille toujours à citer la source des nombreuses références qui émaillent son propos. Pourtant, alors même que la Marche propose une illustration majeure de la théorie darwinienne, Gould n’en donne ni l’origine ni l’auteur. Commentant ses variantes, il y renvoie comme à une iconographie familière, mais semble ignorer sa provenance.
Plutôt que de se borner à restituer cette source (œuvre du dessinateur spécialisé Rudolph Zallinger, la version originale de l’illustration a été publiée en 1965 dans l’ouvrage de Francis Clark Howell, Early Man, dans la célèbre collection de vulgarisation « Time Life » (Howell, 1965)), il faut comprendre que cette présentation est significative de la production des industries culturelles.
L’absence d’indication de source est moins un défaut d’attribution que la trace d’une réception spécifique. Deux logiques s’affrontent. La logique patrimoniale qui détermine la préservation des informations d’origine est constitutive du fonctionnement d’un marché de l’art, où la valeur des biens est déterminée par la maîtrise d’un savoir historique par des acteurs experts. Dans la logique industrielle, qui tend à réduire les obstacles à la circulation, l’indication généalogique n’est que rarement un élément de la valorisation du produit. La dynamique qui conduit à l’effacement auctorial est également celle qui favorise la remédiation des contenus, et leur confère le statut de stéréotypes culturels. Telle est bien la situation décrite par Gould, qui souligne son autorité normative.
Il n’est donc pas pertinent de proposer un simple décalque de l’approche de l’histoire de l’art à l’endroit des images de la culture ordinaire. Une science des images qui ne serait qu’une science des œuvres ne peut caractériser ce qui fait l’efficace d’une icône comme la Marche du progrès.
Pour discuter de la signification de la Marche, qui n’est pas une œuvre située mais une imagerie diffuse, Stephen Jay Gould part de l’idée que cette icône est porteuse d’un message ou d’une narration. En l’absence de toute information patrimoniale qui permettrait d’éclairer sa signification, ce principe suppose la reconstitution du sens par l’interprétation – et en l’occurence par une interprétation sociale, manifestée par les remédiations et les variantes.
Il existe des formes visuelles qui ne semblent pas imposer d’approche interprétative. Les décors qui ornent les pièces de monnaie ou les emballages de produits alimentaires, les traits de style architecturaux ou typographiques sont habituellement considérés comme des formes répétitives dépourvues de valeur narrative, ou dont la signification sert essentiellement des fonctions d’identification.
Entre œuvres d’art et formes décoratives, il existe donc une catégorie d’images qui, vouées à un usage utilitaire dans l’espace social, sont supposées comporter une visée ou une intention narrative. Je propose d’appeler images sociales ces produits des industries culturelles, perçus comme des formes symboliques originales. Images d’information, films documentaires ou de fiction, bandes dessinées, publicités, affichage politique, illustrations pédagogiques : ce sont ces images qui fondent la critique sociétale des Mythologies de Roland Barthes (1957) ou de La Société du spectacle de Guy Debord (1967), qui voient en elles les meilleurs messagers de l’idéologie et des représentations collectives.
À la question : « qu’est-ce qu’une narration visuelle ? », les réponses paraissent contradictoires. D’un côté, les spécialistes, se basant sur le modèle théâtral ou romanesque de la représentation de l’action dans le temps, associent l’idée de récit à la séquentialité, et présentent de ce fait l’image fixe comme un support peu adapté à la narration (Steiner, 2004). Selon l’esthétique classique définie par Lessing dans le Laocoon : « La peinture ne peut exploiter qu’un seul instant de l’action et doit par conséquent choisir le plus fécond » (Lessing, 1990, p. 120). En d’autres termes, l’usage narratif des images repose sur l’ellipse ou la condensation, et renvoie à un schéma externe nécessaire à l’interprétation de l’œuvre (sans connaissance préalable de l’anecdote du Laocoon, impossible de comprendre la signification de la célèbre statue du Vatican).
D’autre part, un savoir vernaculaire non moins traditionnel affirme, à travers diverses citations devenues proverbiales, que la peinture est « la Bible des illettrés », qu’« un bon croquis vaut mieux qu’un long discours », ou qu’« une image vaut mille mots »6 ; soit autant de manières d’exprimer l’idée de l’universalité d’un langage visuel immédiatement accessible, et donc véhicule privilégié d’une narration efficiente7.
Cette vision optimiste des formes visuelles est le reflet d’une histoire. Car l’image est un vecteur de significations paradoxal, capable de proposer simultanément un grand nombre d’informations, mais qui, dépourvue d’un système permettant de les organiser, comme la structure syntaxique du langage, présente un haut degré d’ambiguïté.
Un exemple frappant de l’indétermination de l’image est fourni par Roland Barthes, qui découvre dans La Chambre claire (1980) qu’il peut exister deux niveaux de lecture des photographies. À côté de l’identification d’un sens manifeste, confirmé par la légende, que le sémiologue appelle studium, il qualifie de punctum la mise en exergue d’une donnée quelconque, sélectionnée par l’observateur parmi l’abondance de détails que livre le réalisme photographique.
Avec cet exercice d’interprétation sauvage, Barthes illustre l’une des caractéristiques essentielles des images, habituellement désignée par le terme de polysémie. La non-hiérarchisation de l’information, qui favorise la simultanéité de la perception visuelle, est aussi le trait qui contrarie l’intelligibilité du message. Il témoigne par ailleurs de la marge d’interprétation laissée au spectateur, qui ne se livre pas à un simple décodage, mais bien à un travail de reconstitution du sens par ses propres moyens.
C’est cette liberté qui explique qu’il est souvent difficile, lorsqu’on débat de la signification des images, de faire prévaloir l’objectivité d’une lecture. À la manière de Roland Barthes, chacun peut à la limite choisir une information et la déchiffrer à sa convenance. Si l’autorité du spécialiste permet de trancher dans une querelle érudite, il n’en va pas de même dans la discussion des images ordinaires. Cette difficulté que j’ai souvent rencontrée dans la conversation en ligne constitue un obstacle majeur à l’analyse, puisque la subjectivité est la mesure de l’interprétation, et qu’il n’est pas possible d’établir une signification de manière indiscutable.
Issue du domaine de la publicité, la formule de « l’image qui vaut mille mots » dévoile la stratégie des professionnels pour contrecarrer cette incertitude. Car ce sont bien les producteurs qui ont été les premiers confrontés aux difficultés de l’établissement du sens, et qui y ont répondu en développant une esthétique de l’hyperintelligibilité des images.
Les moyens les plus puissants de cette esthétique sont la simplification de la proposition visuelle, l’articulation des images avec les énoncés et les contextes, et le recours aux codes sociaux pour interpréter les messages graphiques. Une formule comme « une image vaut mille mots » repose sur l’opposition a priori évidente entre deux registres expressifs que tout sépare. Percevoir leur articulation ne va nullement de soi. Selon l’historien de l’art Ernst Gombrich, la célèbre mosaïque de Pompéi montrant un chien enchaîné resterait énigmatique sans l’inscription « Cave canem » (attention au chien) qui l’accompagne, et qui permet simultanément d’interpréter l’attitude du chien comme menaçante, et de comprendre la fonction d’avertissement du message. La présence du texte modifie donc la lecture de l’image. Leur composition n’est pas une simple juxtaposition d’informations, mais un système redondant qui associe plusieurs canaux de communication, et fusionne code verbal et forme visuelle en un seul message (Gombrich, 1983).
L’analyse des usages narratifs de l’image suppose de prendre en compte cette articulation. Lorsqu’il décrit les pratiques visuelles familiales, l’anthropologue Richard Chalfen avoue ne pas y discerner de récit : « l’histoire à proprement parler n’apparaît pas dans les albums ou à l’écran, elle n’est pas “racontée” par les images. On peut dire qu’une image “vaut mille mots”, non parce que les photos de famille disent quelque chose, mais parce qu’elles font parler les gens » (Chalfen, 2015, p. 22).
Or, une photographie qui fait parler les gens est une image qui produit un récit8. Plutôt que d’opposer image et langage, il faut manifestement comprendre le système visuel de la même manière que l’interaction orale – qui associe elle aussi message linguistique et communication non verbale.
L’ambiguïté et la dépendance au contexte de la part gestuelle de la communication confèrent aux signaux kinésiques une fonction d’accompagnement : isolés de la performance verbale, ils ne pourraient suffire à porter le message, mais ils composent avec elle un système redondant qui renforce l’intelligibilité de chaque composante de l’échange (Birdwhistell, 1970). Comme le paralangage gestuel, l’image, dans ses usages sociaux, n’est jamais seule, mais toujours associée à une légende, un énoncé qui la complète, un commentaire oral, voire à une narration implicite, comme les versions remédiées de la Marche du progrès, qui tablent sur la remémoration du récit évolutif.
Le schéma de Lessing reste donc pertinent, et les deux façons de décrire l’image sont liées. La narration visuelle ne peut s’appuyer sur une proposition elliptique ou incomplète que parce qu’elle dépend d’un dispositif qui inclut le récit. Plutôt qu’à en lire séparément les composants, le travail d’interprétation invite à le décrire comme un processus en trois étapes : 1) la recherche de la signification dans l’énoncé ou le contexte ; 2) la synthèse du message et de la proposition visuelle ; 3) la remémoration du message par l’exposition à l’image.
Lorsque la presse réagit à l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, elle recourt dans ses couvertures au vocabulaire usuel de l’illustration, en jouant sur l’expressivité du portrait, choisi en fonction du jugement porté sur l’événement. On a bien affaire ici à un usage narratif : l’expression faciale n’apporte pas une information sur l’humeur du nouveau président, mais propose la traduction visuelle de la perception du scrutin par une rédaction. La sélection d’un portrait souriant manifeste un avis positif, celle d’un visage soucieux ou grimaçant marque au contraire la réserve ou la réprobation.
Cette narration peut s’exprimer par une image et une seule. Mais à la condition d’apercevoir que cette figuration elliptique renvoie à l’ensemble d’un processus, qu’elle ponctue d’une appréciation finale. La couverture d’un magazine fonctionne ici à la manière d’une caricature ou un dessin de presse, dont le contenu expressif ne peut se comprendre sans la référence à un contexte partagé, ou hors du cadre énonciatif dans lequel il s’insère.
Réaction à une actualité qu’elle incarne, l’illustration de presse en propose simultanément le commentaire. Quoique ponctuelle, l’image s’inscrit à la fois dans le cours d’une événementialité et dans un dispositif plus complexe, qui implique une information préalable, ainsi que la maîtrise de règles énonciatives implicites. L’image sociale ne vaut mille mots que parce qu’elle a très précisément pour fonction d’en proposer un écho visuel intelligible : une synthèse mnémotechnique qui a vocation à se substituer à l’énoncé.
De façon plus fondamentale, la narration visuelle repose sur une conversion de la nature du message. Si l’on reprend l’exemple de la Marche du progrès, on peut observer que de nombreuses adaptations parodiques proposent une modification de la dernière figure du groupe, signifiant une régression plutôt qu’une avancée. Cette manipulation de la logique narrative de la figure implique que son sens fondamental est perçu comme un déroulement historique strictement orienté, une amélioration graduelle et irréversible, qui correspond en effet à l’interprétation vulgarisée de l’évolution des espèces.
Wikipedia propose de voir la pochette de l’album Full Circle des Doors (1972) comme une adaptation du dessin de Zallinger. Pourtant, malgré leur proximité formelle, les deux images renvoient à des propositions narratives nettement distinctes.
L’album des Doors s’inspire de l’imagerie cyclique des différents âges de l’homme, qui nourrit la peinture et la gravure depuis la Renaissance (Day, 1992). À l’inverse, la Marche correspond à un scénario téléologique dont le dernier stade se présente comme un état de perfection indépassable. Mais le rapprochement des deux documents montre que les informations iconographiques ne suffisent pas à déduire la signification du dessin. Seule la connaissance d’un récit préexistant, associé à l’image par la tradition, permet d’interpréter correctement la série des hominidés.
Comme l’exprime fortement Stephen Jay Gould, l’icône propose « la représentation archétypale de l’évolution – son image même, immédiatement saisie et instinctivement comprise par tout le monde » (Gould, 1991, p. 30). Instinctivement ? Le dessin pédagogique évoque une narration implicite. Une fois mémorisé, l’énoncé semble ne plus faire qu’un avec son incarnation visuelle. En effaçant sa dimension énonciative, l’image naturalise le récit.
Ressort primordial de la narration visuelle, la figure de l’ellipse suppose l’existence d’un implicite – autrement dit d’un contenu absent qui doit être restitué par le destinataire (Kerbrat-Orecchioni, 1986). Ce travail du spectateur fait de l’interprétation des images sociales un lieu de coconstruction de la signification, qui comprend une marge de liberté et une part de détermination individuelle. L’ouverture des réseaux sociaux a donné l’occasion de vérifier à une échelle sans précédent la diversité de l’exégèse et la plasticité des contenus.
Le rétablissement d’une objectivité de l’analyse passe donc par un déplacement de l’espace instable de l’interprétation vers celui des traces de la production ou de la réception – d’une herméneutique des images à une narratologie de leurs lectures. Les légendes, les variantes ou les témoignages des producteurs, les exégèses ou les controverses des spécialistes9, mais aussi les réactions ou les remédiations du grand public proposent une réification des options de lecture, et fournissent ainsi une base objective à l’examen.
Lors de son premier déplacement international en tant que président, Donald Trump a notamment rencontré le pape François au Vatican, le 24 mai 2017 (Kirchgaessner, 2017). Une photographie par Evan Vucci (AP) de cette audience suscite rapidement des réactions moqueuses, sous la forme de commentaires ou de détournements d’images diffusés sur Twitter. Outre le contraste entre le blanc de la soutane papale et le noir protocolaire des tenues des invités, l’opposition entre le sourire du président américain et les mines sombres des autres protagonistes a particulièrement inspiré les internautes. Souligné par divers montages témoignant de l’habituelle bonne humeur papale, l’air chagrin du pontife semblait fournir la preuve de l’universel désagrément provoqué par le nouveau locataire de la Maison-Blanche.
Ce divertissement confirme également, jusque dans les méthodes comparatives utilisées, la sensibilité du plus grand nombre à l’expressivité faciale – ce qui n’a rien de surprenant, puisqu’il s’agit d’une compétence sociale élémentaire. Que cette ressource soit abondamment utilisée dans le paysage de l’information visuelle, et qu’elle l’ait été depuis les temps les plus reculés pour orienter la lecture des images, paraît tout aussi banal.
Ce constat comporte pourtant un enseignement essentiel. Destinée à être consommée dans un contexte de loisir par un public étendu, l’image sociale ne peut s’appuyer que sur des principes sémiotiques élémentaires, dont la simplicité et l’universalité garantissent l’appropriation. Pour faciliter l’interprétation, les producteurs recourent ainsi aux codes sociaux existants, plutôt qu’à un savoir spécifique de l’image.
Cette réponse pragmatique n’est pas une simple transposition des mécanismes cognitifs. Leur adaptation à l’espace public forme une culture visuelle autonome, fruit d’une longue élaboration (Schmitt, 1990). Ainsi, la visite papale constitue-t-elle une épreuve protocolaire récurrente, à la scénographie stable, qui s’impose traditionnellement aux chefs d’État et suggère la mise en série. Dans le contexte médiatique, l’air chagrin du pape sera interprété, non comme une émotion passagère, mais comme un écho au récit de la prise de fonction tumultueuse du président américain.
Outre les ressources de la communication non verbale, un autre savoir social adapté à l’image est le recours aux indications de géométrie attentionnelle. Parmi les images virales les plus remarquées de la période récente, trois photographies diffusées sur les réseaux sociaux, puis reprises, commentées ou détournées par plusieurs milliers d’internautes ont fait l’objet d’un travail d’interprétation spontané, principalement basé sur ces signes : une photographie prise par le néerlandais Gijsbert van der Wal le 27 novembre 2014 au Rijksmuseum d’Amsterdam d’un groupe d’adolescents tournant le dos à La Ronde de nuit de Rembrandt ; une autre, anonyme, de Mark Zuckerberg à Barcelone le 21 février 2016, marchant seul devant une foule de journalistes munis de casques de réalité virtuelle ; une troisième, exécutée par Barbara Kinney lors d’un meeting à Orlando le 21 septembre 2016, montrant les supporters d’Hillary Clinton lui tournant le dos pour l’exécution d’un selfie collectif.
Ces images sont caractérisées par la présence d’indicateurs déictiques, rendus évidents par leur répétition collective. Dans les trois cas, on rencontre une opposition entre un personnage ou un objet et un groupe dont l’attention semble détournée par la manipulation d’outils technologiques dernier cri. Le fort degré d’engagement constaté dans les commentaires tient autant à la lisibilité d’une situation paradoxale qu’à son interprétation comme preuve du récit diffus de l’aveuglement ou de l’asocialité provoqués par l’absorbement numérique – une adaptation postmoderne du mythe de la caverne de Platon10.
Le déploiement de cette capacité interprétative par l’intermédiaire de la discussion publique sur les réseaux sociaux manifeste l’efficacité sémiologique des indications directionnelles – regards, gestes de monstration, orientation de projecteurs ou de caméras, etc. – qui structurent l’espace à la manière d’une quasi-syntaxe, aidant à préciser le sens de l’action. Le succès du selfie, pratique qui atteste par une posture visible son caractère autoproduit, fournit un exemple éloquent de la productivité narrative de cette géométrie.
Là encore, il s’agit d’une ressource traditionnelle de l’iconographie, dont on retrouve par exemple la trace dans la Tapisserie de Bayeux (XIe siècle), avec un groupe désignant du doigt un météore annonciateur de grands événements – le passage en 1066 de la comète de Halley.
Cette communauté de moyens narratifs réclame d’interroger la situation longtemps décrite comme spécifique de la photographie, média que sa technique d’enregistrement semble isoler des autres formes visuelles.
C’est d’abord la tradition iconogaphique qui a conduit à forger un discours autonome de la photographie. Comme l’illustre la légende des raisins de Zeuxis, « peints avec tant de vérité, que des oiseaux vinrent les becqueter » (Pline l'Ancien), le comble du réalisme ne pouvait autrefois mener qu’au simulacre.
Mais la compréhension des formes visuelles a subi une évolution profonde. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, nous avons assisté à une monumentale inversion des paradigmes. Avec l’installation du modèle objectiviste, inauguré par les sciences d’observation (Daston, Galison, 2012), puis conforté par la presse, la photographie, le cinéma, la télévision ou le smartphone, l’image est considérée comme une information, un document susceptible d’apprendre quelque chose sur le monde : un surcroît de réel et non une illusion.
Plutôt qu’une exception, c’est désormais la photographie qui fait figure d’archétype du visuel. Si le discours spécialisé n’a pas encore intégré ce renversement (Gunthert, 2016), les usages ont pleinement entériné la victoire du modèle de la reproduction, issu des pratiques de la communication, sur celui de l’imitation, issu des beaux-arts. Il convient donc de ne pas séparer les images d’enregistrement des autres formes visuelles, avec lesquelles elles échangent constamment figures et usages narratifs. La prise en considération unitaire du champ est d’autant plus nécessaire qu’elle seule permet de faire intervenir les différences de style ou de média, qui participent activement de sa sémiologie.
Si l’on emprunte à Louis Marin son antithèse de l’opacité, comprise comme manifestation du dispositif, et de la transparence, comprise comme son retrait (Marin, 1989, p. 10), c’est désormais une esthétique de la transparence qui règne sur les représentations. Cette esthétique, qui ne se limite pas au domaine visuel, a pour trait principal l’effacement de la médiation. Le recours à des outils narratifs non spécifiques participe au premier chef à cette oblitération, ainsi qu’en témoigne la célèbre formule de Roland Barthes décrivant la photographie comme « un message sans code » (Barthes, 1961, p. 128) – alors que celle-ci s’appuie en réalité sur des règles implicites, des codes qui ne disent pas leur nom.
Dans un monde où l’image n’est plus un simulacre platonicien, mais un document chargé d’une valeur d’attestation, la narration a elle aussi changé de camp. Alors qu’elle portait autrefois le sceau exclusif de la fiction, nous découvrons qu’il existe un récit du réel, non moins élaboré (Thérenty, Vaillant, 2001 ; Kalifa, Régnier, Thérenty, Vaillant, 2011). L’image issue du modèle photographique en est devenue manifestation la plus éclatante – celle qui fait oublier le poids du dispositif, dans son évidence épiphanique. Comme le montre l’analyse des œuvres cinématographiques, cette apparence peut être renversée, à condition de prendre en compte l’ensemble des dimensions d’un système où le visuel naturalise le récit. Le basculement d’une herméneutique des images vers une narratologie de leurs lectures, et la prise en compte du travail de l’interprétation, à travers ses traces objectives, permettent de restituer son opacité à une production trop transparente.
1 On observe du côté des humanités digitales des expérimentations visant à exploiter les vastes corpus illustrés : Ginosar, Rakelly, Sachs et alli., 2015 ; Moreux, 2016.
2 Souvent cités ensemble, ces deux articles ne décrivent pas un seul et même phénomène, mais divergent au contraire sur les symptômes, les références ou la chronologie retenue.
3 Voir par exemple Carlo Ginzburg (2013) qui applique la méthode classique de l’analyse iconographique à une affiche de propagande, sans jamais mobiliser de données médiatiques (à comparer avec James Taylor, 2013).
4 Sur les contraintes de la conservation par médias et leurs conséquences pratiques, voir notamment Leblanc, Dupuy (2017).
5 L’Atelier des icônes (384 billets, 2009-2014, http://culturevisuelle.org/icones/) ; Totem (250 billets, 2009-2012, http://culturevisuelle.org/totem/) ; L'image sociale (220 billets, depuis 2014, http://imagesociale.fr/).
6 La formule de la « Bible des illettrés » est issue d'une lettre de Grégoire Le Grand à l'évèque Sérénus (Schmitt, 2002, p. 101-102). Attribuée à Napoléon, l'expression « un bon croquis vaut mieux qu'un long discours » est probablement apocryphe. La formule « A Picture is worth a thousand words » se diffuse dans le monde de la publicité dans les années 1910-1920 (Pringle, 2010, p. 13).
7 La version la plus récente de cette croyance se manifeste exemplairement dans l'ouvrage de Robert Hariman, John Louis Lucaites (2007).
8 J'adopte ici la définition du récit comme organisation productrice de sens proposé par Marie-Laure Ryan (2004, p. 2-13).
9 Voir par exemple Jeanne Favret-Saada (2015).
10 Parmi les sources de ce récit, voir notamment Sherry Turkle (2011).
BALLON Hilary, Westermann Mariët (2006), Art History and Its Publications in the Electronic Age, Houston, Rice University Press.
BARTHES Roland (1957), Mythologies, Paris, Le Seuil.
BARTHES Barthes (1961), « Le message photographique », Communications, n° 1, pp. 127-138.
BARTHES Barthes (1980), La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, éd. de l’Etoile/Gallimard/Le Seuil.
BARTHOLEYNS Gil (2016), « Un bien étrange cousin, les Visual Studies », Politiques visuelles, Paris, Presses du réel, pp. 5-28.
BELTING Hans (2004) (2001, trad. de l’allemand par J. Torrent), Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard.
BIRDWHISTELL Ray (1970), Kinesics and Context. Essays on Body Motion Communication, Philadelphie, University of Pennsylvania Press.
BOEHM Gottfried (1994), « Die Wiederkehr der Bilder », Was ist ein Bild ?, Munich, Fink.
BOURDIEU Pierre (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit.
BREDEKAMP Horst (2015) (2010, trad. de l’allemand par F. Joly), Théorie de l’acte d’image, Paris, La Découverte.
CHALFEN Richard (2015) (1987, trad. de l’anglais par J.-F. Allain), « La photo de famille et ses usages communicationnels », Études photographiques, n° 32, printemps 2015, p. 22. En ligne : https://etudesphotographiques.revues.org/3502 (consulté le 19/02/2017).
HOWELL Francis Clark (1965), Early Man, « Time-Life ».
DASTON Lorraine, Galison Peter (2012) (2007, trad. de l’américain par S. Renaut et H. Quiniou), Objectivité, Paris, Presses du réel.
DAY Barbara Ann (1992), « Representing Aging and Death in French Culture », French Historical Studies, vol. 17, n° 3, printemps, pp. 688-724.
DEBORD Guy (1967), La Société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel.
FAVRET-SAADA Jeanne (2015), Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins, Paris, Fayard.
GINOSAR Shiri, Rakelly Kate, Sachs Sarah et alli. (2015), « A Century of Portraits. A Visual Historical Record of American High School Yearbooks », Extreme Imaging Workshop, International Conference on Computer Vision, ICCV n° 3, pp. 1-7. En ligne : https://arxiv.org/abs/1511.02575 (consulté le 19/02/2017).
GINZBURG Carlo (2013), « Your country needs you. Une étude de cas en iconographie politique », Peur Révérence Terreur, Paris, Presses du réel, 2013, pp. 67-108.
GOMBRICH Ernst (1983) (trad. de l’anglais par A. Lévêque), « L’image visuelle », L’Écologie des images, Paris, Flammarion, pp. 326-328.
GOULD Stephen J. (1991) (trad. de l’américain par M. Blanc), La Vie est belle. Les surprises de l’évolution, Paris, Le Seuil, pp. 25-35.
GUNTHERT André (2014), « Permettre les usages publics des images », in Pages publiques. À la recherche des trésors du domaine public, Caen, C&F éditions, pp. 62-68.
GUNTHERT André (2015), L’Image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel.
GUNTHERT André (2016), « Une illusion essentielle. La photographie saisie par la théorie », Études photographiques, n° 34, printemps, pp. 32-51. En ligne : https://etudesphotographiques.revues.org/3592 (consulté le 19/02/2017).
HARIMAN Robert, Lucaites John Louis (2007), No Caption Needed. Iconic Photographs, Public culture and Liberal Democracy, Chicago, University of Chicago Press.
HORKHEIMER Max, Adorno Theodor (1974) ((1944, trad. de l’allemand par E. Kaufholz), « La production industrielle de biens culturels. Raison et mystification des masses », La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, pp. 129-176.
KALIFA Dominique, RÉGNIER Philippe, THÉRENTY Marie-Eve, VAILLANT Alain (dir.) (2011), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau monde.
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (1986), L’Implicite, Paris, Armand Colin.
KIRCHGAESSNER Stephanie, « Pope looks glum after Vatican meeting with Donald Trump », The Guardian, 25 mai 2017. En ligne : https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/24/donald-trump-vatican-meeting-pope-francis
LEBLANC Audrey, Dupuy Sébastien (2017), « Le fonds Sygma exploité par Corbis. Une autre histoire du photojournalisme », Études photographiques, n° 35, printemps, pp. 88-111.
LESSING Gotthold Ephraim (1990) (1766, trad. de l’allemand par Courtin), Laocoon, Paris, Hermann.
MACÉ Éric (2006), Les Imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, Ed. Amsterdam.
MARIN Louis (1989), Opacité de la peinture. Essais sur la représentation au Quattrocento, Paris, Usher.
MICHAUD Éric (2005), Histoire de l’art, une discipline à ses frontières, Paris, Hazan.
MITCHELL W.J.T. (1992), « The Pictorial Turn », ArtForum, n° 5, pp. 89-94
MITCHELL W.J.T. (2009) (1986, trad. de l’anglais par M. Boidy et S. Roth), Iconologie. Image, texte, idéologie, Paris, Les Prairies ordinaires.
MOREUX Jean-Philippe (2016), « Approches innovantes pour la presse ancienne numérisée : fouille et visualisation de données », Carnet de la Bibliothèque nationale de France. En ligne : https://bnf.hypotheses.org/208 (consulté le 30/12/2016).
PLINE l’Ancien, Histoire naturelle, Livre 35, XXXV (traduit du latin par Émile Littré), Paris, éd. Dubochet, 1848-1850, vol. 2.
PRINGLE Mike (2010), « Do a Thousand Words Paint a Picture? », in Bailey Chris, Gardiner Hazel (dir.), Revisualizing Visual Culture, Farnham, Ashgate, pp. 11-28.
ROQUE Georges (dir.) (2000), Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art, Nîmes, Jacqueline Chambon.
RYAN Marie-Laure (dir.) (2004), Narrative Across Media. The languages of Storytelling, Lincoln, University of Nebraska Press.
SCHMITT Jean-Claude (1990), La Raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard.
SCHMITT Jean-Claude (2002), Le Corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Paris, Gallimard.
STEINER Wendy (2004), « Pictorial Narrativity », in Ryan Marie-Laure (dir.), Narrative Across Media. The Languages of Storytelling, Lincoln, University of Nebraska Press, pp. 145-177.
TAYLOR James (2013), « Your Country needs you », Glasgow, Saraband.
THÉRENTY Marie-Eve, Vaillant Alain (2001), 1836. L’An 1 de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique de La Presse de Girardin, Paris, Nouveau monde.
TURKLE Sherry (2011), Alone Together. Why We Expect More From Technology and Less From Each Other, New York, Basic Books.
André Gunthert, « Pour une analyse narrative des images sociales », Revue française des méthodes visuelles. [En ligne], 1 | 2017, mis en ligne le 14 juillet 2017, consulté le . URL : https://rfmv.fr